L'avenir de l'énergie
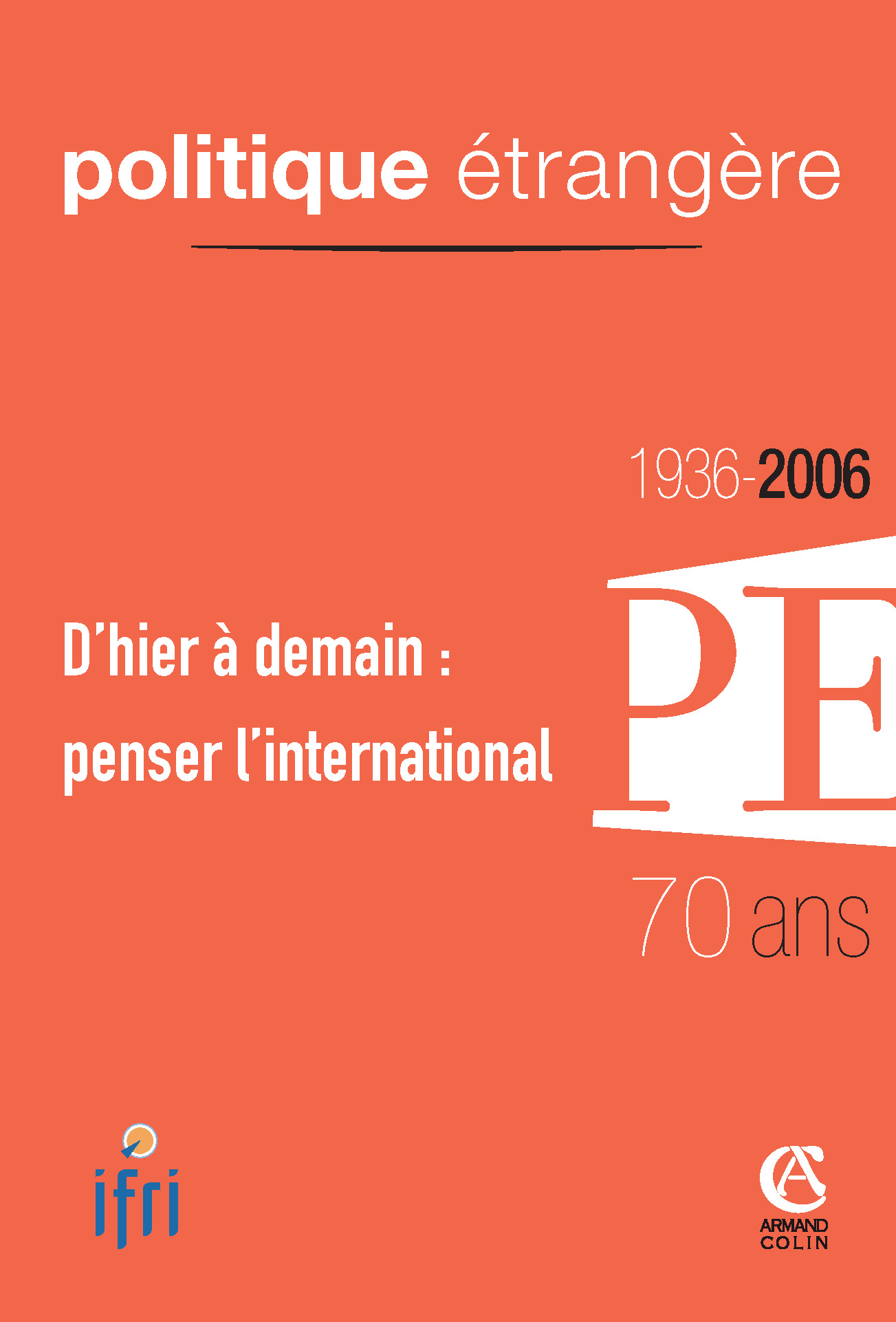
L’idée d’une crise de l’énergie repose sur des inquiétudes parfois légitimes –sécurité des approvisionnements, changement climatique–, parfois infondées –épuisement des ressources pétrolières, caractère prédateur des grands groupes énergétiques, lien entre prix de l’énergie et récession, ou utilisation des ressources financières dégagées par les producteurs. Nombre de ces problèmes pourraient être atténués par un marché international en intégration croissante.

Anticiper l’avenir est toujours hasardeux. C’est aussi la condition première de la stratégie et du succès des entreprises.
Les marchés de l’énergie traversent actuellement une période particulièrement difficile. De multiples inquiétudes se font jour, certaines justifiées, d’autres exagérées, qui rendent difficile d’anticiper le futur. D’aucuns nous prétendent à un tournant, avec des prix de l’énergie destinés à rester élevés, et les énergies alternatives devant progressivement remplacer les énergies fossiles ; d’autres soutiennent que rien n’a changé, et que les commentateurs prennent une évolution cyclique des prix pour une mutation structurelle sur le marché de l’énergie.
J’ai vécu un exemple saisissant de cette situation contradictoire et floue des marchés de l’énergie, en juillet 2006. Le 13 juillet, les présidents de la Turquie, de la Géorgie, de l’Azerbaïdjan, le Premier ministre de la Turquie et moi-même nous sommes rencontrés à Ceyhan, au sud-ouest de la Turquie, pour célébrer la mise en service officielle d’un des premiers grands projets d’ingénierie du xxie siècle : le pipeline Heydar Aliev entre la Caspienne et la Méditerranée.
Ce pipeline, et le développement associé en amont du champ offshore Azeri-Chirag-Guneshli en Azerbaïdjan qu’il a rendu possible, a constitué un extraordinaire projet. Il impliquait de gros risques, conçu plus d’une décennie auparavant dans un pays en guerre et qui connut un coup d’État au moment de la signature du contrat. Grand exploit technique, il s’étire sur plus de 1 600 kilomètres, des rives de la Caspienne au sud de Bakou, capitale de l’Azerbaïdjan – passant à certains endroits par des tunnels sous les rivières sur plus d’un kilomètre, traversant également par endroits, jusqu’à 2 500 mètres d’altitude, les montagnes de Géorgie et de l’est de la Turquie –, jusqu’aux rives de la Méditerranée. Ce pipeline représente un changement substantiel en matière d’approvisionnement en énergie : il ouvre une nouvelle route de commerce et un nouveau bassin, et connecte le sud de la Caspienne au marché mondial. À pleine capacité, il livrera plus d’un million de barils par jour (Mb/j) supplémentaires au marché mondial, et pourra couvrir, sur les trois prochaines années, plus d’un quart de la croissance attendue de la demande pétrolière mondiale. […]
PLAN DE L’ARTICLE
- Des inquiétudes multiples
- Des préoccupations fondées
- Des peurs infondées
- Quelles solutions ?
John Browne a débuté sa carrière en 1966 au sein du groupe BP, où il a successivement exercé des fonctions variées dans l’exploration, la production et la finance, aux États-Unis, en Grande-Bretagne et au Canada. Il a été nommé directeur exécutif de BP en 1991 et Group Chief Executive en 1995. Il est également directeur non exécutif d’Intel Corporation et du groupe Goldman Sachs. Il a reçu le titre de Chevalier en 1998 et a été nommé pair à vie à la Chambre des Lords en 2001.

Contenu disponible en :
Régions et thématiques
Utilisation
Comment citer cette publicationPartager
Téléchargez l'analyse complète
Cette page ne contient qu'un résumé de notre travail. Si vous souhaitez avoir accès à toutes les informations de notre recherche sur le sujet, vous pouvez télécharger la version complète au format PDF.
L'avenir de l'énergie
Centres et programmes liés
Découvrez nos autres centres et programmes de rechercheEn savoir plus
Découvrir toutes nos analysesLe Bangladesh entre crise politique et montée de l'islamisme
Le mouvement « Students Against Discrimination », à l'origine des manifestations de l'été 2024, a cristallisé le mécontentement d'une jeunesse confrontée à la réinstauration d'un quota controversé pour les descendants des muktijoddhas (les « combattants pour la liberté » de la guerre d'indépendance de 1971), après quinze années de dérive autoritaire de la Première ministre Sheikh Hasina.
Avant-propos
Dans ce numéro spécial de Politique étrangère consacré aux actes de la Conférence organisée par l'Ifri le 10 avril 2019 au Grand amphithéâtre de la Sorbonne, à l'occasion de son quarantième anniversaire, découvrez l'avant-propos de Thierry de Montbrial, fondateur et président de l'Ifri.
Avant-propos
Dans ce numéro spécial de Politique étrangère consacré aux actes de la Conférence organisée par l'Ifri le 10 avril 2019 au Grand amphithéâtre de la Sorbonne, à l'occasion de son quarantième anniversaire, découvrez l'avant-propos de Thierry de Montbrial, fondateur et président de l'Ifri.
L'Europe et l'Afrique
Dans ce numéro spécial de Politique étrangère consacré aux actes de la Conférence organisée par l'Ifri le 10 avril 2019 au Grand amphithéâtre de la Sorbonne, à l'occasion de son quarantième anniversaire, découvrez l'entretien entre Thierry de Montbrial, fondateur et président de l'Ifri et Louise Mushikiwabo, ancienne ministre des Affaires étrangères du Rwanda, secrétaire générale de La Francophonie.










