Climat et longue durée : la variable vendémiologique
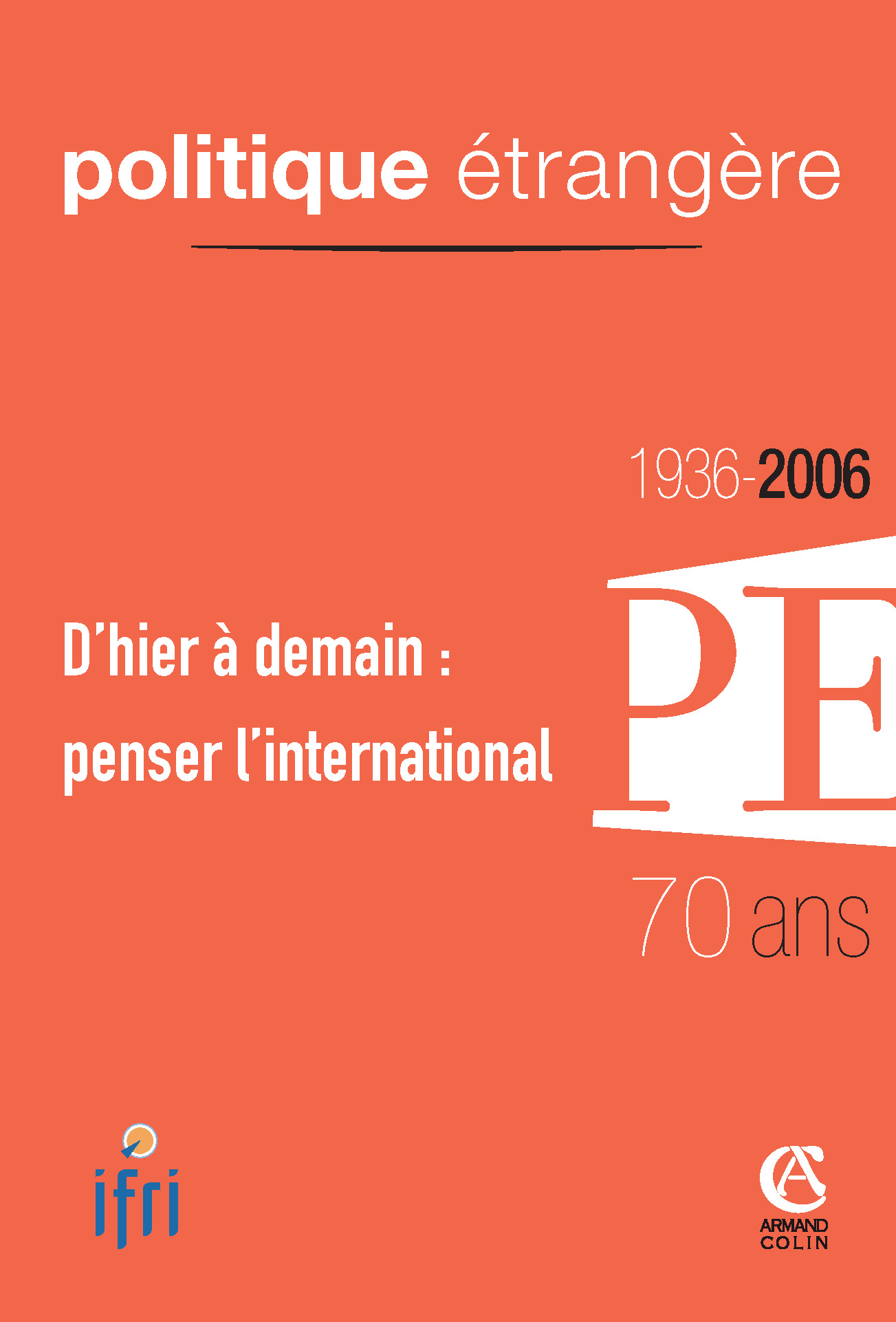
On peut, à travers l’histoire des vendanges, approcher une histoire plus générale des climats, particulièrement en Europe. Cette histoire, alternance de réchauffements et de refroidissements saisonniers, peut aussi être mise en relation avec l’histoire économique, et donc politique, de nos pays : du XIVᵉ siècle jusqu’au réchauffement global qui débute au seuil du XXᵉ siècle et prend aujourd’hui des formes que seul peut appréhender le météorologiste.

Des recherches collectives sur les dates de vendanges permettent de résumer ici quelques conclusions chronologiques désormais obtenues sur l’histoire du climat ouest-européen. On s’inspirera également dans ces développements d’un ouvrage récent, Histoire humaine et comparée du climat, pour examiner le dernier millénaire.
Avant 1370 : la période pré-vendémiologique
Deux mots d’abord sur le XIIIᵉ siècle, époque d’un petit optimum médiéval. C’est à tout le moins un phénomène régional qui vaut, semble-t-il, pour l’Europe occidentale et centrale, de la Scandinavie aux Alpes et peut-être au-delà, avec des glaciers alpins assez rétrécis de 900 apr. J.-C. à 1250 ou 1300. Le XIIIᵉ siècle est donc pourvu de beaux étés secs, souvent chauds, ce qui lui donnerait une température à peu près comparable à celle de notre XXᵉ siècle, légèrement réchauffé lui aussi. Les étés sont défavorables aux céréales quand ils sont brûlants – c’est l’échaudage en 2003 ou en 1420. En général, s’ils ne sont pas trop brûlants ni surtout trop secs, ils sont favorables au blé : d’où peut-être une contribution du climat à l’émergence d’un beau XIIIᵉ siècle de croissance économique, à l’âge gothique – époque de Saint-Louis. Une croissance qui a, bien sûr, nombre d’autres déterminants, non climatiques, eux. Viendrait ensuite un certain rafraîchissement au XIVᵉ siècle, à partir de 1300-1303 inclusivement. On pourrait parler d’un petit âge glaciaire, expression valable pour l’Europe occidentale où les glaciers alpins sont effectivement à leur maximum au XIVᵉ siècle ; mais petit, car l’expression d’âge glaciaire ne vaut pas nécessairement pour l’ensemble de la planète. À partir de 1303, des hivers froids se succèdent, bien diagnostiqués par Christian Pfister, avec également des étés frais. D’où l’émergence de la Grande Famine, due en particulier à l’excès des précipitations de 1314-1315, date qui marque souvent la fin du beau Moyen Âge, avant même la peste noire de 1348. [...]
PLAN DE L’ARTICLE
- Avant 1370 : la période pré-vendémiologique
- Après 1370 : la période vendémiologique
- XVIIIᵉ siècle : le chaud et froid…
- Un XIXᵉ siècle globalement froid
- Un retour du réchauffement
Emmanuel Le Roy Ladurie, docteur honoris causa de 18 universités, a été professeur à l’École pratique des hautes études, à la Sorbonne, puis au Collège de France. Ancien administrateur général de la Bibliothèque nationale de France, il est membre de l’Institut. Il a, entre autres ouvrages, publié une Histoire du climat depuis l’an mil (Paris, Flammarion, 1983) et une Histoire humaine et comparée du climat en Occident en 2 tomes (Paris, Fayard, 2004-2006).

Contenu disponible en :
Régions et thématiques
Utilisation
Comment citer cette publicationPartager
Téléchargez l'analyse complète
Cette page ne contient qu'un résumé de notre travail. Si vous souhaitez avoir accès à toutes les informations de notre recherche sur le sujet, vous pouvez télécharger la version complète au format PDF.
Climat et longue durée : la variable vendémiologique
En savoir plus
Découvrir toutes nos analysesL'Europe et l'Afrique
Dans ce numéro spécial de Politique étrangère consacré aux actes de la Conférence organisée par l'Ifri le 10 avril 2019 au Grand amphithéâtre de la Sorbonne, à l'occasion de son quarantième anniversaire, découvrez l'entretien entre Thierry de Montbrial, fondateur et président de l'Ifri et Louise Mushikiwabo, ancienne ministre des Affaires étrangères du Rwanda, secrétaire générale de La Francophonie.
Conclusions
Dans ce numéro spécial de Politique étrangère consacré aux actes de la Conférence organisée par l'Ifri le 10 avril 2019 au Grand amphithéâtre de la Sorbonne, à l'occasion de son quarantième anniversaire, découvrez l'allocution de Jean-Yves Le Drian, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères.
Nouveaux défis mondiaux et sécurité européenne
Dans ce numéro spécial de Politique étrangère consacré aux actes de la Conférence organisée par l'Ifri le 10 avril 2019 au Grand amphithéâtre de la Sorbonne, à l'occasion de son quarantième anniversaire, découvrez le débat animé par Nicole Gnesotto entre Wolfgang Ischinger, Jean-Marie Guéhenno, Julian King et Hubert Védrine.
Les industriels face aux nouveaux protectionnismes
Dans ce numéro spécial de Politique étrangère consacré aux actes de la Conférence organisée par l'Ifri le 10 avril 2019 au Grand amphithéâtre de la Sorbonne, à l'occasion de son quarantième anniversaire, découvrez le débat animé par Thierry de Montbrial entre Jean-Paul Agon et Patrick Pouyanné.







