L' « Europe de la sécurité intérieure », cette inconnue - Politique étrangère, vol. 90, n° 2, été 2025
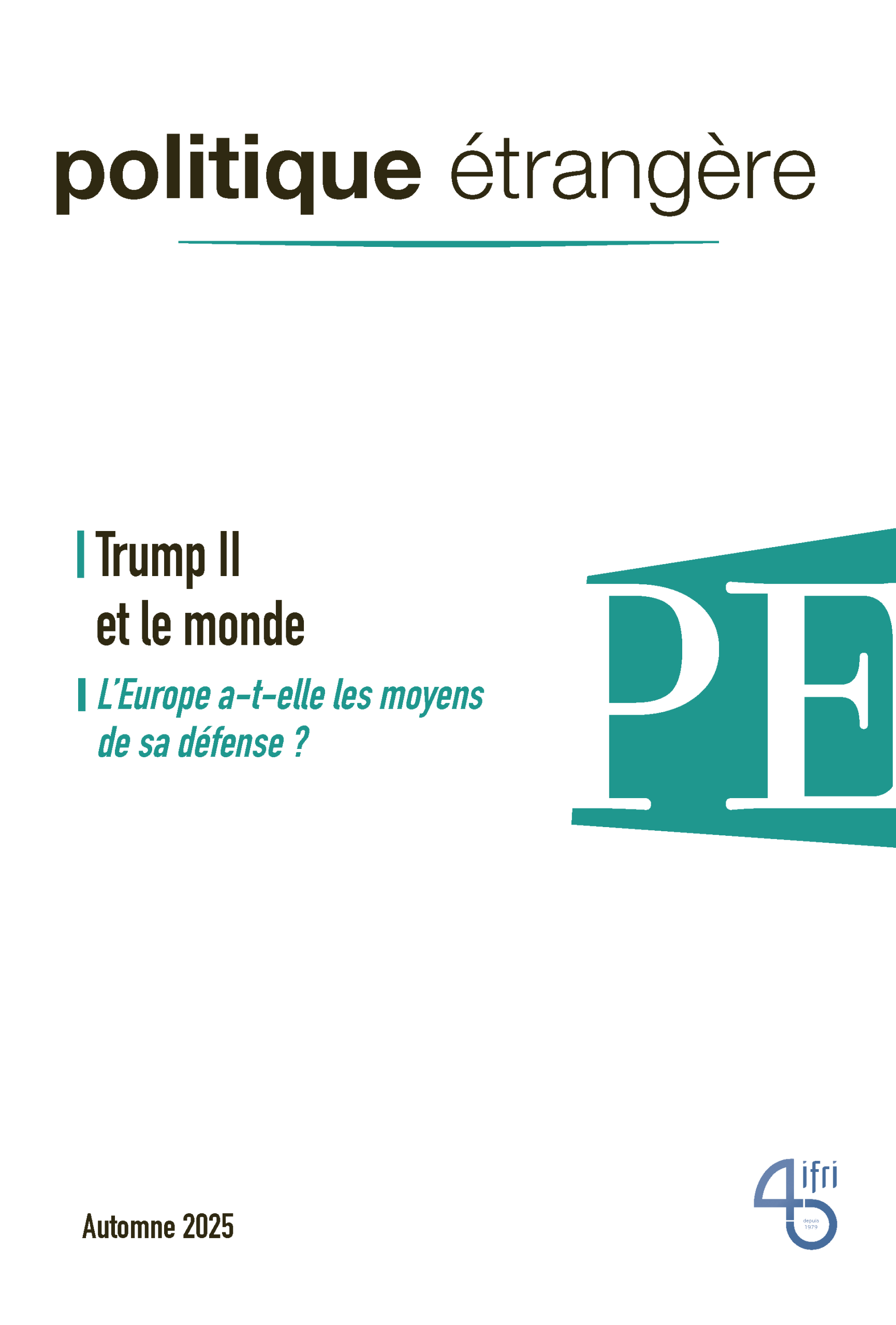
La nouvelle stratégie européenne de sécurité intérieure, dévoilée par la Commission en avril 2025, offre l'occasion d'attirer l'attention sur une politique méconnue. Pour limiter les écueils de la liberté de circulation, la politique européenne de sécurité intérieure a été significativement étoffée au cours des dernières années. L'Union européenne ne cesse de se renforcer pour mieux lutter contre la criminalité, le terrorisme, l'immigration illégale ou encore les menaces hybrides.

Jean Mafart est préfet. Il a notamment été directeur des affaires européennes et internationales du ministère de l'Intérieur. Il est l'auteur de La Politique européenne de sécurité intérieure (Bruxelles, Bruylant, à paraître en 2025).
Article publié dans Politique étrangère, vol. 90, n° 2, été 2025.
« Alors que la Commission a publié en avril 2025 sa nouvelle stratégie de sécurité intérieure, un constat s'impose : la politique européenne de sécurité intérieure reste méconnue. Si l'« Europe de la sécurité intérieure » reste aussi peu visible, c'est sans doute parce que nous continuons d'associer la sécurité – compétence « régalienne » par excellence – au cœur des missions de l'État. Pourtant, si les traités européens reconnaissent bien cette responsabilité étatique, l'Union européenne (UE) est aussi très active et la faible notoriété de sa politique de sécurité peut surprendre pour au moins deux raisons.
La première est que l'Union affecte à cette politique des moyens considérables, qui ne cessent de croître. Le budget de l'agence Europol, chargée d'appuyer les États membres dans la lutte contre la criminalité, a quadruplé en vingt ans et les effectifs de l'agence Frontex aux frontières extérieures seront bientôt de 10000, en comptant la réserve européenne. Ce n'est pas tout : la nouvelle stratégie de sécurité intérieure confirme le doublement du budget d'Europol et le triplement des effectifs de gardes-frontières européens – propositions annoncées par la présidente Ursula von der Leyen au début de son second mandat et passées inaperçues en France, en dépit de leur ampleur spectaculaire.
La politique européenne de sécurité intérieure, en second lieu, répond à des attentes sociales fortes : il y aurait sans doute matière – ce n'est pas si fréquent – à montrer aux citoyens une Europe concrète et directement utile dans leur vie quotidienne. Coopération policière, coopération pénale et sécurité des frontières constituent désormais une politique européenne à part entière, dont les effets sont souvent très tangibles.
Est-ce à dire que tout cela fonctionne bien ? Non, certainement, et c'est ce qui conduit à une question essentielle : en ces temps de recul de l'idée européenne, les carences réelles de l'« Europe de la sécurité intérieure » doivent-elles nous inciter à la consolider, comme ce serait le plus logique, ou à nous replier dans la sécurité apparente de nos frontières nationales ? [...] »

Contenu disponible en :
Thématiques et régions
Utilisation
Comment citer cette publicationPartager
Téléchargez l'analyse complète
Cette page ne contient qu'un résumé de notre travail. Si vous souhaitez avoir accès à toutes les informations de notre recherche sur le sujet, vous pouvez télécharger la version complète au format PDF.
L' « Europe de la sécurité intérieure », cette inconnue - Politique étrangère, vol. 90, n° 2, été 2025
En savoir plus
Découvrir toutes nos analysesL'Europe et l'Afrique
Dans ce numéro spécial de Politique étrangère consacré aux actes de la Conférence organisée par l'Ifri le 10 avril 2019 au Grand amphithéâtre de la Sorbonne, à l'occasion de son quarantième anniversaire, découvrez l'entretien entre Thierry de Montbrial, fondateur et président de l'Ifri et Louise Mushikiwabo, ancienne ministre des Affaires étrangères du Rwanda, secrétaire générale de La Francophonie.
Conclusions
Dans ce numéro spécial de Politique étrangère consacré aux actes de la Conférence organisée par l'Ifri le 10 avril 2019 au Grand amphithéâtre de la Sorbonne, à l'occasion de son quarantième anniversaire, découvrez l'allocution de Jean-Yves Le Drian, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères.
Nouveaux défis mondiaux et sécurité européenne
Dans ce numéro spécial de Politique étrangère consacré aux actes de la Conférence organisée par l'Ifri le 10 avril 2019 au Grand amphithéâtre de la Sorbonne, à l'occasion de son quarantième anniversaire, découvrez le débat animé par Nicole Gnesotto entre Wolfgang Ischinger, Jean-Marie Guéhenno, Julian King et Hubert Védrine.
Les industriels face aux nouveaux protectionnismes
Dans ce numéro spécial de Politique étrangère consacré aux actes de la Conférence organisée par l'Ifri le 10 avril 2019 au Grand amphithéâtre de la Sorbonne, à l'occasion de son quarantième anniversaire, découvrez le débat animé par Thierry de Montbrial entre Jean-Paul Agon et Patrick Pouyanné.








