Le système mondial : réalité et crise
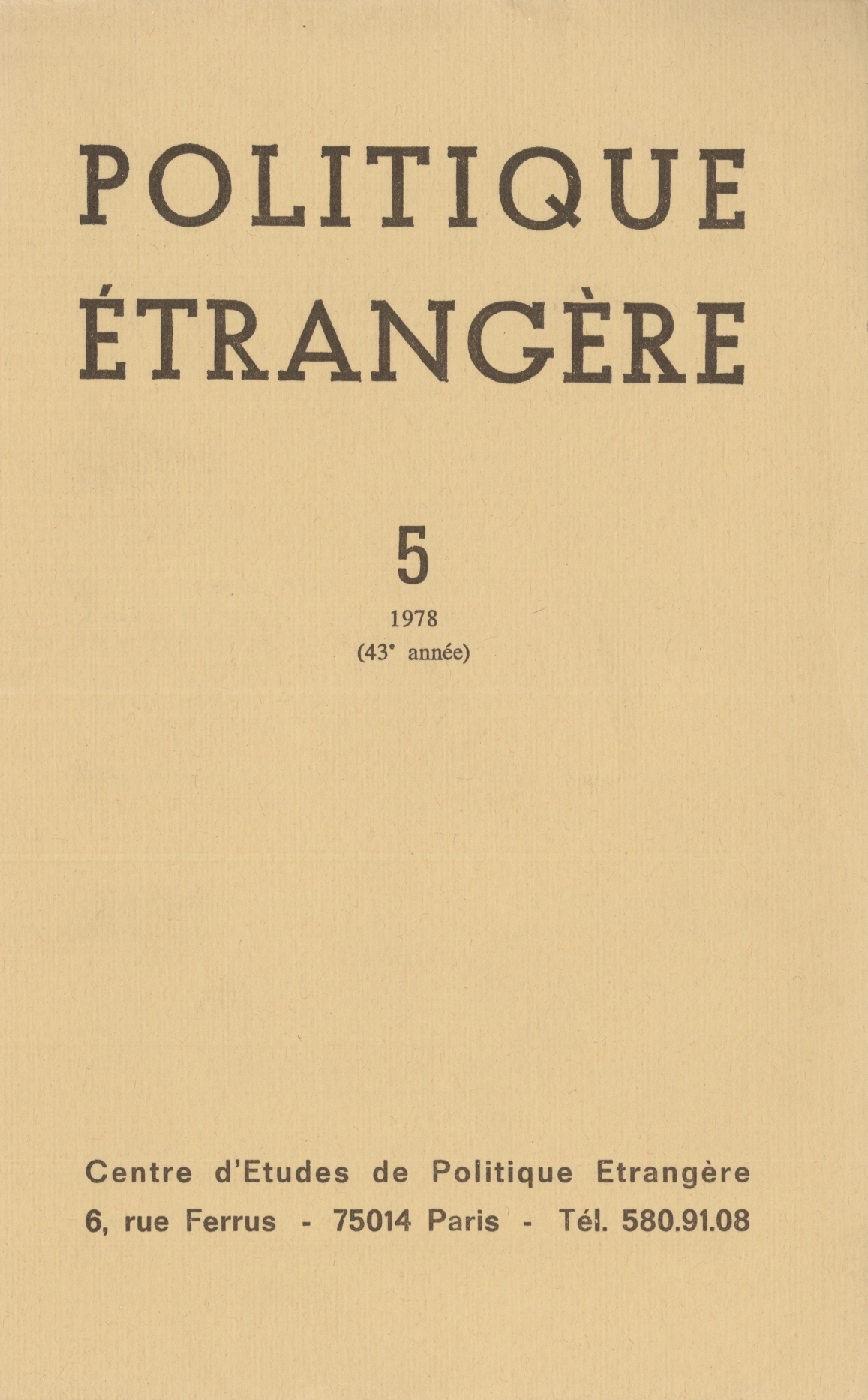
Marcel Merle (1923-2003) a été un des pionniers de l'étude des relations internationales en France. Agrégé de droit public en 1950, il s'engage dans une carrière universitaire. Il a notamment été directeur de l'Institut d'études politiques de Bordeaux et professeur à l'Université Paris 1. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages de référence dont Sociologie des relations internationales (1974) et La Politique étrangère (1984).
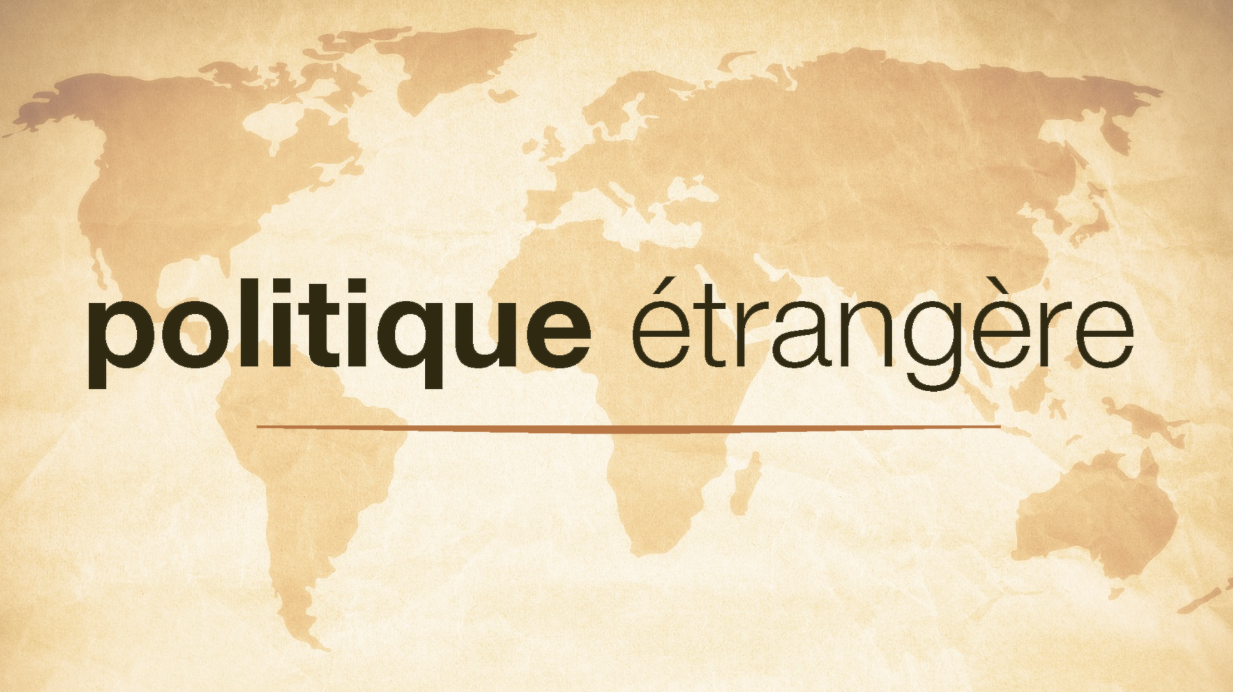
Ce bref exposé introductif n'a pas d'autre objet que de planter le décor qui doit servir de toile de fond à nos débats. Il ne prétend nullement présenter un tableau exhaustif ni, surtout, définitif de la situation mondiale. Mais il permettra peut-être, par les réactions qu'il provoquera, de dégager le minimum d'accord nécessaire à l'interprétation correcte des problèmes locaux ou régionaux qui intéressent plus directement les participants au Colloque.
Les réactions à prévoir sont d'autant plus normales que le point de vue présenté en guise d'introduction sera forcément empreint de subjectivité. Contrairement à une opinion assez répandue, le point de vue de Sirius n'existe pas. Existerait-il, qu'il serait d'ailleurs partiel et falsifié puisqu'il ne pourrait prendre en compte ce qui se passe du côté de la « face cachée de la terre ». Tout observateur est situé, topographiquement, politiquement et idéologiquement, quels que soient ses efforts en vue d'atteindre à l'objectivité. Le seul point commun entre tous les participants réside dans la simultanéité des points de vue. Mais la coïncidence dans le temps ne suffira certainement pas à abolir la diversité des appréciations. Cette diversité constituant une richesse, il importe que les propos émis au début du Colloque ne soient pas traités comme des conclusions mais comme des propositions à débattre.
Pourquoi placer ces réflexions sous le vocable de « système » ? La question n'est pas indifférente. Pour qualifier le même exercice, on se serait contenté, autrefois, de parler d'analyse de situation. Dans une certaine mesure, il est vrai que l'utilisation du terme de système constitue une certaine concession à la mode : chacun sait que la théorie des systèmes connaît actuellement une grande vogue, et certains croient pouvoir, en se parant de ce vocable, donner plus de poids à leurs opinions. S'il ne s'agissait que de cela, mieux vaudrait renoncer à l'usage d'un terme qui n'aurait pas d'autre valeur que celle d'une étiquette ou d'une couche de peinture. Dans mon esprit, le terme de système est un outil de travail qui a déjà le mérite de nous dispenser d'utiliser d'autres concepts beaucoup trop ambitieux (comme celui de « société internationale ») ou beaucoup trop vagues (comme celui de « relations internationales »). En dehors de cette vertu négative, le temps de système a l'avantage de nous astreindre à rechercher, dans la confusion que nous offre le spectacle de la réalité, un minimum de cohérence dans la configuration des forces et dans le mode de fonctionnement des relations entre ces forces.
A partir de cette incitation, il est possible d'établir rapidement l'existence d'un système international pour mieux analyser ensuite la nature et la signification de la crise qui affecte actuellement la vie de ce système.
PLAN DE L'ARTICLE
I. La réalité du système mondial
II. La "crise" du système mondial
Conclusion

Contenu disponible en :
Régions et thématiques
Utilisation
Comment citer cette publicationPartager
Téléchargez l'analyse complète
Cette page ne contient qu'un résumé de notre travail. Si vous souhaitez avoir accès à toutes les informations de notre recherche sur le sujet, vous pouvez télécharger la version complète au format PDF.
Le système mondial : réalité et crise
En savoir plus
Découvrir toutes nos analysesLe Bangladesh entre crise politique et montée de l'islamisme
Le mouvement « Students Against Discrimination », à l'origine des manifestations de l'été 2024, a cristallisé le mécontentement d'une jeunesse confrontée à la réinstauration d'un quota controversé pour les descendants des muktijoddhas (les « combattants pour la liberté » de la guerre d'indépendance de 1971), après quinze années de dérive autoritaire de la Première ministre Sheikh Hasina.
Avant-propos
Dans ce numéro spécial de Politique étrangère consacré aux actes de la Conférence organisée par l'Ifri le 10 avril 2019 au Grand amphithéâtre de la Sorbonne, à l'occasion de son quarantième anniversaire, découvrez l'avant-propos de Thierry de Montbrial, fondateur et président de l'Ifri.
Avant-propos
Dans ce numéro spécial de Politique étrangère consacré aux actes de la Conférence organisée par l'Ifri le 10 avril 2019 au Grand amphithéâtre de la Sorbonne, à l'occasion de son quarantième anniversaire, découvrez l'avant-propos de Thierry de Montbrial, fondateur et président de l'Ifri.
L'Europe et l'Afrique
Dans ce numéro spécial de Politique étrangère consacré aux actes de la Conférence organisée par l'Ifri le 10 avril 2019 au Grand amphithéâtre de la Sorbonne, à l'occasion de son quarantième anniversaire, découvrez l'entretien entre Thierry de Montbrial, fondateur et président de l'Ifri et Louise Mushikiwabo, ancienne ministre des Affaires étrangères du Rwanda, secrétaire générale de La Francophonie.








