Les efforts d'organisation mondiale au XXe siècle : mythes et réalités
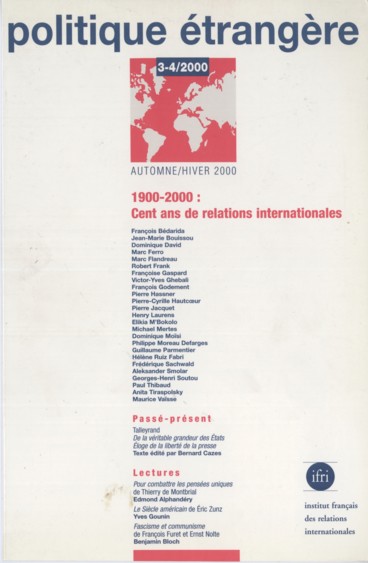
Le développement continu de l’organisation internationale est l’un des faits marquants du XXe siècle. Aucun secteur des relations internationales n’a échappé à ce phénomène et, même si l’invention de l’organisation internationale est plus ancienne, on peut créditer le siècle qui s’achève de lui avoir donné un nouveau visage : mondiale, régionale, supranationale ou transnationale, l’organisation internationale présente aujourd’hui des traits aussi affirmés que divers. Cela étant dit, l’interprétation de ce phénomène universel demeure ambiguë, et la floraison des problématiques et des concepts juridiques a fini par diluer la notion d’organisation internationale dans celles, parfois « fourre-tout », de régime ou de « gouvernance globale ». Sans pour autant que soit assuré l’essentiel : la compréhension homogène des principes affichés et la volonté d’agir en commun pour assurer leur respect.
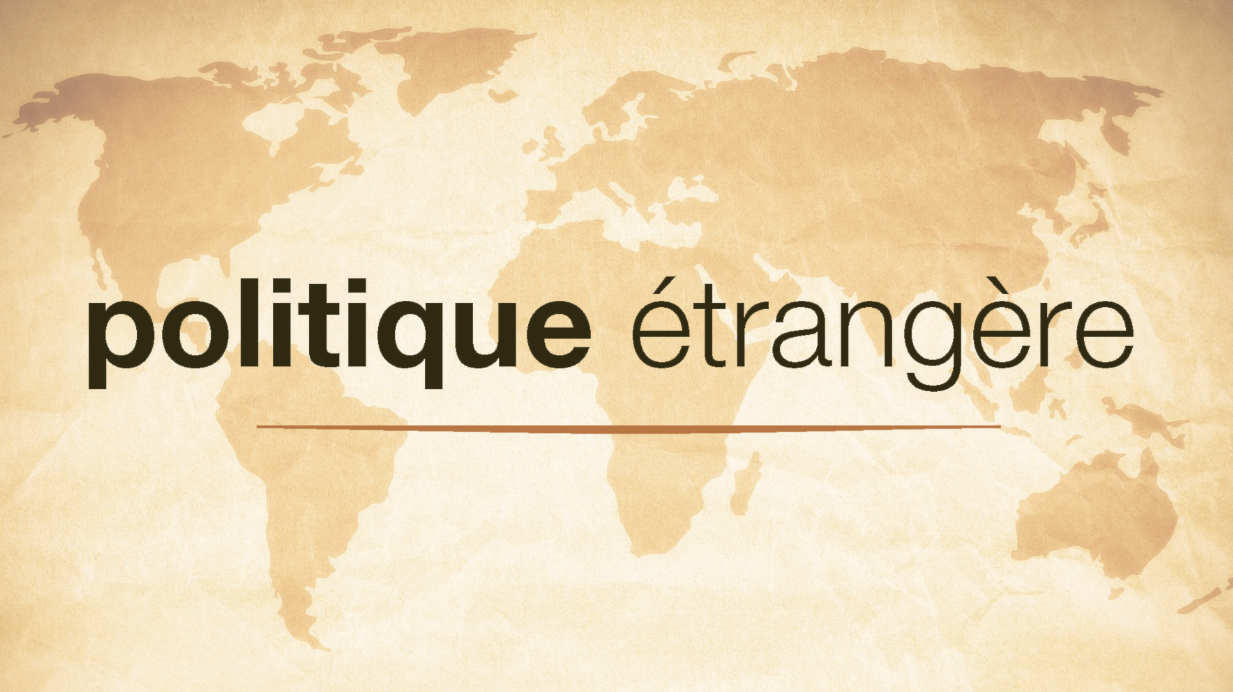
Parmi les multiples traits du XXe siècle, le développement continu du phénomène de l'organisation internationale - entendu, d'un point de vue très général, comme toute forme de coopération multilatérale intergouvernementale ou transnationale de type institutionnalisé ou non - figure en bonne place. Nul secteur des rapports internationaux ou transnationaux n'a pratiquement échappé à l'emprise de ce phénomène, si bien que la coïncidence entre le champ des relations internationales et celui des institutions internationales peut être considérée comme asymptotique pour ne pas dire totale. S'agissant des institutions intergouvernementales, celles-ci exercent aujourd'hui une variété impressionnante de fonctions qui s'étendent de la formulation et du contrôle du respect de normes universelles à la légitimation (ou délégitimation) collective de certains comportements nationaux, de la gestion des conflits inter ou intra- étatiques à la prestation aux États-nations de services opérationnels en matière économique, sociale, culturelle et humanitaire. Dans le cas particulier de la Communauté/Union européenne, ces fonctions ne se limitent pas à l'harmonisation des politiques nationales ; elles vont jusqu'à la prise en charge directe de certains secteurs d'activités partiellement ou totalement soustraits à la souveraineté des États-membres.
Le XXe siècle - la période qui s'ouvre avec le déclenchement de la Première Guerre mondiale (1914) et se clôt avec la chute du mur de Berlin (1989) - n'a cependant pas « inventé » l'organisation internationale. D'une part, les projets d'institutionnalisation des rapports internationaux procèdent d'un courant d'idées qui remonte au XIVe siècle et se prolonge jusqu'aux conférences de La Haye de 1 899 et 1907. D'autre part, l'ère des organisations intergouvernementales a commencé au XIXe siècle avec les interventions intermittentes du Concert européen (1815-1914) ainsi qu'avec les activités régulières des commissions fluviales et des unions internationales. Cela étant, le XXe siècle peut être crédité de quatre apports principaux en la matière. Représenté par la création de la Société des Nations (SDN) puis de l'Organisation des Nations unies (ONU), le premier est capital : il s'agit de l'avènement de P« organisation mondiale », c'est-à-dire d'une entité à vocation universelle et à mandat global (sécurité collective et coopération spécialisée) coiffant les activités d'un certain nombre d'institutions spécialisées. Le phénomène du régionalisme, illustré par le développement d'organisations subrégionales, régionales et transrégionales collaborant de manière plus ou moins souple et fréquente avec l'ensemble systémique constitué par l'organisation mondiale, représente le deuxième apport. Lié au supranational — terme aujourd'hui dévalué -, le troisième apport s'est traduit par l'émergence d'un type d'organisation particulièrement avancé dit d'« intégration ». [...]
PLAN DE L'ARTICLE
- La SDN : autopsie d'un échec global
- Les Nations unies : radioscopie d'un perpetuum mobile
- Conclusion
Victor-Yves Ghebali est professeur à l’Institut universitaire de hautes études internationales (IUHEI) de Genève.

Contenu disponible en :
Régions et thématiques
Utilisation
Comment citer cette publicationPartager
Téléchargez l'analyse complète
Cette page ne contient qu'un résumé de notre travail. Si vous souhaitez avoir accès à toutes les informations de notre recherche sur le sujet, vous pouvez télécharger la version complète au format PDF.
Les efforts d'organisation mondiale au XXe siècle : mythes et réalités
En savoir plus
Découvrir toutes nos analysesLe Bangladesh entre crise politique et montée de l'islamisme
Le mouvement « Students Against Discrimination », à l'origine des manifestations de l'été 2024, a cristallisé le mécontentement d'une jeunesse confrontée à la réinstauration d'un quota controversé pour les descendants des muktijoddhas (les « combattants pour la liberté » de la guerre d'indépendance de 1971), après quinze années de dérive autoritaire de la Première ministre Sheikh Hasina.
Avant-propos
Dans ce numéro spécial de Politique étrangère consacré aux actes de la Conférence organisée par l'Ifri le 10 avril 2019 au Grand amphithéâtre de la Sorbonne, à l'occasion de son quarantième anniversaire, découvrez l'avant-propos de Thierry de Montbrial, fondateur et président de l'Ifri.
Avant-propos
Dans ce numéro spécial de Politique étrangère consacré aux actes de la Conférence organisée par l'Ifri le 10 avril 2019 au Grand amphithéâtre de la Sorbonne, à l'occasion de son quarantième anniversaire, découvrez l'avant-propos de Thierry de Montbrial, fondateur et président de l'Ifri.
L'Europe et l'Afrique
Dans ce numéro spécial de Politique étrangère consacré aux actes de la Conférence organisée par l'Ifri le 10 avril 2019 au Grand amphithéâtre de la Sorbonne, à l'occasion de son quarantième anniversaire, découvrez l'entretien entre Thierry de Montbrial, fondateur et président de l'Ifri et Louise Mushikiwabo, ancienne ministre des Affaires étrangères du Rwanda, secrétaire générale de La Francophonie.








