Quelle orientation future pour l'OTAN ?
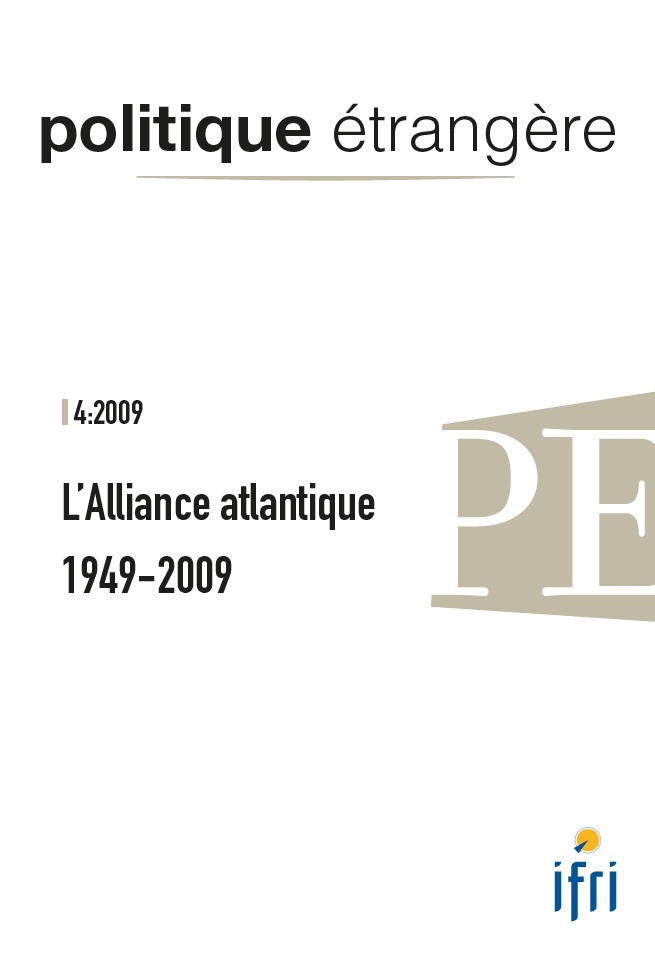
L’orientation future de l’Alliance dépend de la réponse à deux questions : quels sont aujourd’hui les défis de sécurité pour les États-membres ; et quels sont ceux que peut traiter l’Alliance ? On examine ici quatre hypothèses, qui pourraient organiser le débat sur le futur concept stratégique : la focalisation sur le Grand Moyen-Orient, une attention centrale portée aux États fragiles, la focalisation sur les menaces non gouvernementales, ou un recentrage sur l’Europe.

L’Organisation du traité de l’Atlantique nord (OTAN) est sur la défensive, chancelante en Afghanistan, divisée sur la Russie, incertaine sur l’Iran et sur une foule d’autres problèmes de sécurité. Les doutes sur le futur de l’Alliance se multiplient – ce qui n’est pas une première, noteront les observateurs avertis. La réécriture du concept stratégique, élément qui se trouve au cœur de la stratégie de l’OTAN, est aujourd’hui une chance de revitaliser l’Alliance en redéfinissant ses buts futurs. Le secrétaire général de l’OTAN, Anders Fogh Rasmussen, a constitué une équipe d’experts, avec à sa tête un ancien secrétaire d’État américain, pour s’atteler à la tâche. Celle-ci n’est pas aisée. Le consensus au sein de l’Alliance se trouve désormais à un niveau historiquement bas. Non seulement l’OTAN regroupe deux fois plus de membres que la dernière fois qu’il s’est agi de réécrire le concept stratégique, mais la nature même des problèmes de sécurité auxquels ses membres sont confrontés est manifestement devenue beaucoup plus complexe.
Se concentrer sur les problèmes communs
Fondamentalement, la question qui devrait déterminer la révision du concept stratégique et la réflexion sur le futur de l’OTAN en général devrait être la suivante : comment l’Alliance peut-elle répondre au mieux aux problèmes de sécurité communs de ses États membres ? Cette question en suggère deux autres, complémentaires : quels sont les défis de sécurité les plus pressants auxquels font face les États membres ? Et quels sont ceux que l’OTAN pourrait aider à gérer, si elle devait décider de le faire ? En d’autres termes, il est crucial que le processus de mise au point du nouveau concept se focalise essentiellement sur les menaces et les problèmes rencontrés par les États membres, et non sur les problèmes internes de l’OTAN. La réponse à ces derniers dépend largement de l’analyse des menaces. L’élaboration du nouveau concept ne doit pas avoir pour objectif de « sauver l’OTAN », mais d’identifier et d’articuler une vision cohérente de la manière dont l’OTAN peut garantir la sécurité des pays membres dans un environnement global qui ne cesse de se métamorphoser. Les multiples idées toutes faites sur ce qu’est l’OTAN, sur ce qu’elle n’est pas, ou ne peut pas faire, doivent donc être passées au crible de constats réalistes sur ses objectifs et ses moyens. [...]
PLAN DE L’ARTICLE
- Se concentrer sur les problèmes communs
- L’art de la cohérence
- Les défis intellectuels
- Les futures orientations
- L’Alliance dans le Grand Moyen-Orient
- L’Alliance et les États fragiles
- L’Alliance et les menaces non gouvernementales - Le noyau européen de l’Alliance
- Le défi à venir
Christopher S. Chivvis est chercheur à la RAND Corporation et professeur adjoint à la Johns Hopkins School of Advanced International Studies (SAIS).
Texte traduit de l’anglais (Etats-Unis) par Gregory Danel.

Contenu disponible en :
Thématiques et régions
Utilisation
Comment citer cette publicationPartager
Téléchargez l'analyse complète
Cette page ne contient qu'un résumé de notre travail. Si vous souhaitez avoir accès à toutes les informations de notre recherche sur le sujet, vous pouvez télécharger la version complète au format PDF.
Quelle orientation future pour l'OTAN ?
En savoir plus
Découvrir toutes nos analysesLe Bangladesh entre crise politique et montée de l'islamisme
Le mouvement « Students Against Discrimination », à l'origine des manifestations de l'été 2024, a cristallisé le mécontentement d'une jeunesse confrontée à la réinstauration d'un quota controversé pour les descendants des muktijoddhas (les « combattants pour la liberté » de la guerre d'indépendance de 1971), après quinze années de dérive autoritaire de la Première ministre Sheikh Hasina.
Avant-propos
Dans ce numéro spécial de Politique étrangère consacré aux actes de la Conférence organisée par l'Ifri le 10 avril 2019 au Grand amphithéâtre de la Sorbonne, à l'occasion de son quarantième anniversaire, découvrez l'avant-propos de Thierry de Montbrial, fondateur et président de l'Ifri.
Avant-propos
Dans ce numéro spécial de Politique étrangère consacré aux actes de la Conférence organisée par l'Ifri le 10 avril 2019 au Grand amphithéâtre de la Sorbonne, à l'occasion de son quarantième anniversaire, découvrez l'avant-propos de Thierry de Montbrial, fondateur et président de l'Ifri.
L'Europe et l'Afrique
Dans ce numéro spécial de Politique étrangère consacré aux actes de la Conférence organisée par l'Ifri le 10 avril 2019 au Grand amphithéâtre de la Sorbonne, à l'occasion de son quarantième anniversaire, découvrez l'entretien entre Thierry de Montbrial, fondateur et président de l'Ifri et Louise Mushikiwabo, ancienne ministre des Affaires étrangères du Rwanda, secrétaire générale de La Francophonie.









