Le débat sur une OTAN globale
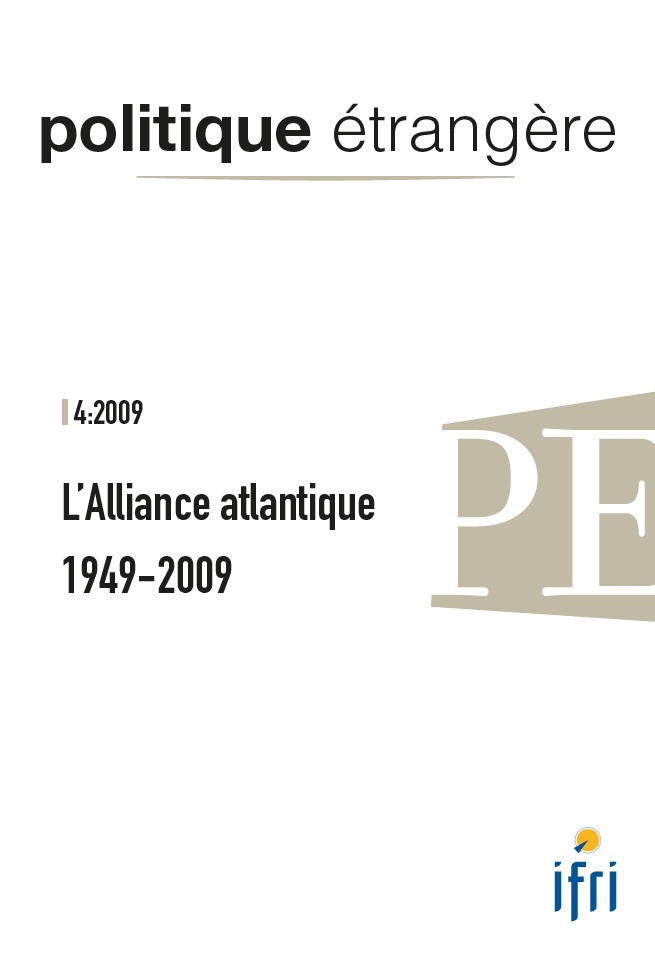
Le débat sur la « globalisation » est au cœur des échanges sur le nouveau concept stratégique. Il s’inscrit dans ce qui apparaît depuis 1994 comme une dynamique continue d’élargissements, des membres et des missions. Il renvoie également aux diverses lectures possibles de la réalité géopolitique présente : menaces globales, ou menaces rémanentes en Europe ? Il pose enfin une question morale : pourquoi et dans quelle circonstances l’Alliance est-elle légitime à user de sa force militaire ?

Le débat sur « l’OTAN globale » est arrivé à un tournant intellectuellement décisif, et il devra bientôt trouver une solution, le moment étant critique pour le choix de l’orientation future de l’organisation. Depuis le sommet de Bruxelles de 1994 qui a mis l’Organisation du traité de l’Atlantique nord (OTAN) de l’après-guerre froide sur le chemin de l’élargissement, le débat sur le rôle à venir de l’Alliance dans le monde a accompagné toutes ses décisions significatives. Tout comme la dissuasion nucléaire, l’OTAN fonctionne mieux en pratique qu’en théorie. L’Alliance elle-même, ses activités, fonctionnent en réalité via des arrangements ad hoc qui peuvent jusqu’à un certain point transcender les contradictions logiques et les anomalies de sa position. À peu de chose près, c’est ainsi que s’est développé le débat sur l’« OTAN globale » ; quelques assertions contradictoires sur la théorie selon laquelle l’OTAN devrait, ou pourrait agir mondialement, et, pratiquement, des choix politiques divers, réaffirmant la mission essentielle de l’OTAN en Europe, tout en l’engageant dans l’opération hors zone la plus périlleuse qu’on eût pu imaginer en 1994.
Il serait toutefois dangereux de considérer que cette question pourrait longtemps encore demeurer sans réponse. Avec 16 membres en 1994, l’OTAN représentait encore une opinion essentiellement ouest-européenne et nord-américaine. Avec 28 membres aujourd’hui, elle est devenue une organisation nettement plus paneuropéenne, embrassant un éventail d’intérêts de sécurité bien plus large. L’Alliance est aujourd’hui plus unie autour de valeurs et d’intérêts de long terme qu’autour de choix politiques et de besoins de sécurité immédiats, comme c’était hier le cas. L’Alliance concerne aujourd’hui environ 900 millions de citoyens, qui représentent 45 % du produit intérieur brut (PIB) mondial (mais seulement 13 % de la population du globe). Les nations membres de l’OTAN ont donc certes des intérêts mondiaux, mais il est tout aussi clair que le consensus est plus difficile à réaliser à 28.
Sous sa forme élargie, l’Alliance doit désormais définir un nouveau concept stratégique, 10 ans après l’adoption du dernier à Washington, en 1999. Celui-ci décrivait alors une Alliance prête à soutenir des opérations menées au nom des Nations unies, mettant « pleinement à profit » un tel partenariat pour éviter ou désamorcer les crises où qu’elles surgissent [1]. Un choix qui pouvait alors apparaître comme un engagement naturel au service de la stabilité internationale. Depuis lors, l’Alliance a vécu les attaques du 11 septembre et l’invocation concomitante de l’article 5 du traité de Washington, des conflits en Irak et en Afghanistan, la montée d’un leadership plus raide à Moscou, une guerre en Géorgie, et la crise économique mondiale. Tous événements susceptibles de fondamentalement modifier l’équation de sécurité des sociétés européennes et transatlantiques. Un renouveau des conceptions générales de la sécurité transatlantique et du rôle que peut y jouer l’OTAN se fait attendre depuis trop longtemps. Le nouveau concept stratégique tentera, dans l’année qui s’ouvre, d’apporter quelques réponses. Qu’il le fasse de manière satisfaisante ou non, la question du rôle de l’OTAN dans un contexte stratégique élargi – l’idée de « l’OTAN globale » – doit être envisagée vite, et clairement, tant par les experts que par les décideurs des pays de l’Alliance. [...]
PLAN DE L’ARTICLE
- La dynamique des choix de l’Alliance depuis 1994
- La dimension géopolitique
- La dimension éthique
- Le dilemme afghan
Michael Clarke est directeur du Royal United Services Institute for Defence and Security Studies (RUSI) de Londres. Jusqu’en 2007, il a été directeur du développement de la recherche au King’s College, où il était professeur invité pour les études de défense, et où il a fondé, puis dirigé, l’International Policy Institute (2001-2005).
Texte traduit de l’anglais (Royaume-Uni) par Thomas Richard.

Contenu disponible en :
Thématiques et régions
Utilisation
Comment citer cette publicationPartager
Téléchargez l'analyse complète
Cette page ne contient qu'un résumé de notre travail. Si vous souhaitez avoir accès à toutes les informations de notre recherche sur le sujet, vous pouvez télécharger la version complète au format PDF.
Le débat sur une OTAN globale
En savoir plus
Découvrir toutes nos analysesLe Bangladesh entre crise politique et montée de l'islamisme
Le mouvement « Students Against Discrimination », à l'origine des manifestations de l'été 2024, a cristallisé le mécontentement d'une jeunesse confrontée à la réinstauration d'un quota controversé pour les descendants des muktijoddhas (les « combattants pour la liberté » de la guerre d'indépendance de 1971), après quinze années de dérive autoritaire de la Première ministre Sheikh Hasina.
Avant-propos
Dans ce numéro spécial de Politique étrangère consacré aux actes de la Conférence organisée par l'Ifri le 10 avril 2019 au Grand amphithéâtre de la Sorbonne, à l'occasion de son quarantième anniversaire, découvrez l'avant-propos de Thierry de Montbrial, fondateur et président de l'Ifri.
Avant-propos
Dans ce numéro spécial de Politique étrangère consacré aux actes de la Conférence organisée par l'Ifri le 10 avril 2019 au Grand amphithéâtre de la Sorbonne, à l'occasion de son quarantième anniversaire, découvrez l'avant-propos de Thierry de Montbrial, fondateur et président de l'Ifri.
L'Europe et l'Afrique
Dans ce numéro spécial de Politique étrangère consacré aux actes de la Conférence organisée par l'Ifri le 10 avril 2019 au Grand amphithéâtre de la Sorbonne, à l'occasion de son quarantième anniversaire, découvrez l'entretien entre Thierry de Montbrial, fondateur et président de l'Ifri et Louise Mushikiwabo, ancienne ministre des Affaires étrangères du Rwanda, secrétaire générale de La Francophonie.








