La France et l'Allemagne face aux enjeux de la politique sociale de l'Union européenne
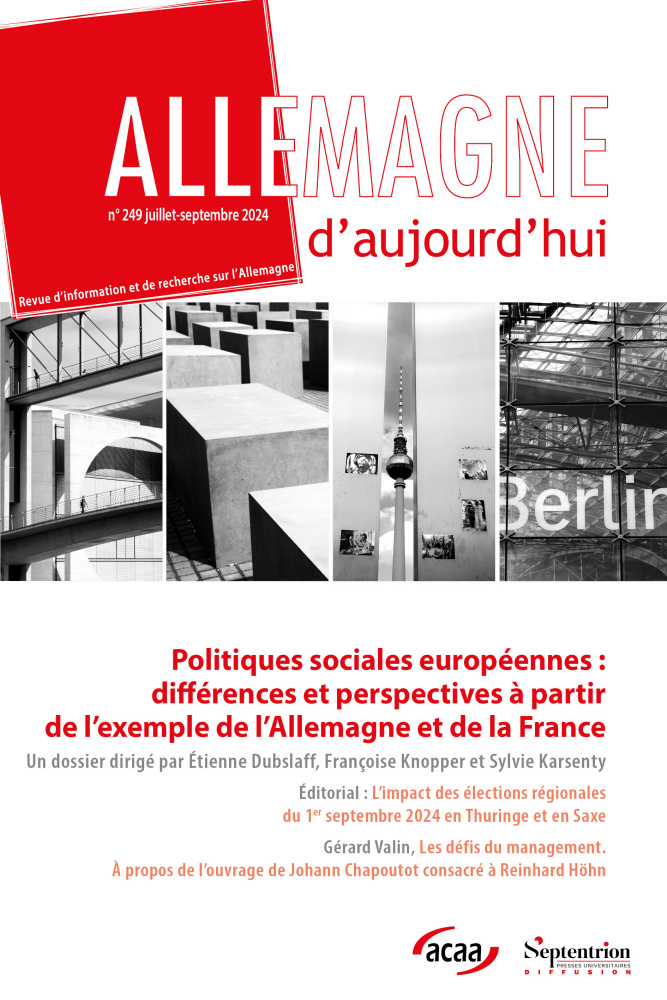
Depuis la signature des Traités de Rome en 1957, la dimension sociale de la construction européenne s'est progressivement imposée dans les négociations entre les États membres et elle fait aujourd'hui partie intégrante de l'acquis communautaire.

Toutefois, elle joue toujours un rôle plutôt secondaire à l'échelle de l'Union. Les domaines prioritaires de l'intégration au niveau économique sont l'union douanière, le marché intérieur ainsi que l'union économique et monétaire. La politique sociale de l'UE consistait plutôt à amortir les effets négatifs de l'intégration commerciale, économique et monétaire qu'à infléchir une philosophie économique clairement axée sur la compétitivité des entreprises et le libre-échange.
La justice sociale, si elle n'est pas étrangère aux valeurs de l'UE rappelées dans l'article 2 du traité de Lisbonne et dans la charte des droits fondamentaux et qui défend aussi la stabilité et la paix intérieures des sociétés des États membres, n'a jamais été une priorité de premier ordre pour l'Union. D'autant qu'il s'agit d'une notion à laquelle tous les États membres n'attachent pas la même importance et qui, de surcroît, fait surtout partie des domaines qui relèvent prioritairement des champs de compétence des États membres, la politique sociale étant par excellence une matière gérée pour l'essentiel à l'échelle nationale.
Hans Stark est professeur à Sorbonne Université et conseiller pour les relations franco-allemandes (Cerfa) à l'Ifri.
Cet article est paru dans le dossier intitulé "Politiques sociales européennes : différences et perspectives à partir de l'exemple de l'Allemagne et de la France", paru dans la revue Allemagne d'aujourd'hui, n° 249, juillet-septembre 2024 et co-dirigé par Étienne Dubslaff, Françoise Knopper, Sylvie Karsenty (p. 11 à 19).

Contenu disponible en :
Thématiques et régions
ISBN / ISSN
DOI
Presses Universitaires du Septentrion
Utilisation
Comment citer cette publicationPartager
Centres et programmes liés
Découvrez nos autres centres et programmes de rechercheEn savoir plus
Découvrir toutes nos analysesLa Bundeswehr : du changement d’époque (Zeitenwende) à la rupture historique (Epochenbruch)
La Zeitenwende (« changement d’époque ») annoncée par Olaf Scholz le 27 février 2022 passe à la vitesse supérieure. Soutenues financièrement par la réforme constitutionnelle du « frein à la dette » de mars 2025 et cautionnées par un large consensus politique et sociétal en faveur du renforcement et de la modernisation de la Bundeswehr, les capacités militaires de l’Allemagne devraient augmenter rapidement au cours des prochaines années. Appelée à jouer un rôle central dans la défense du continent européen sur fond de relations transatlantiques en plein bouleversement, la position allemande en matière politique et militaire traverse une profonde mutation.
La fabrique de la politique européenne de l’Allemagne
L’ambition européenne de Friedrich Merz est de faire de l’Allemagne, souvent perçue comme hésitante, un acteur de premier plan de l’Union européenne. À cette fin, le chancelier allemand a annoncé vouloir mettre un terme au « German vote ». Celui-ci incarne le paradoxe d’une Allemagne à la fois indispensable et fréquemment absente dans la décision européenne.

Sécuriser les chaînes de valeur des matières premières critiques (MPC) : une condition préalable à la résilience technologique de l'Europe
Au cœur de la sécurité économique, la résilience technologique est un pilier de la compétitivité de l'Union européenne (UE). Les transitions énergétique et numérique de l'UE dépendent des matières premières critiques (MPC).

Concilier compétitivité et évolution démographique : un impératif franco-allemand
La France et l'Allemagne sont confrontées à des changements démographiques parallèles qui pourraient remodeler l'avenir de leurs économies et de leurs modèles sociaux. Ces changements reflètent des tendances européennes plus larges, mais sont amplifiés par le rôle central que jouent ces deux nations dans la gouvernance et la compétitivité de l'Union européenne.













