Le secteur agricole en Inde : quelles mutations ?
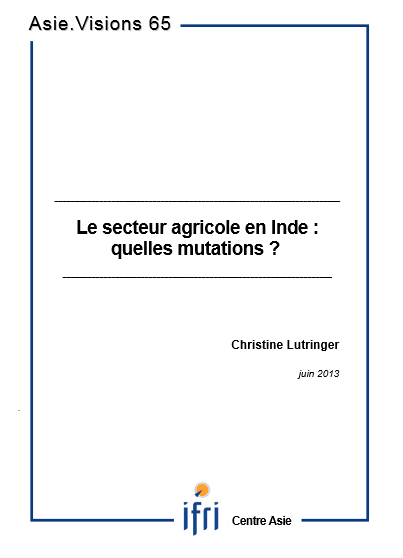
Le secteur agricole en Inde est à la fois en profonde mutation et sujet à de sérieuses fragilités. De fait, alors qu’il emploie aujourd’hui encore la moitié de la population active indienne, son taux de croissance est à la traîne par rapport au reste de l’économie et sa contribution au PIB diminue de manière lente mais constante depuis les années 1990.
L’héritage de la révolution verte explique dans une large mesure cet état de fait. L’intervention publique a traditionnellement eu une influence déterminante sur le développement de l’ensemble du secteur, notamment par l’intermédiaire d’une politique active de soutien des prix. Toutefois cette modernisation agricole est loin d’avoir promu un développement homogène, l’introduction des techniques de la révolution verte ayant au contraire accentué les disparités au niveau régional et entre groupes sociaux. Par ailleurs si le retrait graduel de l’Etat depuis les années 1990 a permis l’inclusion croissante de l’économie rurale aux dynamiques de marché, il s’est avant tout accompagné d’un essoufflement de la production.
Aujourd’hui, le secteur agricole indien ne se caractérise pas par un modèle commun, mais au contraire, par la diversité des situations rencontrées à travers le pays. Certaines catégories d’exploitants, plutôt privilégiés, ont par exemple opté pour des cultures à forte valeur ajoutée, qui ont stimulé les exportations agricoles indiennes. Mais, à côté de cette agriculture dynamique et prospère, la majeure partie du secteur est en difficulté en raison notamment de la faible viabilité des exploitations (plus de 80% d’entre elles ont une surface inférieure à deux hectares). L’un des principaux enjeux pour les autorités publiques est donc de soutenir les petits exploitants, d’abord en améliorant leur accès au crédit institutionnel et en les sortant de la spirale de l’endettement, ensuite en renforçant leur pouvoir de négociation sur les marchés, enfin, en améliorant les infrastructures rurales dans leur ensemble. Au-delà du seul engagement public, c’est la complémentarité entre les investissements publics et privé qui est la mieux à même de stimuler le secteur agricole et de lutter contre la pauvreté et les inégalités en milieu rural.

Contenu disponible en :
Régions et thématiques
ISBN / ISSN
Utilisation
Comment citer cette publicationPartager
Téléchargez l'analyse complète
Cette page ne contient qu'un résumé de notre travail. Si vous souhaitez avoir accès à toutes les informations de notre recherche sur le sujet, vous pouvez télécharger la version complète au format PDF.
Le secteur agricole en Inde : quelles mutations ?
Centres et programmes liés
Découvrez nos autres centres et programmes de rechercheEn savoir plus
Découvrir toutes nos analysesJapon : le raz-de-marée Takaichi et le nouveau visage du pouvoir
La Première ministre Sanae Takaichi a transformé sa popularité exceptionnelle en une victoire politique historique. Les élections anticipées du 8 février ont offert au Parti libéral démocrate (PLD) une majorité écrasante, grâce au soutien massif de jeunes électeurs séduits par son image iconoclaste et dynamique, et des conservateurs rassurés par sa vision d’affirmation nationale. Cette popularité pose les bases d’une stratégie ambitieuse tant sur le plan intérieur que sur le plan international.
Élections en Thaïlande : les conservateurs consolident leur ancrage
À rebours des sondages, le parti conservateur pro-business Bhumjaithai a dominé les élections législatives anticipées du 8 février 2026 et s’est imposé à la Chambre basse avec 193 sièges sur 500, enregistrant une progression record par rapport aux 71 députés élus en 2023.
Crise politique en Thaïlande : la tactique du chaos
La Thaïlande a replongé à l’été 2025 dans une crise politique profonde. La suspension de la Première ministre, Paetongtarn Shinawatra, par la Cour constitutionnelle a provoqué l’implosion de la coalition au pouvoir. Cette crise ressemble pourtant aux précédentes. Une banalité répétitive qui interroge à la fois le sens des responsabilités des principaux dirigeants et qui génère au sein de la population un cynisme mâtiné de résignation.

Ouverture du G7 à la Corée du Sud : relever les défis mondiaux contemporains
L'influence mondiale du G7 s'est affaiblie à mesure que des puissances telles que la Chine remodèlent la gouvernance internationale à travers des initiatives telles que les BRICS et l'Organisation de Coopération de Shanghai (OCS). Le G7 ne représentant plus aujourd'hui que 10 % de la population mondiale et 28 % du PIB mondial, sa pertinence est de plus en plus remise en question.











