Transition et négociations au Yémen : Le rôle de l'ONU
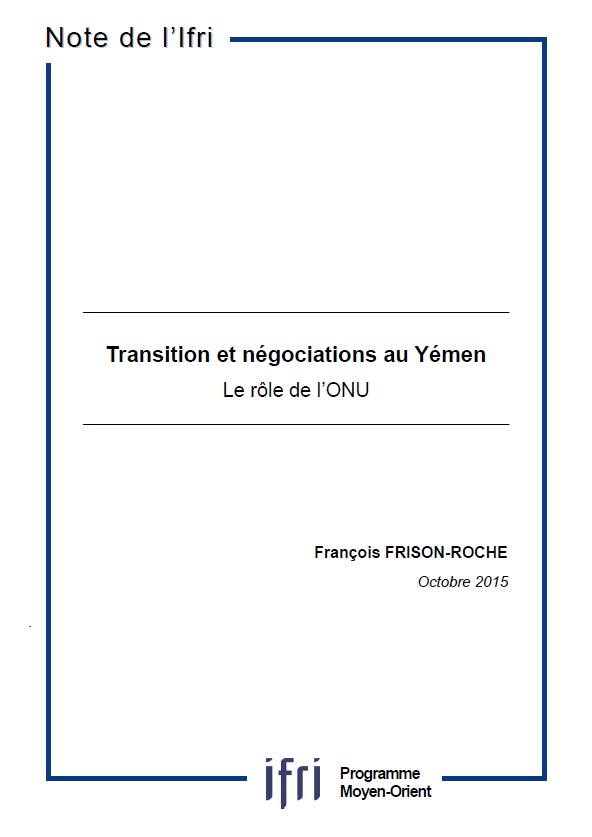
Une meilleure compréhension de la guerre qui sévit désormais depuis plusieurs mois entre une coalition de pays arabes sunnites, dirigée par le Royaume d’Arabie Saoudite et le Yémen, oblige à revenir sur ces quatre dernières années de transition et de négociations.

Il s’agira avant tout pour nous de lever deux ambiguïtés de la « révolution yéménite », puis de nous s’interroger sur l’approche onusienne. La « révolution yéménite » s’apparente plus, selon nous, à un règlement de compte entre prédateurs locaux qu’à un véritable soulèvement populaire, spontané et autonome. De ce fait, les « accords de Riyad », signés fin 2011, étaient surtout destinés à régler rapidement une question de « partage du pouvoir » entre factions rivales plutôt que d’entamer un vaste processus de refondation politique dans un pays profondément fragmenté par ses divisions tribalo-religieuses et de multiples conflits intérieurs larvés.
Il faut ensuite se pencher sur la réponse, inadaptée selon nous, que la communauté internationale, en la personne de l’ancien conseiller spécial du Secrétaire général de l’ONU, a apportée à la crise. Analyse erronée de la situation sur le terrain, méconnaissance ou négligence des rapports de force réels, cadrage impropre du processus de dialogue national et de ses acteurs, absence de volonté politique d’agir dans les temps prescrits : les méprises semblent nombreuses pour celui qui a voulu préempter et diriger un processus qui lui a finalement échappé, avant qu’il ne soit forcé à démissionner.

Contenu disponible en :
Régions et thématiques
ISBN / ISSN
Utilisation
Comment citer cette publicationPartager
Téléchargez l'analyse complète
Cette page ne contient qu'un résumé de notre travail. Si vous souhaitez avoir accès à toutes les informations de notre recherche sur le sujet, vous pouvez télécharger la version complète au format PDF.
Transition et négociations au Yémen : Le rôle de l'ONU
Centres et programmes liés
Découvrez nos autres centres et programmes de rechercheEn savoir plus
Découvrir toutes nos analysesLa Russie, les Palestiniens et Gaza : ajustements après le 7 octobre
L'Union soviétique (URSS), puis la Fédération de Russie en tant que successeur légal internationalement reconnu, ont toujours cherché à jouer un rôle visible dans les efforts visant à résoudre le conflit israélo-palestinien.
Le Canada et la reconnaissance de l'État palestinien
Le 21 septembre 2025, le Canada est devenu le 148ème pays à reconnaître l'État palestinien. Cette mesure a été coordonnée avec le Royaume-Uni et l'Australie en face d'une forte opposition américaine et israélienne.
La République d’Irlande et la question palestinienne
Depuis le milieu du XXᵉ siècle, la politique étrangère de la République d’Irlande s’est construite sur un double héritage qui lui confère une position unique parmi les États d’Europe occidentale.
Turquie 2050 - Train ITI ; Mansur Yavaş ; Turquie - Syrie
Repères sur la Turquie n° 34 - Le programme « Turquie 2050 » développe une analyse prospective sur les thèmes de la diplomatie, de la politique intérieure et de l’économie turques afin d’y anticiper les dynamiques des trente prochaines années.













