Le bien public mondial, au-delà des mots
Au moment où j’écris ces lignes, l’évolution de la pandémie de COVID-19 semble donner raison à ceux des épidémiologistes ou virologues qui nous annoncent depuis un certain temps que la vague est en train de passer.
Si tel est le cas, cela ne signifie pas que nous sommes à l’abri d’une deuxième vague et d’autres encore, mais seulement que des répliques ne sont pas imminentes. L’intérêt de continuer de rechercher avec acharnement des solutions thérapeutiques et si possible des vaccins adaptés à ce virus pas comme les autres est incontestable. Mais une éventuelle accalmie devrait aider celles et ceux qui pensent, définissent ou mettent en œuvre les politiques publiques en matière de santé à préciser ce qu’il faut entendre par des expressions comme « un vaccin est un bien public mondial ».
Mon objectif ici n’est pas de commenter le concept de bien commun (celui de bien public est beaucoup plus précis), mais d’attirer votre attention sur le fait que tout impératif catégorique s’y rapportant – même le plus convaincant sur le plan éthique – reste creux en l’absence d’une organisation internationale aux règles précises et acceptées par tous, capable de définir des stratégies et de veiller à leur exécution. Cette remarque va bien au-delà des médicaments et des vaccins. Elle vaut pour la prévention des pandémies comme pour la limitation de leurs conséquences lorsque néanmoins elles surviennent.
Et même cela paraît trop restrictif. Qui pourrait désapprouver Philippe Descola – un anthropologue réputé, disciple de Claude Lévi-Strauss – quand il réclame une « politique de la Terre » imaginée comme une « maison commune » (entendez : à tous les êtres vivants) ?[1] Pour un spécialiste des relations internationales, la référence à la « maison commune » fait irrésistiblement penser aux appels de Mikhaïl Gorbatchev qui, encore Secrétaire général du Parti communiste de l’URSS, cherchait vainement à convaincre les Européens de l’Ouest de partager avec les Soviétiques une maison commune… Je pense aussi à l’avertissement d’Édouard Bard, un climatologue lui aussi de réputation internationale, selon lequel « la pandémie de COVID-19 préfigure en accéléré la propagation du réchauffement climatique[2] ». Cet auteur déplore les comportements individuels ou collectifs chaotiques face à l’actuel « crash test ». Le COVID-19 n’est sans doute pas d’origine climatique, mais on a de fortes raisons de penser que le changement climatique provoquera de nouveaux genres de pandémies. Chacun à sa façon, ces deux scientifiques éminents, comme bien d’autres dans le monde, soulignent la totale impréparation du système international à des types de catastrophes dont pourtant on doit considérer l’avènement comme certain.
Pour ceux qui croient à l’ordre par le droit, cette impréparation est choquante, puisque la mise en place de l’Organisation des Nations unies (ONU) au lendemain de la Seconde Guerre mondiale eut justement pour but d’organiser les relations internationales dans le souci du bien commun. Dans les circonstances de l’après-guerre, le bien commun, c’était la paix. Le « multilatéralisme » est le nom qu’on a donné à une méthode destinée à en renforcer les chances, fondée sur la recherche en commun de solutions face aux situations susceptibles de mettre la paix en danger. Une méthode avec des règles (le droit international) et tout un système d’institutions facilitatrices, comme l’Organisation mondiale de la santé (OMS) sur la sellette depuis le surgissement de l’actuelle pandémie. Quels que soient ses défauts, l’ONU ne pouvait pas faire mieux que ce qu’elle a fait pendant la guerre froide, avec un système international hétérogène à l’extrême, dans lequel aucun des principaux acteurs n’entendait renoncer à sa souveraineté et à ses ambitions. Le droit international n’en a pas moins joué un rôle d’amortisseur au cours de nombreuses crises, et c’est déjà beaucoup. L’ONU a aussi servi de caisse de résonance pour la propagande des uns et des autres. Quant à la prise de conscience de la finitude de la planète Terre, elle a commencé à s’imposer dans le dernier tiers du xxe siècle en raison de l’explosion démographique et de la pression exercée par la croissance économique sur les ressources naturelles et l’environnement. Avec peu de conséquences opérationnelles jusqu’à ce jour. Que le multilatéralisme onusien ait échoué, du moins par rapport à l’utopie sous-jacente, me paraît évident. Je n’en déduis pas que l’ONU soit inutile. Le cadre est là. Le manque est politique. Et l’on peut espérer que les drames comme les guerres, les catastrophes naturelles, les pandémies ou autres favorisent la conscientisation et donc l’action positive. À condition que ne l’emportent pas les forces obscurantistes à l’œuvre dans toutes les grandes épreuves. Celle du COVID-19 ne fait pas exception.
Seul l’approfondissement du multilatéralisme permettra de mieux en mieux prendre en compte le bien commun. Quand on parle de multilatéralisme, les juristes entendent « droit international ». Dans le domaine des relations internationales, les politologues pensent d’abord en termes de rapport de force, en donnant au mot « force » son acception la plus large. S’agissant des rapports entre nations souveraines, c’est à mon avis au sein du système d’alliances formé autour des États-Unis dans le contexte de la guerre froide que s’est trouvée en pratique la meilleure approximation de l’idée du multilatéralisme. Y compris avec les institutions comme le Fonds monétaire international (FMI), la Banque mondiale, ou encore l’Organisation mondiale du commerce (OMC). Il a fallu pour cela le leadership américain face au défi posé par l’Union des républiques socialistes soviétiques (URSS).
L’érosion du multilatéralisme a commencé, lentement d’abord, après la chute de l’Union soviétique. Aussi bien sous sa forme globale, onusienne, que sous sa forme occidentale (ou « trilatérale », avec le Japon ou la Corée). Les alliés des États-Unis n’ont pas osé regarder cette réalité en face. Quant à la puissance ascendante, la Chine, son intérêt était de faire patte de velours vis-à-vis des Occidentaux qu’elle avait l’ambition de rattraper puis de dépasser, comme jadis le Japon après 1868 (révolution Meiji). En même temps, les Chinois développaient leurs tentacules partout sur la planète, et s’efforçaient habilement de modifier en leur faveur les rapports de force au sein des organisations internationales.
Et nous en revenons au coronavirus. A-t-il changé le système international ? Évidemment non. La crise n’a fait qu’accélérer des tendances déjà largement en œuvre sous George W. Bush et Barack Obama. L’orage couvait. Le démiurge Trump l’a fait éclater et, avec lui, la rivalité sino-américaine a pris une tournure globale. À la veille du surgissement de la crise sanitaire, on pouvait encore croire à une accalmie, au moins dans l’ordre commercial. Mais avec la pandémie sont revenus l’orage et la foudre. Les deux derniers épisodes tournent autour de l’OMS et de Hong Kong. La rivalité entre les États-Unis et la Chine ne pouvait que s’exacerber. Mais avant l’arrivée de Trump à la Maison-Blanche, on n’imaginait pas que l’érosion du multilatéralisme risquerait d’aller aussi vite jusqu’à sa destruction tant au niveau onusien qu’au niveau occidental. Il n’est pas encore mort, mais le danger est réel, à une époque où les défis globaux, impensés sinon impensables naguère encore, imposeraient au contraire un immense effort pour développer l’action collective.
Je m’abstiendrai de spéculer sur les chances immédiates du multilatéralisme. Mais la sagesse commande en particulier à nous, sur le Vieux Continent, de capitaliser sur la construction européenne pour donner crédit à une troisième voie entre les États-Unis, cette grande démocratie qui se veut toujours libérale, et la République populaire de Chine qui se dit toujours communiste. La plupart d’entre nous voulons rester proches de la démocratie américaine, mais nous refusons de devenir ses vassaux, notamment à travers une Alliance atlantique reformatée dans ce but. Il y a urgence à clarifier les objectifs réellement partagés de l’Organisation du traité de l’Atlantique nord (OTAN). Quant à l’Union européenne (UE), en dépit de toutes les pleurnicheries des dernières semaines, elle continue de progresser dans les tempêtes, comme ce fut toujours le cas. Les avancées les plus spectaculaires au mois de mai ont été franco-allemandes. Comme toujours également. L’arrêt de la Cour de Karlsruhe, au début du mois, a stupéfié ceux qui méconnaissaient la loi fondamentale allemande et n’avaient jamais remarqué son rôle critique à chaque étape de la construction européenne, notamment à propos de la Banque centrale (BCE). Face à cet arrêt, la présidente – allemande de la Commission n’a pas hésité à menacer de poursuivre Berlin, cependant que la chancelière contournait habilement l’obstacle en s’engageant fort loin avec le président français pour une forme de mutualisation de la relance, et qu’à la tête de la BCE Christine Lagarde poursuivait imperturbablement son chemin.
S’il existe une région dans le monde où le multilatéralisme profond avance malgré d’innombrables obstacles, c’est l’UE. Il faudra encore bien des décennies, en Europe et a fortiori à l’échelle planétaire. Mais c’est le sens de l’histoire, car l’alternative est le suicide collectif. Pour ce qui est de l’avenir proche, le monde subira inéluctablement le réchauffement climatique, des pandémies et des guerres plus ou moins intenses. Du moins peut-on espérer limiter les dégâts, ce qui fut somme toute le cas pendant la guerre froide. Soyons convaincus de la responsabilité de l’UE à cet égard.
[1]. Article de Philippe Descola dans Le Monde, 21-22 mai 2020.
[2]. Article d’Édouard Bard dans Le Monde, 25 avril 2020.

Contenu disponible en :
Régions et thématiques
ISBN / ISSN
Utilisation
Comment citer cette publicationPartager
Téléchargez l'analyse complète
Cette page ne contient qu'un résumé de notre travail. Si vous souhaitez avoir accès à toutes les informations de notre recherche sur le sujet, vous pouvez télécharger la version complète au format PDF.
Le bien public mondial, au-delà des mots
En savoir plus
Découvrir toutes nos analysesLa fabrique du risque : les entreprises face à la doxa géopolitique
La déformation du triangle stratégique États-Unis – Chine – Russie crée de nouvelles dynamiques auxquelles les entreprises ne peuvent se soustraire. Elles sont confrontées au risque géopolitique, sans forcément s’y être préparées. Leurs dirigeants ne peuvent plus l’ignorer.
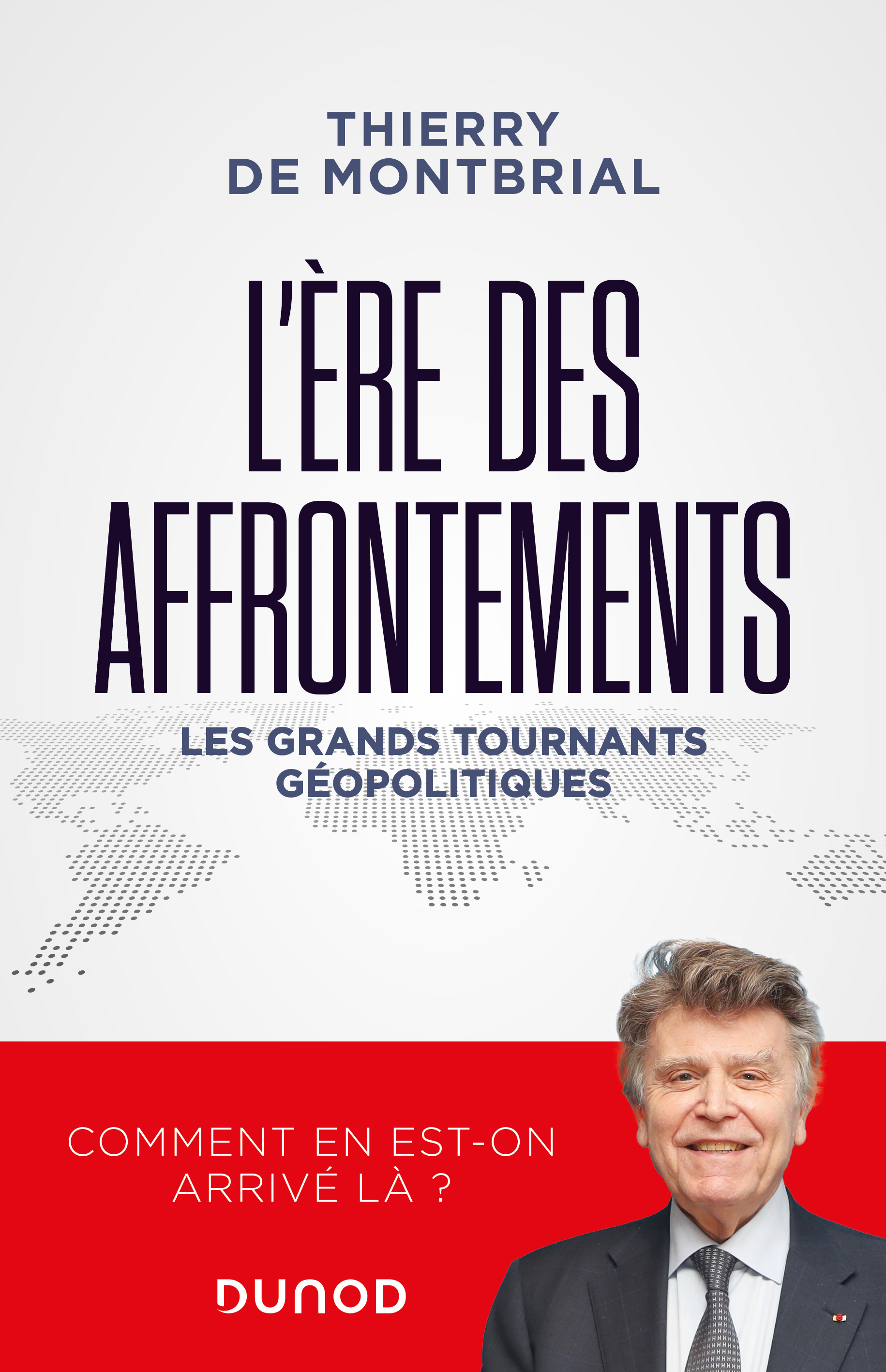
L'ère des affrontements. Les grands tournants géopolitiques
Au début de ce siècle, les Occidentaux ont voulu croire à la mondialisation heureuse grâce à l’expansion de la démocratie et de l’économie de marché. Un quart de siècle a passé, et la planète est engagée dans une Deuxième guerre froide, voire dans les prémices d’une Troisième Guerre mondiale.
Message adressé par Thierry de Montbrial à Henry Kissinger à l’occasion de son 100e anniversaire
Cher Henry,
Vous n’étiez pas encore Secrétaire d’Etat. Vous n’aviez pas encore proclamé « l’année de l’Europe », qui devait enflammer votre collègue français Michel Jobert. Mais, comme « National Security Adviser », vous aviez déjà atteint la gloire, avec le voyage de Nixon en Chine ou encore les accords de Paris avec le Vietnam.
Bassma Kodmani
La disparition prématurée de Bassma Kodmani est ressentie avec une profonde tristesse par l’Ifri, qu’elle avait intégré dès ses premières années d’existence. Elle fut en 1981 la créatrice et l’âme du programme portant sur l‘Afrique du Nord et le Moyen-Orient. Elle devait rester à l’Ifri près de 17 ans, marquant de sa forte personnalité les travaux sur cette zone sensible avant de rejoindre au Caire, en 1998, la Fondation Ford qui avait, en particulier, vocation à soutenir les centres de recherche dans la région.














