La politique étrangère à l'épreuve de la mondialisation
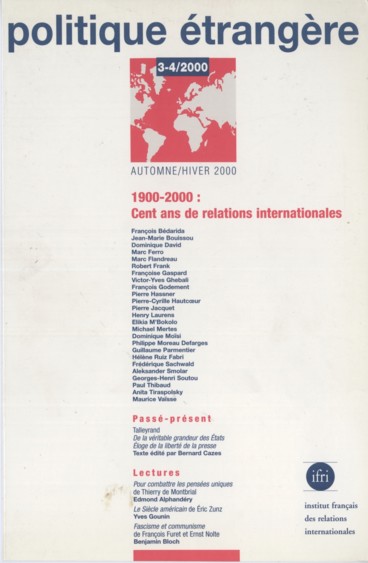
Longtemps monopolisée par des diplomates issus des plus hautes strates de la société, la diplomatie a connu de profonds bouleversements depuis la fin de la Première Guerre mondiale : extension du champ de son domaine d’action, diversification et multiplication des acteurs du jeu diplomatique, dialectique entre les gouvernements, les entreprises et les médias, dialogue avec la société civile, etc. Une évolution positive à bien des égards, mais qui risque aussi d’entraîner des confusions entre moralité et démagogie, tactique électoraliste et stratégie politique.

II y a cent ans, la politique étrangère était sans doute plus proche de ce qu'elle pouvait être à la fin du XVIIe siècle que de ce qu'elle est devenue aujourd'hui. En un siècle, tout a changé ou presque, même si les diplomates dans leur comportement, leurs modes de pensée, sinon leur apparence, semblent incarner une continuité avec le passé et ses traditions. Mais le « messager » a encore fort à faire pour s'adapter à la nature changeante de son « message ». La relative homogénéité du recrutement social des professionnels de la diplomatie dans la plupart des pays européens traduit mal, d'une part, l'explosion du champ de leur domaine d'action et, d'autre part, la diversification et la multiplication des acteurs du jeu diplomatique. Diplomatie économique, diplomatie multilatérale, apparition d'un monde transnational, dialectique entre la société civile et les médias, renforcement des exigences éthiques à l'ère des génocides et à l'ombre de l'arme nucléaire : les transformations intervenues sont profondes. Elles peuvent être connues et comprises, mais elles ne sont pas toujours pleinement intégrées et assimilées dans leurs conséquences.
Certes, les diplomates intègrent dans leur grande majorité les transformations intervenues. Ils savent qu'ils ne représentent plus seulement leur État, mais aussi les entreprises de leur pays respectif ; ils intègrent toujours davantage, dans la définition de leur rôle, leurs responsabilités vis-à-vis des médias et un nécessaire dialogue avec la société civile, ce qui, dans des pays peu démocratiques, peut impliquer des réflexes d'ouverture sinon d'empathie avec des interlocuteurs moins classiques.
On peut toutefois se demander si, à l'aube du XXIe siècle, la diplomatie est encore une discipline scientifique avec ses règles éprouvées et immuables ou, pour le moins, un art à pratiquer avec délicatesse et à tenir à distance des profanes et des apprentis sorciers ? Quelques mois après l'incident de l'université de Bir Zeit, en Palestine, et des jets de pierres contre le premier ministre Lionel Jospin - qui visaient tout autant, cela est indéniable aujourd'hui, l'autorité de Yasser Arafat sur le peuple palestinien que les mots « malheureux » du chef du gouvernement français —, les commentaires ne manquaient pas pour dénoncer l'amateurisme d'un Premier ministre qui s'était avancé sans précaution sur un terrain miné.
Une diplomatie sans diplomates ?
À l'encontre de cette vision classique et somme toute largement dominante dans les milieux diplomatiques, il existe un autre regard, selon lequel, pour plagier la célèbre formule de Clemenceau, appliquée aux militaires, « la diplomatie est une chose trop sérieuse pour être laissée aux seuls diplomates ». […]
PLAN DE L’ARTICLE
- Une diplomatie sans diplomates ?
- Des diplomates sans diplomatie ?
Dominique Moïsi est directeur adjoint de l’Ifri, rédacteur en chef de Politique étrangère.

Contenu disponible en :
Régions et thématiques
Utilisation
Comment citer cette publicationPartager
Téléchargez l'analyse complète
Cette page ne contient qu'un résumé de notre travail. Si vous souhaitez avoir accès à toutes les informations de notre recherche sur le sujet, vous pouvez télécharger la version complète au format PDF.
La politique étrangère à l'épreuve de la mondialisation
En savoir plus
Découvrir toutes nos analysesLe Bangladesh entre crise politique et montée de l'islamisme
Le mouvement « Students Against Discrimination », à l'origine des manifestations de l'été 2024, a cristallisé le mécontentement d'une jeunesse confrontée à la réinstauration d'un quota controversé pour les descendants des muktijoddhas (les « combattants pour la liberté » de la guerre d'indépendance de 1971), après quinze années de dérive autoritaire de la Première ministre Sheikh Hasina.
Avant-propos
Dans ce numéro spécial de Politique étrangère consacré aux actes de la Conférence organisée par l'Ifri le 10 avril 2019 au Grand amphithéâtre de la Sorbonne, à l'occasion de son quarantième anniversaire, découvrez l'avant-propos de Thierry de Montbrial, fondateur et président de l'Ifri.
Avant-propos
Dans ce numéro spécial de Politique étrangère consacré aux actes de la Conférence organisée par l'Ifri le 10 avril 2019 au Grand amphithéâtre de la Sorbonne, à l'occasion de son quarantième anniversaire, découvrez l'avant-propos de Thierry de Montbrial, fondateur et président de l'Ifri.
L'Europe et l'Afrique
Dans ce numéro spécial de Politique étrangère consacré aux actes de la Conférence organisée par l'Ifri le 10 avril 2019 au Grand amphithéâtre de la Sorbonne, à l'occasion de son quarantième anniversaire, découvrez l'entretien entre Thierry de Montbrial, fondateur et président de l'Ifri et Louise Mushikiwabo, ancienne ministre des Affaires étrangères du Rwanda, secrétaire générale de La Francophonie.











