L'énergie et l'économie mondiale
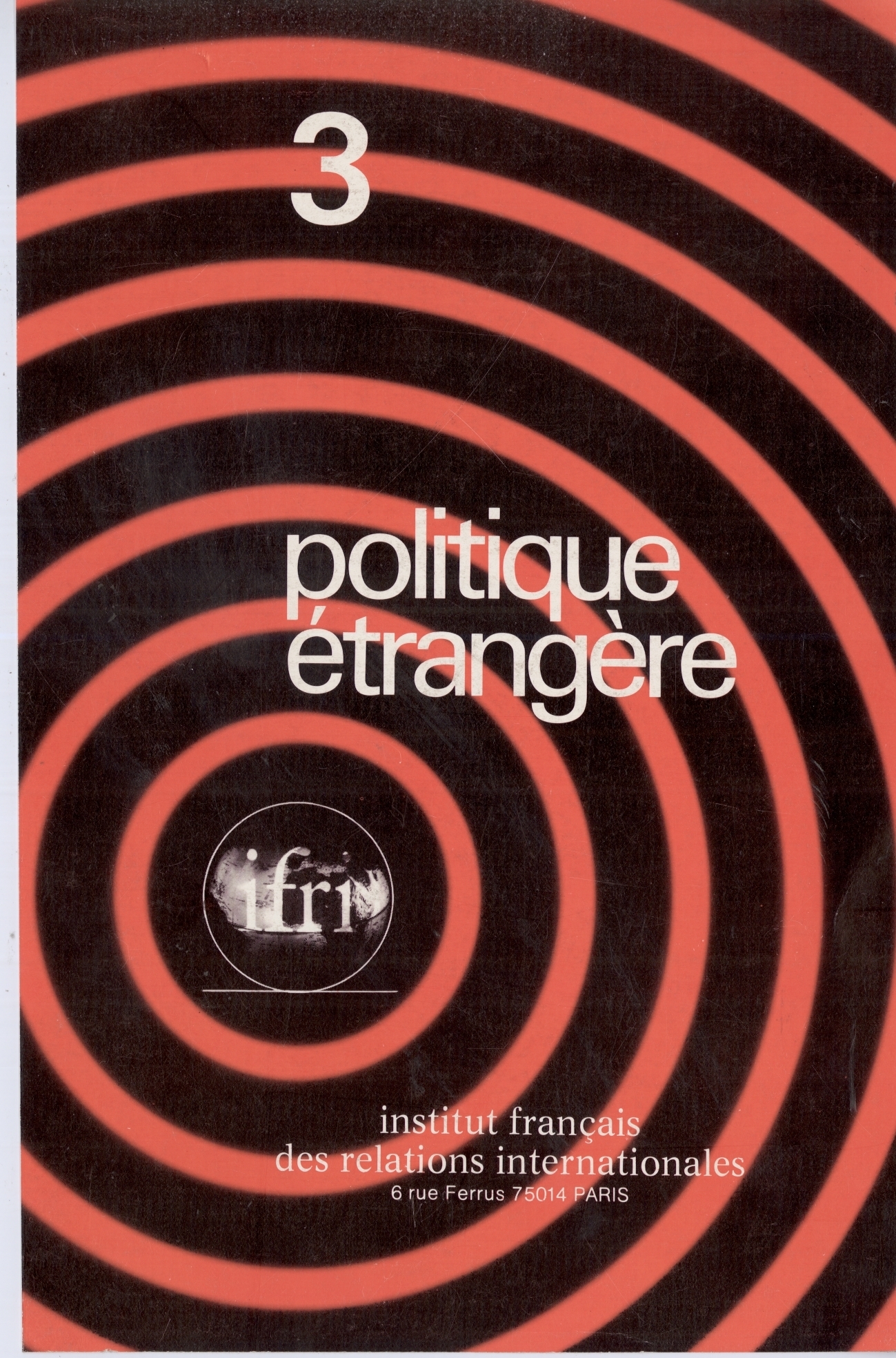
Après le quadruplement des prix du pétrole en 1973, les pays industrialisés avaient réussi à rééquilibrer leur balance des paiements courants grâce notamment à une baisse des prix réels du pétrole. Mais les déficits massifs de la balance des paiements courants que connaissent aujourd'hui, à la suite des nouvelles hausses décidées par l'OPEP, les pays importateurs de pétrole, risquent de se révéler plus persistants.
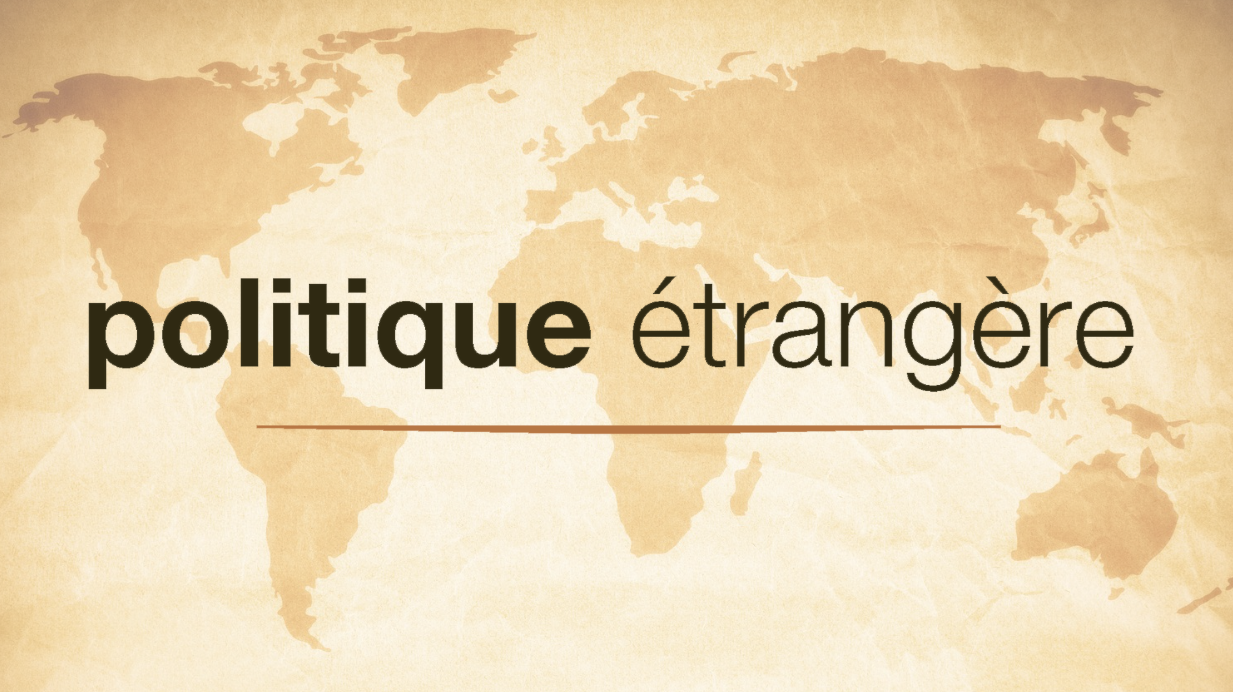
Nous pouvons en effet nous attendre à ce que les tensions sur les prix persistent plus longtemps et à ce que les excédents pétroliers soient plus durables qu'après 1974.
Si le renchérissement du pétrole depuis la fin de 1978 est la cause immédiate des nouvelles difficultés que traverse l'économie mondiale, la cause fondamentale en est le niveau élevé de la consommation d'énergie. Or la structuration actuelle de la consommation énergétique mondiale, axée à 51 % sur le pétrole, reflète en grande partie les faibles prix réels du pétrole pratiqués au cours des années 1960. Les niveaux actuels de la consommation pétrolière dépassent de beaucoup les taux de production qui semblent pouvoir être maintenus à long terme. Tout le monde a certes à l'esprit les nouvelles réserves économiquement exploitables qui ont été découvertes au cours des dernières années (Mexique, mer du Nord...). Mais à la longue, les possibilités de découvertes importantes ont inévitablement une probabilité de moins en moins grande. La réduction de la consommation de pétrole est donc un impératif à long terme. Elle est aussi un impératif à moyen terme, dans la mesure où un grand nombre de pays ne pourront plus longtemps financer des déficits des paiements aussi considérables.
Face à cette nouvelle situation, le Fonds monétaire international est appelé à relever trois défis :
— celui de contribuer à fournir les volumes et les types de ressources dont les pays membres pourront avoir besoin dans les années à venir ;
— celui d'aider ces pays à exécuter les programmes d'ajustement nécessaires ;
— enfin celui de faciliter pour les pays à excédents de capitaux la solution des problèmes que leur pose la gestion de leurs réserves dans un système de taux flottants.
PLAN DE L'ARTICLE
- L'évolution de l'offre et de la demande d'énergie
- Comment réduire la consommation de pétrole ?
- Quelle politique énergétique à moyen terme ?
- Le problème du financement et de l'ajustement des balances des paiements
- La situation actuelle des balances des paiements
- L'environnement commercial, financier et économique
- La situation critique des pays en développement
- Le rôle des banques
- Le rôle du Fonds monétaire international
- Que doit-on entendre aujourd'hui par ajustement ?
- Le FMI peut-il faciliter le recyclage ?
- Pour une gestion multilatérale, axée sur le DTS, des liquidités internationales
- Vers une maîtrise de la crise énergétique

Contenu disponible en :
Régions et thématiques
Utilisation
Comment citer cette publicationPartager
Téléchargez l'analyse complète
Cette page ne contient qu'un résumé de notre travail. Si vous souhaitez avoir accès à toutes les informations de notre recherche sur le sujet, vous pouvez télécharger la version complète au format PDF.
L'énergie et l'économie mondiale
En savoir plus
Découvrir toutes nos analysesL'Europe et l'Afrique
Dans ce numéro spécial de Politique étrangère consacré aux actes de la Conférence organisée par l'Ifri le 10 avril 2019 au Grand amphithéâtre de la Sorbonne, à l'occasion de son quarantième anniversaire, découvrez l'entretien entre Thierry de Montbrial, fondateur et président de l'Ifri et Louise Mushikiwabo, ancienne ministre des Affaires étrangères du Rwanda, secrétaire générale de La Francophonie.
Conclusions
Dans ce numéro spécial de Politique étrangère consacré aux actes de la Conférence organisée par l'Ifri le 10 avril 2019 au Grand amphithéâtre de la Sorbonne, à l'occasion de son quarantième anniversaire, découvrez l'allocution de Jean-Yves Le Drian, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères.
Nouveaux défis mondiaux et sécurité européenne
Dans ce numéro spécial de Politique étrangère consacré aux actes de la Conférence organisée par l'Ifri le 10 avril 2019 au Grand amphithéâtre de la Sorbonne, à l'occasion de son quarantième anniversaire, découvrez le débat animé par Nicole Gnesotto entre Wolfgang Ischinger, Jean-Marie Guéhenno, Julian King et Hubert Védrine.
Les industriels face aux nouveaux protectionnismes
Dans ce numéro spécial de Politique étrangère consacré aux actes de la Conférence organisée par l'Ifri le 10 avril 2019 au Grand amphithéâtre de la Sorbonne, à l'occasion de son quarantième anniversaire, découvrez le débat animé par Thierry de Montbrial entre Jean-Paul Agon et Patrick Pouyanné.








