Naviguer sur l'océan multilatéral : lost in decomposition ? - Politique étrangère, vol. 90, n° 2, été 2025
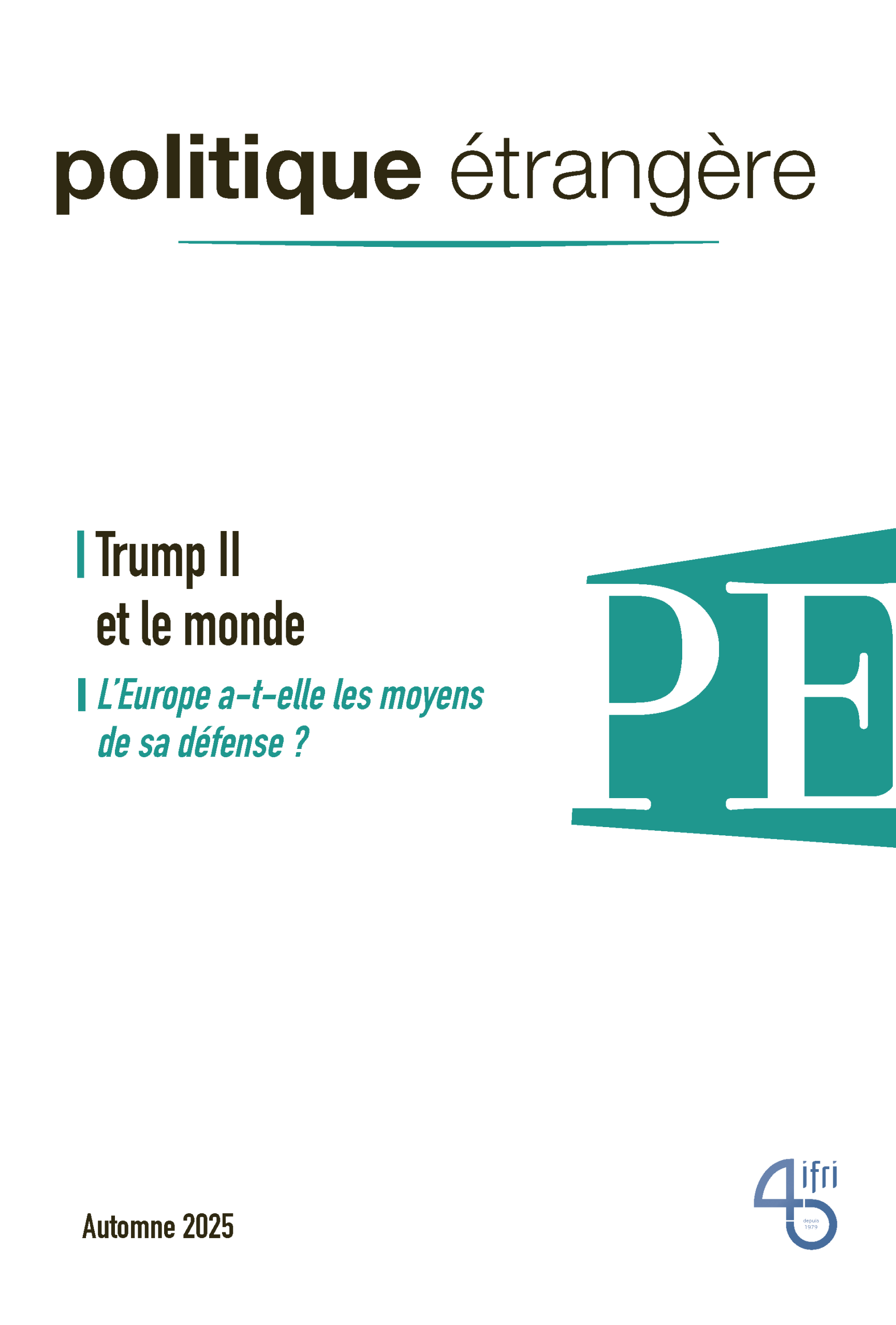
Le multilatéralisme organisationnel apparaît menacé par l'affirmation des politiques de puissance, en particulier à travers le système de l'Organisation des Nations unies (ONU). Les demandes de réforme de ce système perdurent cependant. Et les formes de consultations souples se développent : diplomaties de clubs ou minilatéralismes. La recomposition multilatérale s'effectue ainsi largement hors du système organisationnel. Éloignée d'un ordre international libéral ou d'un ordre multipolaire, elle ne favorise pas l'inscription de l'habitabilité de la planète au faîte de l'agenda multilatéral.
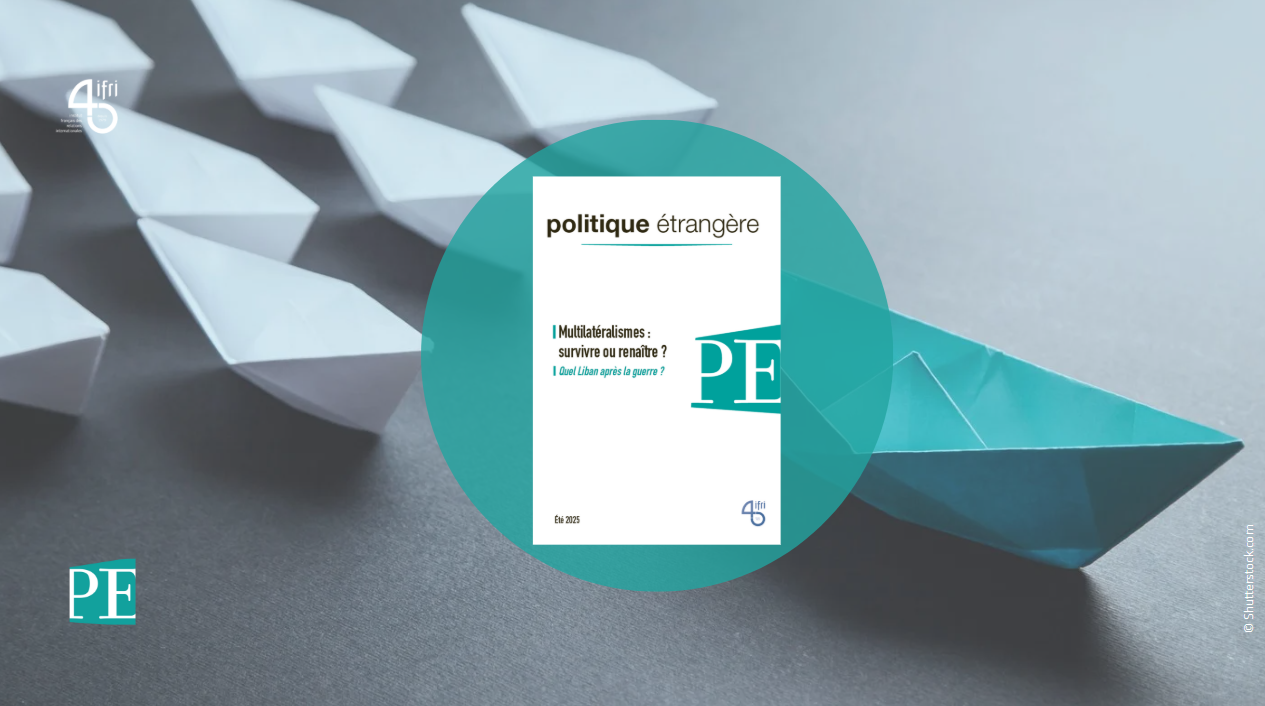
Frédéric Ramel est professeur des universités en science politique à Sciences Po Paris. Chercheur au Centre de recherches internationales (CERI), il a copiloté le programme ANR DATAWAR (2019-2023) et il coordonne le Groupe de recherche sur l'action multilatérale (GRAM) du CNRS. Il vient de publier Espace mondial (Paris, Presses de Sciences Po, 2024).
Article publié dans Politique étrangère, vol. 90, n° 2, été 2025.
"En déclin, déboussolé, voire aux portes du crépuscule : les pessimismes s'accumulent à l'endroit du multilatéralisme, amplifiés par l'entrée dans le second mandat de Donald Trump. Comme pratique diplomatique plus ou moins institutionnalisée commençant avec trois États, ce multilatéralisme peut revêtir une pluralité de formes, le long d'un continuum allant de la simple coordination entre États aux actions des organisations intergouvernementales dotées d'une personnalité morale, d'un siège et d'une bureaucratie. Le multilatéralisme est aussi et surtout une « technique normative de réalisation du droit international, qui concerne tant sa production que son application ». La matière même de ce droit consiste à établir des liens de plus en plus serrés entre les États, par la formulation d'objectifs communs, la pacification des relations internationales ou encore l'universalisation des règles et des conduites. Né au XIXe siècle d'une gestion collective d'enjeux techniques variés comme les transports ou les communications, il a investi le champ de la guerre et de la paix à partir de 1919 avec la Société des Nations.
Quels que soient les objets de négociation diplomatique, ce multilatéralisme s'apparente à une politique du tissage ayant pour visée de faire converger les volontés à partir de frictions, de tensions, de compétitions entre les États. Que ce tissage se réduise à canaliser l'unilatéralisme ou qu'il promeuve des biens publics mondiaux de manière robuste, il renvoie bel et bien à l'idée de maillage au cœur de la société mondiale. Aujourd'hui, ce maillage s'est à la fois complexifié et relâché. [...]"
Téléchargez l'analyse complète
Cette page ne contient qu'un résumé de notre travail. Si vous souhaitez avoir accès à toutes les informations de notre recherche sur le sujet, vous pouvez télécharger la version complète au format PDF.
Naviguer sur l'océan multilatéral : lost in decomposition ? - Politique étrangère, vol. 90, n° 2, été 2025
En savoir plus
Découvrir toutes nos analysesLe Bangladesh entre crise politique et montée de l'islamisme
Le mouvement « Students Against Discrimination », à l'origine des manifestations de l'été 2024, a cristallisé le mécontentement d'une jeunesse confrontée à la réinstauration d'un quota controversé pour les descendants des muktijoddhas (les « combattants pour la liberté » de la guerre d'indépendance de 1971), après quinze années de dérive autoritaire de la Première ministre Sheikh Hasina.
Avant-propos
Dans ce numéro spécial de Politique étrangère consacré aux actes de la Conférence organisée par l'Ifri le 10 avril 2019 au Grand amphithéâtre de la Sorbonne, à l'occasion de son quarantième anniversaire, découvrez l'avant-propos de Thierry de Montbrial, fondateur et président de l'Ifri.
Avant-propos
Dans ce numéro spécial de Politique étrangère consacré aux actes de la Conférence organisée par l'Ifri le 10 avril 2019 au Grand amphithéâtre de la Sorbonne, à l'occasion de son quarantième anniversaire, découvrez l'avant-propos de Thierry de Montbrial, fondateur et président de l'Ifri.
L'Europe et l'Afrique
Dans ce numéro spécial de Politique étrangère consacré aux actes de la Conférence organisée par l'Ifri le 10 avril 2019 au Grand amphithéâtre de la Sorbonne, à l'occasion de son quarantième anniversaire, découvrez l'entretien entre Thierry de Montbrial, fondateur et président de l'Ifri et Louise Mushikiwabo, ancienne ministre des Affaires étrangères du Rwanda, secrétaire générale de La Francophonie.










