Politique étrangère russe : l'étrange inconstance
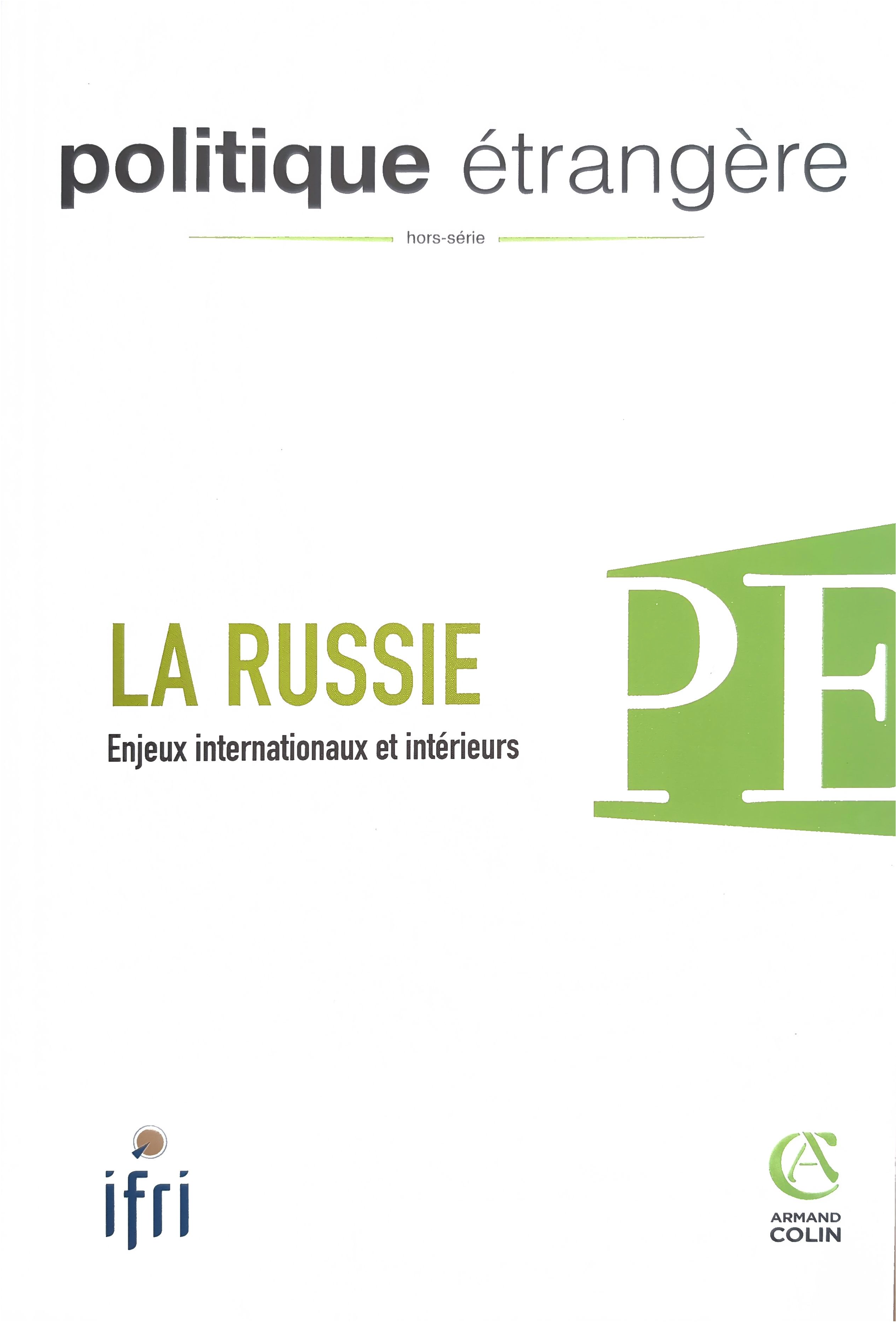
La Russie de Vladimir Poutine a retrouvé des marges internationales. Mais les objectifs de sa politique étrangère restent peu clairs, entre le poids de la constance – le tropisme militaire, les visions géopolitiques, le nécessaire contrôle de l’empire, la référence à la richesse énergétique – et la tentation de l’inconstance – sur l’affaire iranienne ou sur l’option européenne... C’est parce que la politique extérieure russe est irréductible à nos normes qu’elle exige un constant décryptage.

La politique étrangère russe frappe par sa capacité à saisir les opportunités et son incapacité à engendrer des situations nouvelles. Plus flexible que rigide, moins créative que réactive, elle se trouve actuellement sous le feu croisé de vives critiques. D’un côté, la posture néo-impériale de Moscou est dénoncée, à travers la reconstitution de capacités militaires offensives, le recours constant aux services de renseignement et l’utilisation systématique de l’arme énergétique. De l’autre, l’organisation du système russe et ses implications extérieures suscitent des mises en garde, justifiées par le rapport ambivalent des Russes – en particulier des jeunes générations – à leur passé totalitaire, par la bureaucratisation du pouvoir, indissociable de la captation de la rente énergétique et, enfin, par le recul des libertés publiques.
Dans une optique réaliste, ces critiques ne doivent pas masquer l’essentiel : par rapport à la période Eltsine, la Russie a retrouvé de véritables marges de manœuvre sur la scène internationale. Même s’il a commis de lourdes fautes, Vladimir Poutine est parvenu, à plusieurs reprises, à renverser des situations délicates en recourant à une dialectique économie/sécurité, en exploitant le « terrorisme international » et en déséquilibrant habilement ses partenaires. Après une annus horribilis en 2004, due notamment aux conséquences internationales de Beslan (Ossétie du Nord) et à la « révolution orange » en Ukraine, la politique étrangère russe présente un bilan 2005 beaucoup plus favorable : la commémoration du 60e anniversaire de fin de la Seconde Guerre mondiale, la signature des feuilles de route avec l’Union européenne (UE) sur les quatre espaces définis à Saint-Pétersbourg, le regain d’influence en Asie centrale à travers l’Organisation de coopération de Shanghai (OCS), les exercices militaires avec la Chine et l’Inde, la tournée au Moyen-Orient et la poursuite d’une politique ambivalente à l’égard de l’Iran, témoignent de l’activisme du Kremlin en matière internationale. Sa capacité de rebond profite des prix énergétiques mondiaux, qui lui procurent des moyens financiers conséquents. En ouvrant 2006 par une crise gazière avec l’Ukraine, le Kremlin a mis en lumière une tendance sous-jacente de sa politique étrangère : l’utilisation de l’approvisionnement énergétique comme révélateur du différentiel de puissance entre la Russie et ses voisins. […]
PLAN DE L’ARTICLE
- Une constance certaine
- L’héritage stratégique et historique
- Une puissance du statu quo
- Une puissance unijambiste - Une certaine inconstance
- Le dossier iranien
- Intégration versus eurasisme
- Russie réelle, Russie virtuelle
Ce texte a été publié pour la première fois dans le n°1:2006 de Politique étrangère.
Thomas Gomart est responsable du programme Russie/Nei à l'Ifri où il coordonne la Task force sur l'avenir des relations Union européenne/Russie. Il est également enseignant à l'École spéciale militaire de Saint-Cyr (Coëtquidan).

Contenu disponible en :
Régions et thématiques
Utilisation
Comment citer cette publicationPartager
Téléchargez l'analyse complète
Cette page ne contient qu'un résumé de notre travail. Si vous souhaitez avoir accès à toutes les informations de notre recherche sur le sujet, vous pouvez télécharger la version complète au format PDF.
Politique étrangère russe : l'étrange inconstance
Centres et programmes liés
Découvrez nos autres centres et programmes de rechercheEn savoir plus
Découvrir toutes nos analysesL'Europe et l'Afrique
Dans ce numéro spécial de Politique étrangère consacré aux actes de la Conférence organisée par l'Ifri le 10 avril 2019 au Grand amphithéâtre de la Sorbonne, à l'occasion de son quarantième anniversaire, découvrez l'entretien entre Thierry de Montbrial, fondateur et président de l'Ifri et Louise Mushikiwabo, ancienne ministre des Affaires étrangères du Rwanda, secrétaire générale de La Francophonie.
Conclusions
Dans ce numéro spécial de Politique étrangère consacré aux actes de la Conférence organisée par l'Ifri le 10 avril 2019 au Grand amphithéâtre de la Sorbonne, à l'occasion de son quarantième anniversaire, découvrez l'allocution de Jean-Yves Le Drian, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères.
Nouveaux défis mondiaux et sécurité européenne
Dans ce numéro spécial de Politique étrangère consacré aux actes de la Conférence organisée par l'Ifri le 10 avril 2019 au Grand amphithéâtre de la Sorbonne, à l'occasion de son quarantième anniversaire, découvrez le débat animé par Nicole Gnesotto entre Wolfgang Ischinger, Jean-Marie Guéhenno, Julian King et Hubert Védrine.
Les industriels face aux nouveaux protectionnismes
Dans ce numéro spécial de Politique étrangère consacré aux actes de la Conférence organisée par l'Ifri le 10 avril 2019 au Grand amphithéâtre de la Sorbonne, à l'occasion de son quarantième anniversaire, découvrez le débat animé par Thierry de Montbrial entre Jean-Paul Agon et Patrick Pouyanné.











