Une Europe démilitarisée ? Un regard américain
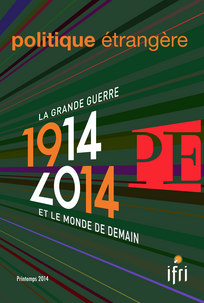
Le reproche adressé par les Américains aux Européens de négliger l’engagement de défense n’est pas nouveau, et il est souvent exagéré. Il a pris une ampleur nouvelle face à l’échec de l’Union européenne à se construire comme acteur stratégique et devant les coupes budgétaires engendrées par la crise de 2008. Pour inévitables que soient ces coupes, elles pourraient cependant menacer la capacité d’action des Européens en matière internationale, même pour les plus puissants d’entre eux.

Depuis l’invasion controversée de l’Irak en 2003 et depuis l’opuscule de Robert Kagan qui décrivait, à la même époque, des Européens doux et féminins venant de Vénus, face à des Américains durs et masculins venant de Mars, une nette différence d’attitudes est devenue manifeste de part et d’autre de l’Atlantique à l’égard de la sécurité, nationale et internationale. On peut sans doute parler, en ce début de siècle, d’un fossé qui se creuse dans les valeurs post-guerre froide.
On se concentrera ici sur le débat transatlantique autour de la « démilitarisation » de l’Europe. Est-elle réelle ? Les États européens, qui totalisent ensemble presque un quart des dépenses mondiales d’armement et de défense (24 % en 2012) et dont certains comptent parmi les principaux exportateurs d’armes, sont-ils donc désarmés ?
L’impasse transatlantique
L’élite politique américaine exprime depuis longtemps son inquiétude concernant l’effort de défense, ou son absence, des alliés européens. Même pendant la guerre froide, les États-Unis se sont montrés avec constance insatisfaits des contributions européennes à l’Alliance.
L’absence de forces terrestres suffisantes face à l’hypothèse d’une invasion soviétique a poussé les responsables militaires américains à faire pression en faveur du réarmement de l’Allemagne dès 1948 (avant même que le nouvel État ouest-allemand ne soit créé en mai 1949). Pour la même raison, Washington incita les Français à ratifier la Communauté européenne de défense (CED) : en décembre 1953, John Foster Dulles expliquait que si Paris ne jouait pas son rôle, une « douloureuse révision » de la politique étrangère des États-Unis à l’égard de l’Europe serait nécessaire…
Une décennie plus tard, dans le contexte de la coûteuse guerre du Vietnam, la volonté américaine de « partager le fardeau » se fit insistante, pesant sur les relations transatlantiques. Les alliés ne parvinrent jamais à se mettre d’accord sur les effectifs terrestres que les Européens devraient fournir, ni sur les montants budgétaires nécessaires. […]
PLAN DE L’ARTICLE
- L’impasse transatlantique
- L’Union européenne, acteur militaire failli ?
- Des menaces diversement perçues
- Les « trois grands » de l’Europe et les crises de Libye et de Syrie
- Les dépenses militaires de l’Europe : un bilan moins grave qu’on ne le croit ?
- Une fausse perception des dépenses militaires européennes
- Un nouveau militarisme européen est-il souhaitable ?
- Perspectives
Klaus Larres est titulaire de la chaire Richard M. Krasno Distinguished Professor en histoire et relations internationales à l’université de Caroline du Nord à Chapel Hill (UNC) et Senior Fellow à la School of Advanced International Studies (SAIS) de l’université Johns Hopkins à Washington.
Traduit de l’anglais par Dragos Bobu.
Il est possible de lire l’article en langue anglaise – The United States and the ‘Demilitarization’ of Europe: Myth or Reality?
Article publié dans Politique étrangère, vol. 79, n° 1, printemps 2014

Contenu disponible en :
Régions et thématiques
Utilisation
Comment citer cette publicationPartager
Téléchargez l'analyse complète
Cette page ne contient qu'un résumé de notre travail. Si vous souhaitez avoir accès à toutes les informations de notre recherche sur le sujet, vous pouvez télécharger la version complète au format PDF.
Une Europe démilitarisée ? Un regard américain
Centres et programmes liés
Découvrez nos autres centres et programmes de rechercheEn savoir plus
Découvrir toutes nos analysesFinancer le réarmement de l’Europe FED, EDIP, SAFE : les instruments budgétaires de l’Union européenne
Lors d’un séminaire de travail organisé début novembre 2025 à Bruxelles et rassemblant des agents de l’Union européenne (UE) et des représentants civilo-militaires des États membres, un diplomate expérimenté prend la parole : « Honestly, I am lost with all these acronyms » ; une autre complète : « The European Union machine is even complex for those who follow it. »
Cartographier la guerre TechMil. Huit leçons tirées du champ de bataille ukrainien
Ce rapport retrace l'évolution des technologies clés qui ont émergé ou se sont développées au cours des quatre dernières années de la guerre en Ukraine. Son objectif est d'analyser les enseignements que l'OTAN pourrait en tirer pour renforcer ses capacités défensives et se préparer à une guerre moderne, de grande envergure et de nature conventionnelle.
L'Europe face au tournant de la DefTech. Repenser l'écosystème européen d'innovation de défense
« La façon dont je vois Iron Dome, c’est l’expression ultime de ce que sera le rôle des États-Unis dans les conflits futurs : non pas être les gendarmes du monde, mais en être l’armurerie », estimait en novembre 2023 Palmer Luckey, le fondateur d’Anduril, l’une des entreprises les plus en vue de la DefTech. L’ambition est claire : participer au réarmement mondial en capitalisant sur la qualité des innovations américaines et dominer le marché de l’armement, au moins occidental, par la maîtrise technologique.
Lance-roquettes multiples, une dépendance européenne historique et durable ?
Le conflit en Ukraine a souligné le rôle des lance-roquettes multiples (LRM) dans un conflit moderne, notamment en l’absence de supériorité aérienne empêchant les frappes dans la profondeur air-sol. De son côté, le parc de LRM européen se partage entre une minorité de plateformes occidentales à longue portée acquises à la fin de la guerre froide et une majorité de plateformes de conception soviétique ou post-soviétique axées sur la saturation à courte portée.












