Algérie-France : réflexions sur une crise
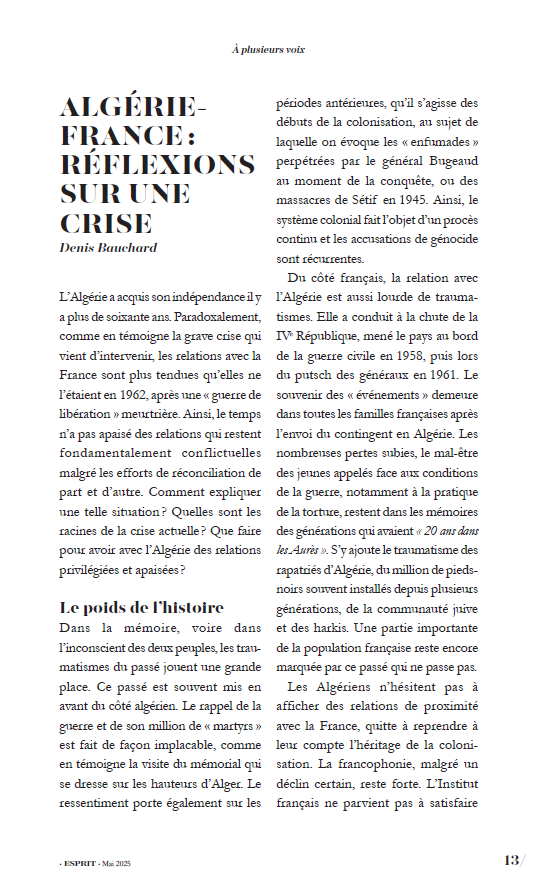
L’Algérie a acquis son indépendance il y a plus de soixante ans. Paradoxalement, comme en témoigne la grave crise qui vient d’intervenir, les relations avec la France sont plus tendues qu’elles ne l’étaient en 1962, après une « guerre de libération » meurtrière. Ainsi, le temps n’a pas apaisé des relations qui restent fondamentalement conflictuelles malgré les efforts de réconciliation de part et d’autre. Comment expliquer une telle situation ? Quelles sont les racines de la crise actuelle ? Que faire pour avoir avec l’Algérie des relations privilégiées et apaisées ?

Le poids de l’histoire
Dans la mémoire, voire dans l’inconscient des deux peuples, les traumatismes du passé jouent une grande place. Ce passé est souvent mis en avant du côté algérien. Le rappel de la guerre et de son million de « martyrs » est fait de façon implacable, comme en témoigne la visite du mémorial qui se dresse sur les hauteurs d’Alger. Le ressentiment porte également sur les périodes antérieures, qu’il s’agisse des débuts de la colonisation, au sujet de laquelle on évoque les « enfumades » perpétrées par le général Bugeaud au moment de la conquête, ou des massacres de Sétif en 1945. Ainsi, le système colonial fait l’objet d’un procès continu et les accusations de génocide sont récurrentes.
Du côté français, la relation avec l’Algérie est aussi lourde de traumatismes. Elle a conduit à la chute de la IVe République, mené le pays au bord de la guerre civile en 1958, puis lors du putsch des généraux en 1961. Le souvenir des « événements » demeure dans toutes les familles françaises après l’envoi du contingent en Algérie. Les nombreuses pertes subies, le mal‑être des jeunes appelés face aux conditions de la guerre, notamment à la pratique de la torture, restent dans les mémoires des générations qui avaient « 20 ans dans les Aurès ».
S’y ajoute le traumatisme des rapatriés d’Algérie, du million de piedsnoirs souvent installés depuis plusieurs générations, de la communauté juive et des harkis. Une partie importante de la population française reste encore marquée par ce passé qui ne passe pas. Les Algériens n’hésitent pas à afficher des relations de proximité avec la France, quitte à reprendre à leur compte l’héritage de la colonisation. La francophonie, malgré un déclin certain, reste forte. L’Institut français ne parvient pas à satisfaire la demande. Le rêve de tout jeune est d’obtenir un visa pour la France. Les élections en France sont suivies avec beaucoup plus d’attention, voire de passion, que les élections algériennes, qui se déroulent dans l’indifférence. Il y aurait en France près de trois millions de personnes d’origine algérienne, dont les deux tiers environ ont la nationalité française, avec de la famille des deux côtés de la Méditerranée, et de fréquentes allées et venues. La plupart des responsables algériens possèdent une maison ou un appartement, de même qu’un compte en banque, en France. Les Algériens font plus confiance aux chaînes de télévision françaises qu’aux médias algériens.
Dans ce contexte, les relations entre les deux pays sont trop souvent instrumentalisées de part et d’autre à des fins de politique intérieure. En Algérie, le meilleur moyen de disqualifier un homme, un parti politique ou un journal est de l’accuser d’appartenir au « parti de la France ». La même chose s’observe chez certains responsables français qui, visant la population d’origine algérienne, ne manquent pas d’exprimer leur islamophobie, de dénoncer la menace terroriste ou d’alerter contre la « submersion » migratoire.
Des contentieux multiples
En fait, des contentieux majeurs apparaissent dès le début de l’indépendance, les accords d’Évian n’étant pas respectés. Dans la dernière décennie, ils se sont accumulés.
L’Algérie reproche à la France, de façon continue et insistante, sa politique restrictive des visas, notamment lorsqu’en 2021, ils ont été divisés par moitié. Même si le nombre de visas a été augmenté depuis lors, il reste une source de contentieux permanente. Alger met en cause la procrastination de la France sur les demandes de dédommagement liées aux essais nucléaires au Sahara. Des éléments de politique étrangère sont également en cause : complaisance de la France à l’égard d’Israël ; biais reproché en faveur du Maroc, alors même que, jusqu’à une date récente, la position française se voulait équilibrée. La « théorie du complot » se répand volontiers dans l’opinion, entretenue par le pouvoir. L’objectif de la France serait d’« affaiblir l’Algérie ». Les services de renseignement français sont ainsi régulièrement pointés du doigt.
Du côté de Paris, on dénonce l’offensive contre le français en faveur d’une arabisation à marche forcée et la promotion de l’anglais. On critique le manque de transparence et un climat défavorable aux affaires pour les entreprises françaises. On s’agace du ton systématiquement hostile à l’égard de la France dans une presse algérienne de plus en plus liée aux autorités gouvernementales. On dénonce la mauvaise volonté d’Alger pour accepter ses ressortissants frappés d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF).
Pourtant, il y a eu, depuis l’indépendance, des efforts de part et d’autre pour promouvoir un véritable « traité de réconciliation ». Voulu par les présidents Chirac et Bouteflika, il entendait s’inspirer de celui réalisé avec l’Allemagne. Cette tentative a tourné court. Le président Macron reprend un tel dessein. Le rapport de Benjamin Stora, remis au président en janvier 2021, prône une approche pragmatique, suggérant un certain nombre d’initiatives (gestes symboliques sur le passé, création d’une commission « mémoire et vérité », ouverture des archives…) qui peuvent contribuer à une telle réconciliation. Mais sa mise en œuvre se fait sans gestes en retour, voire est reçue de façon hostile, ce qui est naturellement mal perçu par Paris. La « repentance » est exigée de façon particulièrement agressive dans des médias aux ordres, voire par certains ministres.
Une crise d’une gravité sans précédent
Des signes avant-coureurs apparaissent dès octobre 2021, date à laquelle les sources de crispations ponctuelles se multiplient. Les propos du président Macron sur la rente mémorielle, en octobre 2021, auprès de jeunes Maghrébins français, sont mal ressentis à Alger. En octobre 2023, l’accueil en France d’une opposante réfugiée en Tunisie et menacée d’extradition par l’Algérie est une source de crispation. Certaines accusations ne sont pas fondées : en mai 2023, un complot visant l’Algérie, réunissant les services de renseignement israéliens, marocains et français, est dénoncé par les médias algériens.
Cependant, la reconnaissance par la France, en juillet 2024, de la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental, suivie d’une visite officielle à Rabat du président Macron, qui scelle la réconciliation de la France avec le Maroc, est interprétée comme un casus belli par Alger. Il est le catalyseur de la grave crise qui se développe depuis lors. Le « retrait » de l’ambassadeur d’Algérie à Paris est décidé, tandis que son homologue à Alger est boycotté. Les entreprises françaises font l’objet de mesures discriminatoires. La crise connaît son paroxysme avec la conjonction de l’arrestation de l’écrivain franco-algérien Boualem Sansal, de l’expulsion d’influenceurs d’origine algérienne et du refus de l’Algérie de délivrer des laissez-passer consulaires après l’émission d’OQTF, alors que l’un d’entre eux commet une attaque terroriste meurtrière à Mulhouse le 22 février 2025. Le ministre de l’Intérieur, Bruno Retailleau, se sert de cette accumulation de faits pour lancer un ultimatum, menaçant Alger de mesures de rétorsion, comme la remise en cause de l’accord de 1968 sur les conditions d’accueil des ressortissants algériens. Certains n’hésitent pas à brandir la rupture des relations diplomatiques. La reconnaissance par la France, en juillet 2024, de la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental est interprétée comme un casus belli par Alger. L’entretien téléphonique du 31 mars 2025 entre les présidents Macron et Tebboune met un terme à une surenchère non maîtrisée. Le ministre des Affaires étrangères est dépêché à Alger pour « renouer le dialogue fructueux » ouvert par la déclaration d’août 2022, faite à l’occasion du voyage officiel du président français en Algérie. En fait, aucune avancée de fond n’est réalisée : il est convenu simplement de « réactiver les mécanismes de coopération franco-algérienne », en passant en revue tous les aspects, y compris le domaine mémoriel. Mais l’accalmie est restée provisoire. En effet, le 11 avril dernier, une décision de justice relative à « l’affaire Amor DZ » – influenceur algérien réfugié en France, qualifié de « subversif » par Alger et ayant fait l’objet de plusieurs demandes d’extradition – débouche sur la mise en examen et en détention provisoire de trois ressortissants algériens, dont un agent consulaire. Alger y voit une nouvelle « manœuvre » de M. Retailleau et décide l’expulsion de douze agents du ministère de l’Intérieur détachés près de notre ambassade, à laquelle la France a répondu par l’expulsion de douze agents consulaires algériens et le rappel de l’ambassadeur pour consultation. Cette décision laisse entrevoir le risque de représailles en cascade. On peut craindre que l’engrenage des mesures et contre-mesures ne s’engage à nouveau, ce qui ne peut conduire qu’à une impasse.
À l’évidence, cette crise, qui n’est pas terminée, ne sera pas la dernière. On peut toutefois en tirer quelques leçons. Le premier constat est que la relation avec l’Algérie reste particulièrement sensible, notamment en raison du poids de l’histoire. Il ne faut pas qu’elle verse dans le registre émotionnel, même si elle est de part et d’autre un problème intérieur volontiers instrumentalisé à des fins politiques, voire politiciennes. Le rôle joué par le ministre français de l’Intérieur en est l’illustration.
Une deuxième leçon est qu’il n’y a pas encore eu rupture car, des deux côtés de la Méditerranée, on a conscience que les intérêts des deux pays sont suffisamment forts pour l’empêcher. Ces intérêts sont économiques, avec un pays qui est tourné encore fortement vers la France et l’Europe par ses ressources énergétiques, comme par sa dépendance vis-à-vis de l’extérieur dans de nombreux domaines. La coopération sécuritaire est également majeure entre les deux pays : tant que le chaos règne au Moyen-Orient, le temps du terrorisme n’est pas révolu.
Enfin, on peut parler d’intérêts culturels, voire affectifs, partagés. Par-delà les critiques virulentes, c’est l’intérêt porté à la France par les Algériens qui frappe lorsqu’on voyage en Algérie. L’obsession de la jeunesse pour des visas permettant des études en France en témoigne. Enfin, les postures et les déclarations tonitruantes ne font qu’envenimer des situations sans résoudre les problèmes. La diplomatie a ses vertus pour les relations avec l’Algérie comme pour d’autres pays.
Certes, il y a des forces qui, en Algérie comme en France, plaident en faveur d’un désengagement, voire d’une rupture. En Algérie, celles-ci peuvent jouer en ce sens : une armée qui est largement tournée vers la Russie et qui revendique un passé glorieux contre la France ; l’Association des moudjahidine, qui cultive une francophobie primaire ; des islamistes encore influents. Mais l’essentiel de la population n’est dupe ni sur le régime ni sur le récit qui instrumentalise la relation avec la France. L’influence croissante de pays comme l’Italie, l’Espagne, la Turquie ou les États-Unis montre la volonté du pouvoir algérien de diversifier ses interlocuteurs. Le Canada est devenu une destination privilégiée par ceux qui ne peuvent pas émigrer en France. Ainsi la place de la France est-elle déjà contestée. Une dégradation des relations entre les deux pays ne peut avoir qu’un effet accélérateur de cette évolution.
Il faut laisser le temps au temps et souhaiter que l’active société civile algérienne fasse évoluer un régime qui ne saurait être éternel. L’ampleur du mouvement du Hirak, qui a été ressenti par le régime comme une menace existentielle, montre qu’il y a d’autres solutions possibles dans l’avenir. On peut estimer qu’avec les nouvelles générations, le souvenir de la guerre de libération et de l’époque coloniale s’estompera, et que la relation entre la France et l’Algérie restera privilégiée et deviendra plus apaisée.
Denis Bauchard est un ancien diplomate, conseiller pour l’Afrique du Nord et le Moyen-Orient à l’Ifri, il a notamment publié Le Moyen-Orient au défi du chaos. Un demi-siècle d’échecs et d’espoirs (Hémisphères, 2021).
>> Article paru dans la revue "Esprit", mai 2025, p. 13-17. Téléchargez le pdf ci-dessous

Contenu disponible en :
Thématiques et régions
Utilisation
Comment citer cette publicationPartager
Téléchargez l'analyse complète
Cette page ne contient qu'un résumé de notre travail. Si vous souhaitez avoir accès à toutes les informations de notre recherche sur le sujet, vous pouvez télécharger la version complète au format PDF.
Algérie-France : réflexions sur une crise
Centres et programmes liés
Découvrez nos autres centres et programmes de rechercheEn savoir plus
Découvrir toutes nos analysesLe Canada et la reconnaissance de l'État palestinien
Le 21 septembre 2025, le Canada est devenu le 148ème pays à reconnaître l'État palestinien. Cette mesure a été coordonnée avec le Royaume-Uni et l'Australie en face d'une forte opposition américaine et israélienne.
La République d’Irlande et la question palestinienne
Depuis le milieu du XXᵉ siècle, la politique étrangère de la République d’Irlande s’est construite sur un double héritage qui lui confère une position unique parmi les États d’Europe occidentale.
Turquie 2050 - Train ITI ; Mansur Yavaş ; Turquie - Syrie
Repères sur la Turquie n° 34 - Le programme « Turquie 2050 » développe une analyse prospective sur les thèmes de la diplomatie, de la politique intérieure et de l’économie turques afin d’y anticiper les dynamiques des trente prochaines années.
Turquie 2050 - Corridors ; Communauté LGBTI ; Turquie - Chypre Nord
Repères sur la Turquie n° 33 - Le programme « Turquie 2050 » développe une analyse prospective sur les thèmes de la diplomatie, de la politique intérieure et de l’économie turques afin d’y anticiper les dynamiques des trente prochaines années.













