Vers la fin de la guerre?
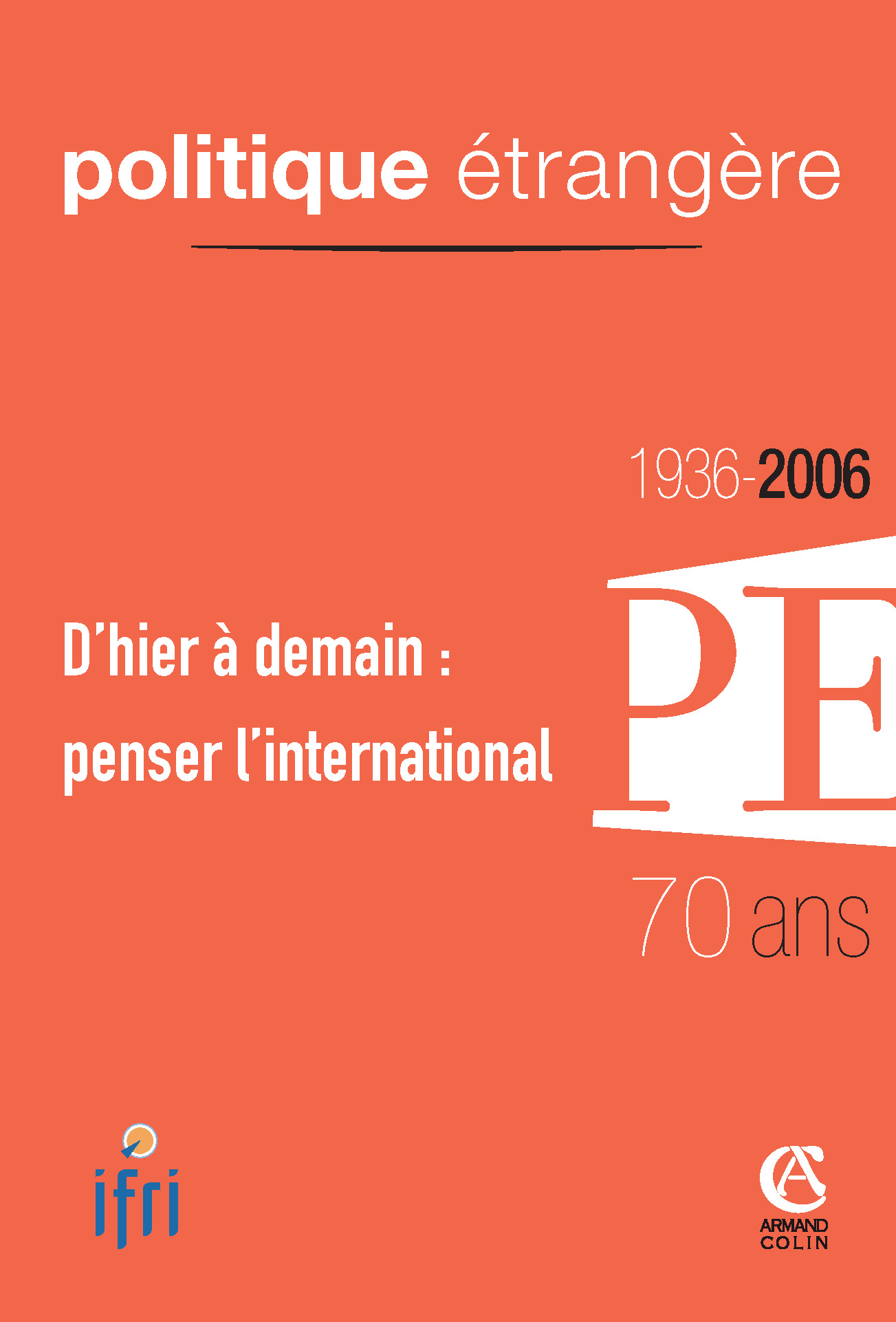
Longtemps considérée non seulement comme légitime mais de surcroît comme souhaitable, la guerre a connu une perte sensible de légitimité après la Première et la Seconde Guerre mondiale. Le regain relatif de légitimité qui a suivi la fin de la guerre froide –avec la multiplication des opérations militaires à vocation humanitaire– ne suffira pas à inverser la tendance. Il se pourrait même que la forme de conflits aujourd’hui dominante, la guerre civile, connaisse à son tour un réel déclin.

Au cours du XXe siècle, la guerre a perdu en légitimité. En conséquence – du moins est-ce une des raisons pouvant être invoquées – les guerres interétatiques, et plus spécifiquement les guerres entre États développés, sont devenues extrêmement rares. Ce déclin est un phénomène sans précédent dans l’histoire et certains éléments permettent de supposer qu’il pourrait en être de même pour les guerres civiles.
La légitimité traditionnelle de la guerre
Voici une centaine d’années, la guerre était encore vue non seulement comme légitime mais, de surcroît, comme une chose positive. Comme le souligne l’historien militaire Michael Howard, « avant 1914, la guerre était presque universellement considérée comme un moyen acceptable – voire inévitable ou même désirable – de résoudre les différends internationaux ».
Cinq ans avant d’écrire son Traité de paix perpétuelle, Emmanuel Kant soutenait encore qu’« une paix prolongée favorise la prépondérance d’un esprit purement marchand – dont découlent un égoïsme, une lâcheté et un manque de virilité dégradants – et tend à souiller la vertu de la nation ». Alexis de Tocqueville concluait que « la guerre ouvre l’esprit du peuple et rehausse son caractère ». Quant à Frédéric le Grand, il faisait remarquer que « la guerre est la mère de toutes les vertus, car à chaque instant rayonnent la loyauté, la compassion, la magnanimité et l’héroïsme ».
Certains en déduisaient que des guerres périodiques étaient nécessaires pour préserver la nation de la décadence de la paix. Pour Nietzsche, « c’[était] une pure illusion et une idée futile que d’attendre quoi que ce soit du genre humain s’il oubli[ait] comment faire la guerre ». J. A. Cramb, un professeur britannique, proclamait quant à lui que la paix universelle « plongerait le monde dans une béatitude bovine ». En 1871, Ernest Renan soutenait que la guerre « [était] une des conditions du progrès, le coup de fouet qui empêch[ait] un pays de s’endormir, contraignant la médiocrité satisfaite à quitter son apathie ». En 1891, Émile Zola déclarait : « [La guerre], c’est la vie… Nous sommes condamnés à manger ou être mangés afin que le monde puisse continuer à vivre. Seules les nations belliqueuses ont prospéré. […]
PLAN DE L’ARTICLE
- La légitimité traditionnelle de la guerre
- La perte de légitimité de la guerre : l’impact des guerres mondiales
- Un relatif regain de légitimité de la guerre après la guerre froide
- La guerre légitime : un potentiel limité
- L’impact de la guerre en Irak sur la nouvelle (et relative) légitimité de la guerre
- La fin de la guerre ?
John Mueller, président de la Woody Hayes Chair of National Security Studies au Mershon Center for International Security Studies, est professeur de sciences politiques à l’Ohio State University. Il est membre de l’American Academy of Arts and Sciences et son dernier ouvrage Overblown (New York, Free Press, 2006) traite du terrorisme et de l’exacerbation de la menace.
Téléchargez l'analyse complète
Cette page ne contient qu'un résumé de notre travail. Si vous souhaitez avoir accès à toutes les informations de notre recherche sur le sujet, vous pouvez télécharger la version complète au format PDF.
Vers la fin de la guerre?
Centres et programmes liés
Découvrez nos autres centres et programmes de rechercheEn savoir plus
Découvrir toutes nos analysesLe Bangladesh entre crise politique et montée de l'islamisme
Le mouvement « Students Against Discrimination », à l'origine des manifestations de l'été 2024, a cristallisé le mécontentement d'une jeunesse confrontée à la réinstauration d'un quota controversé pour les descendants des muktijoddhas (les « combattants pour la liberté » de la guerre d'indépendance de 1971), après quinze années de dérive autoritaire de la Première ministre Sheikh Hasina.
Avant-propos
Dans ce numéro spécial de Politique étrangère consacré aux actes de la Conférence organisée par l'Ifri le 10 avril 2019 au Grand amphithéâtre de la Sorbonne, à l'occasion de son quarantième anniversaire, découvrez l'avant-propos de Thierry de Montbrial, fondateur et président de l'Ifri.
Avant-propos
Dans ce numéro spécial de Politique étrangère consacré aux actes de la Conférence organisée par l'Ifri le 10 avril 2019 au Grand amphithéâtre de la Sorbonne, à l'occasion de son quarantième anniversaire, découvrez l'avant-propos de Thierry de Montbrial, fondateur et président de l'Ifri.
L'Europe et l'Afrique
Dans ce numéro spécial de Politique étrangère consacré aux actes de la Conférence organisée par l'Ifri le 10 avril 2019 au Grand amphithéâtre de la Sorbonne, à l'occasion de son quarantième anniversaire, découvrez l'entretien entre Thierry de Montbrial, fondateur et président de l'Ifri et Louise Mushikiwabo, ancienne ministre des Affaires étrangères du Rwanda, secrétaire générale de La Francophonie.












