Armes à sous-munitions et mines antipersonnel. La maîtrise des armements face aux menaces existentielles
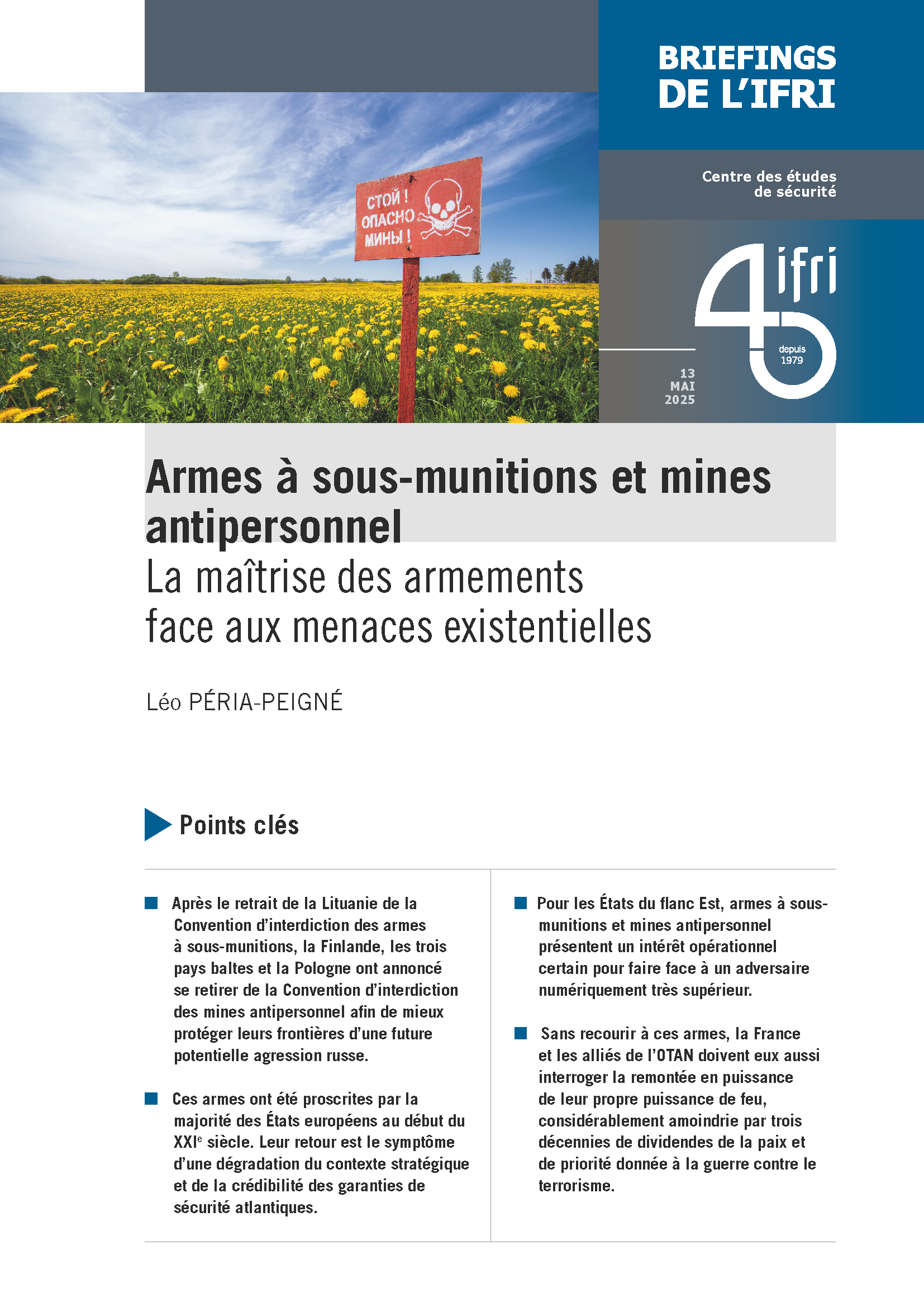
Face à la menace d’une agression russe à l’Est de l’Europe, la Finlande, les pays baltes et la Pologne tournent le dos à des décennies d’interdiction des mines antipersonnel et des armes à sous-munitions, marquant le retour d’armes longtemps proscrites au nom de la sécurité de leurs frontières.

- Après le retrait de la Lituanie de la Convention d’interdiction des armes à sous-munitions, la Finlande, les trois pays baltes et la Pologne ont annoncé se retirer de la Convention d’interdiction des mines antipersonnel afin de mieux protéger leurs frontières d’une future potentielle agression russe.
- Ces armes ont été proscrites par la majorité des États européens au début du XXIe siècle. Leur retour est le symptôme d’une dégradation du contexte stratégique et de la crédibilité des garanties de sécurité atlantiques.
- Pour les États du flanc Est, armes à sous-munitions et mines antipersonnel présentent un intérêt opérationnel certain pour faire face à un adversaire numériquement très supérieur.
- Sans recourir à ces armes, la France et les alliés de l’OTAN doivent eux aussi
interroger la remontée en puissance de leur propre puissance de feu, considérablement amoindrie par trois décennies de dividendes de la paix et de priorité donnée à la guerre contre le terrorisme.
Le 6 mars 2025, la Lituanie officialisait son retrait de la convention d’Oslo, adoptée par une centaine d’États en 2008. Cette convention cherche à interdire l’emploi, le développement et le commerce des armes à sous-munitions (cluster ammunitions) en raison des ravages que celles-ci ont occasionné à travers le monde depuis leur première utilisation au cours de la Seconde Guerre mondiale. Dix jours plus tard, l’Estonie, la Lettonie, la Lituanie et la Pologne annonçaient conjointement leur intention de se retirer de la convention d’Ottawa, autre texte de maîtrise des armements signée en 1997 afin d’interdire l’emploi, le développement et le commerce de mines antipersonnel, un texte que la Finlande (non-signataire de la convention d’Oslo) a aussi annoncé vouloir quitter le 1er avril 2025.
L’affaiblissement de ces deux textes importants du Droit international humanitaire (DIH) et de la maîtrise des armements a provoqué une vive réaction en Europe, diverses organisations humanitaires critiquant la décision des pays du flanc Est, parlant de « mépris flagrant pour la souffrance humaine » tandis que des chercheurs mettaient sur le même plan la Russie et les pays cherchant à s’en défendre. De telles accusations ne sont pas nouvelles – Amnesty International avait ainsi reproché à l’Ukraine de se battre au sein des villes que la Russie envahissait – mais elles soulignent une rupture entre les réalités du contexte stratégique actuel et la volonté d’encadrement juridique du droit international. Ce décalage est d’autant plus important que les traités en question datent d’une époque révolue où la donne stratégique était bien différente et la menace d’une invasion russe était perçue comme inexistante.
Plutôt qu’une critique de principe, il est d’abord nécessaire de comprendre le choix des alliés concernés dans sa dimension stratégique et opérationnelle, et d’en anticiper les conséquences pour le dispositif militaire de l’Organisation du traité de l’Atlantique nord (OTAN) en Europe.

Contenu disponible en :
Thématiques et régions
ISBN / ISSN
Utilisation
Comment citer cette publicationPartager
Téléchargez l'analyse complète
Cette page ne contient qu'un résumé de notre travail. Si vous souhaitez avoir accès à toutes les informations de notre recherche sur le sujet, vous pouvez télécharger la version complète au format PDF.
Armes à sous-munitions et mines antipersonnel. La maîtrise des armements face aux menaces existentielles
Centres et programmes liés
Découvrez nos autres centres et programmes de rechercheEn savoir plus
Découvrir toutes nos analysesFinancer le réarmement de l’Europe FED, EDIP, SAFE : les instruments budgétaires de l’Union européenne
Lors d’un séminaire de travail organisé début novembre 2025 à Bruxelles et rassemblant des agents de l’Union européenne (UE) et des représentants civilo-militaires des États membres, un diplomate expérimenté prend la parole : « Honestly, I am lost with all these acronyms » ; une autre complète : « The European Union machine is even complex for those who follow it. »
Cartographier la guerre TechMil. Huit leçons tirées du champ de bataille ukrainien
Ce rapport retrace l'évolution des technologies clés qui ont émergé ou se sont développées au cours des quatre dernières années de la guerre en Ukraine. Son objectif est d'analyser les enseignements que l'OTAN pourrait en tirer pour renforcer ses capacités défensives et se préparer à une guerre moderne, de grande envergure et de nature conventionnelle.
L'Europe face au tournant de la DefTech. Repenser l'écosystème européen d'innovation de défense
« La façon dont je vois Iron Dome, c’est l’expression ultime de ce que sera le rôle des États-Unis dans les conflits futurs : non pas être les gendarmes du monde, mais en être l’armurerie », estimait en novembre 2023 Palmer Luckey, le fondateur d’Anduril, l’une des entreprises les plus en vue de la DefTech. L’ambition est claire : participer au réarmement mondial en capitalisant sur la qualité des innovations américaines et dominer le marché de l’armement, au moins occidental, par la maîtrise technologique.
Lance-roquettes multiples, une dépendance européenne historique et durable ?
Le conflit en Ukraine a souligné le rôle des lance-roquettes multiples (LRM) dans un conflit moderne, notamment en l’absence de supériorité aérienne empêchant les frappes dans la profondeur air-sol. De son côté, le parc de LRM européen se partage entre une minorité de plateformes occidentales à longue portée acquises à la fin de la guerre froide et une majorité de plateformes de conception soviétique ou post-soviétique axées sur la saturation à courte portée.















