La crise indo-pakistanaise du printemps 2025 : reflet d’un conflit en mutation
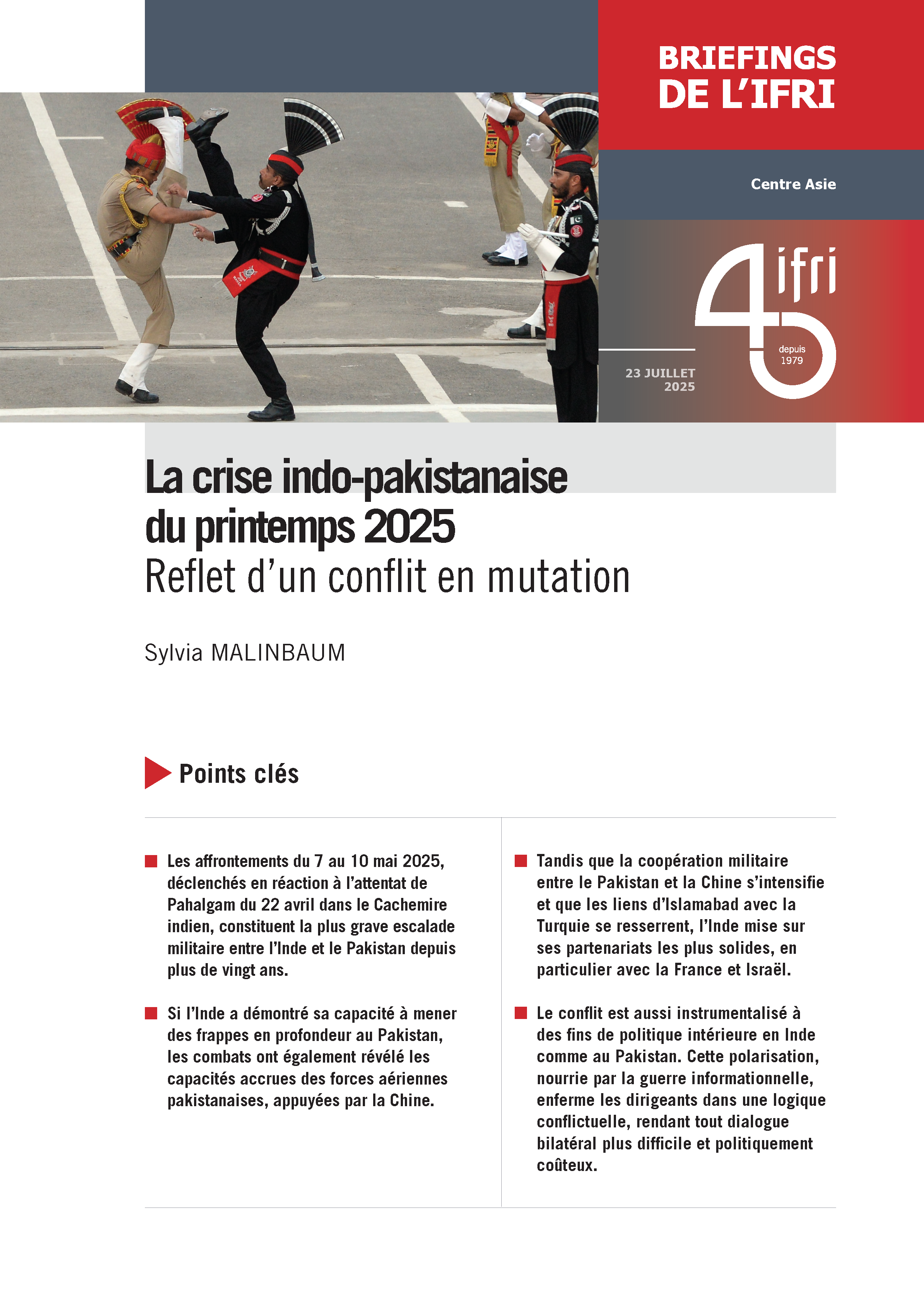
Les affrontements du 7 au 10 mai 2025, déclenchés après l’attentat de Pahalgam du 22 avril, représentent la plus grave escalade militaire entre l’Inde et le Pakistan depuis plus de 20 ans. Cette crise met en lumière des transformations profondes du conflit indo-pakistanais, analysées en détail dans ce Briefing de Sylvia Malinbaum.

Titre
Points clés
Les affrontements du 7 au 10 mai 2025, déclenchés en réaction à l’attentat de Pahalgam du 22 avril dans le Cachemire indien, constituent la plus grave escalade militaire entre l’Inde et le Pakistan depuis plus de vingt ans.
Si l’Inde a démontré sa capacité à mener des frappes en profondeur au Pakistan, les combats ont également révélé les capacités accrues des forces aériennes pakistanaises, appuyées par la Chine.
Tandis que la coopération militaire entre le Pakistan et la Chine s’intensifie et que les liens d’Islamabad avec la Turquie se resserrent, l’Inde mise sur ses partenariats les plus solides, en particulier avec la France et Israël.
Le conflit est aussi instrumentalisé à des fins de politique intérieure en Inde comme au Pakistan. Cette polarisation, nourrie par la guerre informationnelle, enferme les dirigeants dans une logique conflictuelle, rendant tout dialogue bilatéral plus difficile et politiquement coûteux.
Le Cachemire, pomme de discorde historique entre l’Inde et le Pakistan, a une nouvelle fois été au cœur de la crise indo-pakistanaise déclenchée par l’attentat de Pahalgam survenu le 22 avril au Jammu-et-Cachemire. Cette attaque, qui a coûté la vie à 25 citoyens indiens et un ressortissant népalais, a profondément choqué l’opinion publique indienne. Elle a mis à mal la politique de normalisation conduite par le gouvernement Modi au Cachemire depuis l’abrogation de l’article 370 en 2019, qui a supprimé l’autonomie constitutionnelle du Jammu-et-Cachemire.
Historiquement, le conflit autour du Cachemire est intrinsèquement lié à la formation des États modernes d’Inde et du Pakistan. En 1947, au moment de la partition, l’État princier du Jammu-et-Cachemire, dirigé par le maharaja Hari Singh, envisageait de rester indépendant. Mais l’invasion de la région par des tribus armées venues de la province de la Frontière du Nord-Ouest (actuel Pakistan) a conduit à l’intervention militaire indienne, une fois que le maharaja eut signé l’acte d’accession. Cette première guerre indo-pakistanaise (1947-1948) provoqua des massacres, des déplacements massifs de population et une division territoriale qui perdure aujourd’hui.
Depuis la fin des années 1980, le Cachemire est devenu un foyer majeur du terrorisme transfrontalier, avec l’émergence d’une insurrection armée islamiste souvent appuyée par les services secrets pakistanais, provoquant des dizaines de milliers de morts et l’exode de quelque 250 000 hindous cachemiris (les Pandits).
C’est dans ce contexte de tensions chroniques que s’inscrivent les événements du printemps 2025. Rapidement attribué par les autorités indiennes à un groupe encore peu connu, le Front de résistance – présenté comme une émanation du Lashkar-e-Taiba (LeT) –, l’attentat de Pahalgam a relancé les tensions avec Islamabad. Le Pakistan a immédiatement nié toute implication, son ministre de la Défense allant jusqu’à accuser New Delhi d’avoir orchestré lui-même l’attentat.
En représailles à l’attentat, l’Inde a lancé le 7 mai 2025 l’opération Sindoor, consistant en une série de frappes aériennes ciblées contre neuf sites identifiés comme des camps d’entraînement ou des bases opérationnelles des groupes Jaish-e-Mohammed et LeT. Les frappes ont visé des positions situées à la fois dans le Cachemire administré par le Pakistan et plus en profondeur, au Pendjab pakistanais. New Delhi a qualifié cette intervention de « ciblée, mesurée et non escalatoire », en soulignant que les frappes avaient été menées en mode « stand-off » – sans pénétration de l’espace aérien pakistanais – et qu’aucune cible militaire n’avait été visée.
En riposte, le Pakistan a déployé une vingtaine de chasseurs incluant des J-10C et des JF-17 — dont certains équipés de missiles PL-15 de conception chinoise. À l’issue de cette première séquence d’engagements, le Pakistan aurait perdu un JF-17, tandis que l’Inde aurait perdu au moins trois appareils : un Mirage 2000, un Rafale et un MiG-29. Ces pertes, cependant, n’ont pas été officiellement reconnues par les deux parties.
Dans la nuit du 7 au 8 mai, Islamabad a lancé des attaques de drones (notamment des Songar turcs) contre une quinzaine de bases aériennes en Inde, qui a répondu le lendemain par des frappes ciblées de drones israéliens Harop, infligeant des dommages significatifs à la défense antiaérienne pakistanaise.
En réaction, le Pakistan a déclenché l’opération Bunyan-um-Marsoos, consistant en plusieurs attaques aériennes (drones et chasseurs) menées le 8 et 9 mai, qui auraient ciblé des objectifs civils dans une vingtaine de villes indiennes des régions frontalières, des centres de commandement et de contrôle ainsi qu’un système de défense sol-air à longue portée (S-400). Les défenses aériennes indiennes semblent avoir efficacement intercepté la plupart de ces attaques.
Dans la nuit du 9 au 10 mai, la crise a basculé avec une intensification des frappes aériennes indiennes frappant au moins onze sites de l’armée de l’Air pakistanaise, ciblant des pistes, radars, hangars et centres de commandement. Parmi les sites figureraient la base stratégique de Nur Khan – proche du centre de commandement nucléaire – et le complexe militaire de Sardogha – à proximité de potentiels sites de stockage nucléaire –, marquant une nette escalade.
La désescalade est survenue dans les dernières heures du 10 mai, sous pression internationale, notamment américaine. Des communications entre les chefs militaires des deux pays ont permis de sceller l’arrêt des combats. Le cessez-le-feu a été annoncé publiquement par le président Donald Trump sur son réseau Truth Social, avant d’être confirmé par son secrétaire d’État Marco Rubio, qui a déclaré sur X que les gouvernements de l’Inde et du Pakistan avaient accepté « de commencer des pourparlers sur un large éventail de questions dans un lieu neutre ».
Cette déclaration représente une victoire diplomatique pour le Pakistan, alors que New Delhi s’oppose fermement à toute multilatéralisation des négociations tant que la question du terrorisme reste non résolue. En outre, la mise sur un pied d’égalité de l’Inde et du Pakistan par Washington a profondément courroucé New Delhi, qui estime être la victime d’un terrorisme soutenu par l’État pakistanais. En parallèle des affrontements aériens, la ligne de contrôle au Cachemire a été le théâtre d’intenses échanges de tirs d’artillerie pendant cette crise, mettant fin au cessez-le-feu en vigueur depuis 202110. L’Inde a également déployé quelques jours après l’attentat le groupe aéronaval INS Vikrant dans la mer d’Arabie, procédant à des tirs d’essai pour maintenir la marine pakistanaise dans une posture défensive. Le cyberespace s’est quant à lui imposé comme un autre théâtre d’opérations, avec une série d’attaques et de contre-attaques visant des infrastructures critiques.
Par la diversité des domaines impliqués et l’intensité des actions engagées, les quatre journées d’affrontement du 7 au 10 mai 2025 représentent la plus grave escalade militaire entre l’Inde et le Pakistan depuis plus de vingt ans. Si cette crise s’inscrit dans un cadre de tensions historiques et de différends persistants, elle se distingue par des caractéristiques propres, révélatrices des transformations profondes qui affectent le conflit indo- pakistanais.

Contenu disponible en :
Thématiques et régions
ISBN / ISSN
Utilisation
Comment citer cette publicationPartager
Téléchargez l'analyse complète
Cette page ne contient qu'un résumé de notre travail. Si vous souhaitez avoir accès à toutes les informations de notre recherche sur le sujet, vous pouvez télécharger la version complète au format PDF.
La crise indo-pakistanaise du printemps 2025 : reflet d’un conflit en mutation
Centres et programmes liés
Découvrez nos autres centres et programmes de rechercheEn savoir plus
Découvrir toutes nos analysesLa politique américaine envers Taïwan, au delà de Donald Trump : cartographie des acteurs américains des relations entre les États-Unis et Taïwan
Le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche a ravivé une incertitude profonde quant à l’engagement des États-Unis en matière de sécurité envers Taïwan. Contrairement au président Joe Biden, qui a maintes fois réaffirmé sa détermination à défendre l’île, Donald Trump évite soigneusement de se prononcer sur une éventuelle réaction américaine en cas de crise dans le détroit de Taïwan.
Japon : le raz-de-marée Takaichi et le nouveau visage du pouvoir
La Première ministre Sanae Takaichi a transformé sa popularité exceptionnelle en une victoire politique historique. Les élections anticipées du 8 février ont offert au Parti libéral démocrate (PLD) une majorité écrasante, grâce au soutien massif de jeunes électeurs séduits par son image iconoclaste et dynamique, et des conservateurs rassurés par sa vision d’affirmation nationale. Cette popularité pose les bases d’une stratégie ambitieuse tant sur le plan intérieur que sur le plan international.
Élections en Thaïlande : les conservateurs consolident leur ancrage
À rebours des sondages, le parti conservateur pro-business Bhumjaithai a dominé les élections législatives anticipées du 8 février 2026 et s’est imposé à la Chambre basse avec 193 sièges sur 500, enregistrant une progression record par rapport aux 71 députés élus en 2023.
Crise politique en Thaïlande : la tactique du chaos
La Thaïlande a replongé à l’été 2025 dans une crise politique profonde. La suspension de la Première ministre, Paetongtarn Shinawatra, par la Cour constitutionnelle a provoqué l’implosion de la coalition au pouvoir. Cette crise ressemble pourtant aux précédentes. Une banalité répétitive qui interroge à la fois le sens des responsabilités des principaux dirigeants et qui génère au sein de la population un cynisme mâtiné de résignation.













