National Perspectives on Europe's De-risking from China
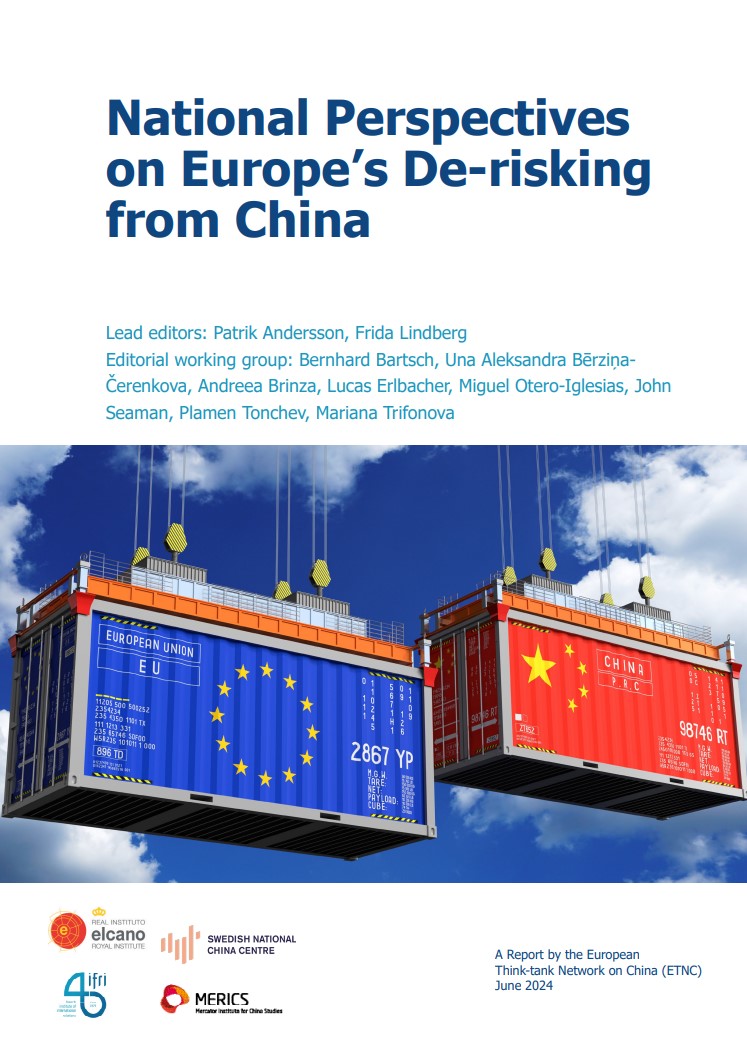

Le rapport de cette année du European Think-tank Network on China (ETNC), dont l'Ifri est un membre cofondateur, examine comment 21 États membres de l'UE et le Royaume-Uni considèrent et abordent le "de-risking" dans leur contexte national, y compris les mesures pratiques qu'ils ont prises pour mettre en œuvre cette politique qui fait couler beaucoup d'encre.
Le rapport met en évidence la diversité des approches nationales de l'agenda européen en matière de réduction des risques. Il présente les débats internes des pays (ou leur absence), met en évidence les préoccupations et les risques communs associés à la Chine, suit les mesures de réduction des risques adoptées au niveau national et examine les obstacles potentiels à la réduction des risques de l'Europe vis-à-vis de la Chine. Au lieu d'une mise en œuvre uniforme et cohérente de la politique de l'UE, la situation ressemble davantage à un "jeu du téléphone", chaque pays suivant sa propre interprétation et sa propre approche. Le rapport propose une cartographie de ces perspectives nationales, en regroupant les pays en trois catégories : les partisans de la première heure, les partisans et les suiveurs, les adeptes de la prudence et les opposants.
France : Des sous-entendus chinois dans une quête plus large de sécurité économique
Dans ce rapport, John Seaman de l'Ifri explique que la France est un partisan du "de-risking", à la fois comme moyen de se prémunir contre un glissement vers un découplage plus profond avec la Chine et dans le cadre d'une approche plus large visant à renforcer la sécurité économique et à atteindre une plus grande souveraineté économique pour l'UE. À ce titre, la France est considérée comme un "défenseur de la première heure" de l'approche du "de-risking", dans la mesure où Paris a été un partisan proactif de cette approche avant même qu'elle ne devienne un concept directeur pour la Commission européenne. En effet, le pouvoir économique et les ambitions croissantes de la Chine sont une source d'inquiétude pour les autorités françaises et les entreprises françaises. Cependant, ils constituent une préoccupation parmi d'autres, car la politique de puissance sape de plus en plus les piliers d'un ordre économique plus libéral fondé sur des règles. En pratique, aux niveaux national et européen, la France a activement poursuivi le développement d'outils de politique industrielle offensifs pour stimuler la compétence et la résilience économiques, ainsi que des mesures défensives pour protéger les infrastructures critiques et les actifs économiques stratégiques et se prémunir contre les fuites de technologies et de savoir-faire clés. Bien que ces politiques soient considérées comme nécessaires, la France a également cherché à éviter de contrarier directement Pékin dans le processus.
Ce rapport est disponible uniquement en anglais ici : National Perspectives on Europe's De-risking from China (PDF)
Découvrez les rapports de l'ETNC sur le site web du réseau : https://etnc.info/
Centres et programmes liés
Découvrez nos autres centres et programmes de rechercheEn savoir plus
Découvrir toutes nos analysesLa politique américaine envers Taïwan, au delà de Donald Trump : cartographie des acteurs américains des relations entre les États-Unis et Taïwan
Le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche a ravivé une incertitude profonde quant à l’engagement des États-Unis en matière de sécurité envers Taïwan. Contrairement au président Joe Biden, qui a maintes fois réaffirmé sa détermination à défendre l’île, Donald Trump évite soigneusement de se prononcer sur une éventuelle réaction américaine en cas de crise dans le détroit de Taïwan.
Japon : le raz-de-marée Takaichi et le nouveau visage du pouvoir
La Première ministre Sanae Takaichi a transformé sa popularité exceptionnelle en une victoire politique historique. Les élections anticipées du 8 février ont offert au Parti libéral démocrate (PLD) une majorité écrasante, grâce au soutien massif de jeunes électeurs séduits par son image iconoclaste et dynamique, et des conservateurs rassurés par sa vision d’affirmation nationale. Cette popularité pose les bases d’une stratégie ambitieuse tant sur le plan intérieur que sur le plan international.
Élections en Thaïlande : les conservateurs consolident leur ancrage
À rebours des sondages, le parti conservateur pro-business Bhumjaithai a dominé les élections législatives anticipées du 8 février 2026 et s’est imposé à la Chambre basse avec 193 sièges sur 500, enregistrant une progression record par rapport aux 71 députés élus en 2023.
Crise politique en Thaïlande : la tactique du chaos
La Thaïlande a replongé à l’été 2025 dans une crise politique profonde. La suspension de la Première ministre, Paetongtarn Shinawatra, par la Cour constitutionnelle a provoqué l’implosion de la coalition au pouvoir. Cette crise ressemble pourtant aux précédentes. Une banalité répétitive qui interroge à la fois le sens des responsabilités des principaux dirigeants et qui génère au sein de la population un cynisme mâtiné de résignation.
















