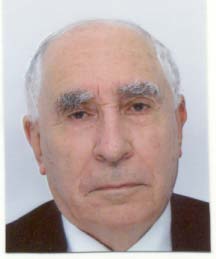A propos du changement climatique : Quand les médias jouent les spéculateurs

Le changement climatique, par les risques qu’il entraîne, l’horizon qu’il oblige à considérer, la variété de ses impacts possibles, contribue à révéler le fonctionnement du système d’information actuel.
A cet égard, de 2008 à 2010, les médias se sont comportés comme des spéculateurs en bourse. De 2008 à la réunion de Copenhague, ils cherchent à faire monter les cours, à convaincre l’opinion que la survie de l’humanité est en jeu. Dans leurs phrases, ils remplacent le conditionnel par des futurs ; dans leurs images, ils font rapidement fondre la banquise, monter l’eau des océans, s’étendre les déserts. Un seul changement d’orientation : à l’approche de Copenhague, ils délaissent la description du futur pour se concentrer sur les propositions des hommes politiques qui vont permettre à cette réunion historique de changer le cours de l’humanité. La kermesse se doit d’entériner un protocole consensuel qu’il n’y aura plus qu’à appliquer.
Patatras ! Cela ne se passe pas ainsi : un Président américain auquel le Congrès ne laisse pas les mains libres, une Europe satisfaite d’elle-même mais incapable de manœuvrer une Inde et une Chine prêtes à agir, mais sans compromettre leur croissance…Résultat un texte sans statut juridique, même s’il constitue un réel progrès.
Volte-face des médias : ils spéculent à la baisse, insistent sur l’échec et cherchent à vendre à leur public que le sujet n’est peut-être qu’un épouvantail à moineaux. Les points de vue de quelques scientifiques, des erreurs relevées dans le rapport du GIEC et l’on espère capter à nouveau l’intérêt de l’opinion en pédalant en sens inverse.
Nul doute que dans le prochain demi-siècle, plusieurs de tels cycles seront observés. Pour conserver la tête froide, il faut distinguer trois ordres d’informations :
1 - Il y a d’abord les mesures sur le passé et le présent rendues de plus en plus précises grâce aux progrès de la géologie et de la climatologie. Dans le monde scientifique, ces faits ne sont pratiquement contestés par personne.
2 - Il y a ensuite l’interprétation théorique susceptible d’expliquer ces faits. Dans ce domaine, le débat n’est jamais clos, de nouvelles théories peuvent naître. Constatons simplement qu’actuellement l’énorme majorité des scientifiques adhèrent à l’explication d’un changement climatique amorcé par les émissions de gaz à effet de serre (GES) émises par l’homme. Aux scientifiques qui contestent - et qui ne sont pas ceux dont l’ego est le moins développé- de convaincre leurs collègues plutôt que, faute d’y réussir, jeter le trouble dans l’esprit de tous.
3 - Il y a enfin les projections sur l’avenir du climat sous différentes hypothèses. On entre dans le domaine de la prospective pour laquelle l’avenir n’est jamais écrit, parce qu’il est engendré par un mélange de nécessité, de hasard et de volonté. Dans ce domaine, les projections faites à partir de modèles impliquent de nombreuses hypothèses de nature technologique, économique, sociologique et politique. Les scénarios de prospective n’ont donc pas le même statut que les mesures ou leurs interprétations. Leurs incertitudes, leurs faiblesses sont-elles une raison pour ne pas tenir compte de leurs résultats ? Evidemment non, puisque nous ne pouvons éviter de faire des conjectures pour agir. Il est d’ailleurs amusant de constater que certains médias prêts à en appeler à tort et à travers au principe de précaution n’y font pas référence dans ce cas. Se préparer à gérer le risque climatique n’a pour l’humanité aucun effet irréversible de grande ampleur alors que la stratégie de l’immobilisme peut conduire à des conséquences graves.
Laissons donc à leur ouvrage les spéculateurs et concentrons-nous sur deux domaines qu’il ne faut pas sous-estimer :
- le développement des technologies permettant l’utilisation efficace de l’énergie et la réduction des émissions de GES,
- la mise au point progressive d’une gouvernance mondiale aidant l’humanité à répondre aux défis que soulève la globalisation.
A force de soumettre l’opinion aux chauds et froids climatiques, on finira par la rendre amorphe et désabusée.

Contenu disponible en :
Régions et thématiques
Utilisation
Comment citer cette publicationPartager
Centres et programmes liés
Découvrez nos autres centres et programmes de rechercheEn savoir plus
Découvrir toutes nos analysesL'UE en état d'alerte : priorité sur les enjeux énergétiques et industriels pour 2026
L'année 2025 a confirmé qu'il était nécessaire de se préparer à un environnement géoéconomique et géopolitique plus difficile, car l'intensité et la fréquence des chocs augmentent, tandis que l'Union européenne (UE) n'a plus de flancs stables, dans un contexte de fréquentes crises avec les États-Unis, révélatrices d’une fracture systémique.
De l'IRA à l'OBBA : les entreprises françaises de l'énergie aux États-Unis
Adopté en 2022 sous l’administration Biden, l’Inflation Reduction Act (IRA) a marqué un tournant historique dans la politique énergétique américaine, offrant une visibilité supposée de long terme et attirant les investissements. De 2022 à 2024, les investissements américains dans les énergies propres ont atteint près de 500 milliards de dollars (+ 71 % en deux ans).
Le rôle clé de la Chine dans les chaînes de valeur des minerais critiques
La Chine occupe aujourd’hui une position dominante dans les chaînes de valeur des minerais critiques, de l’extraction à la transformation jusqu’aux technologies en aval. Cette suprématie repose sur des décennies de politiques industrielles et lui confère une influence stratégique considérable sur la sécurité d’approvisionnement mondiale, notamment pour l’Union européenne.
Le rôle de la course aux métaux stratégiques dans les conflits actuels
Les métaux critiques font l’objet de rivalités telles qu’il faut se préparer à ce que les rapports de force pour leur contrôle se transforment en conflits armés, déstabilisant potentiellement des régions, voire États. Les cas de la République démocratique du Congo, ou de la Birmanie, sont symptomatiques de ces évolutions. À terme, les risques pèsent aussi sur les chaines de valeur plus larges liées aux métaux, et notamment le segment de la logistique, qui est essentiel et représente un point de vulnérabilité majeur potentiellement exploitable par le crime organisé, des organisations armées et / ou des États.