Indo-Pacifique : un concept flottant ? / Peut-on stabiliser le Sahel ?
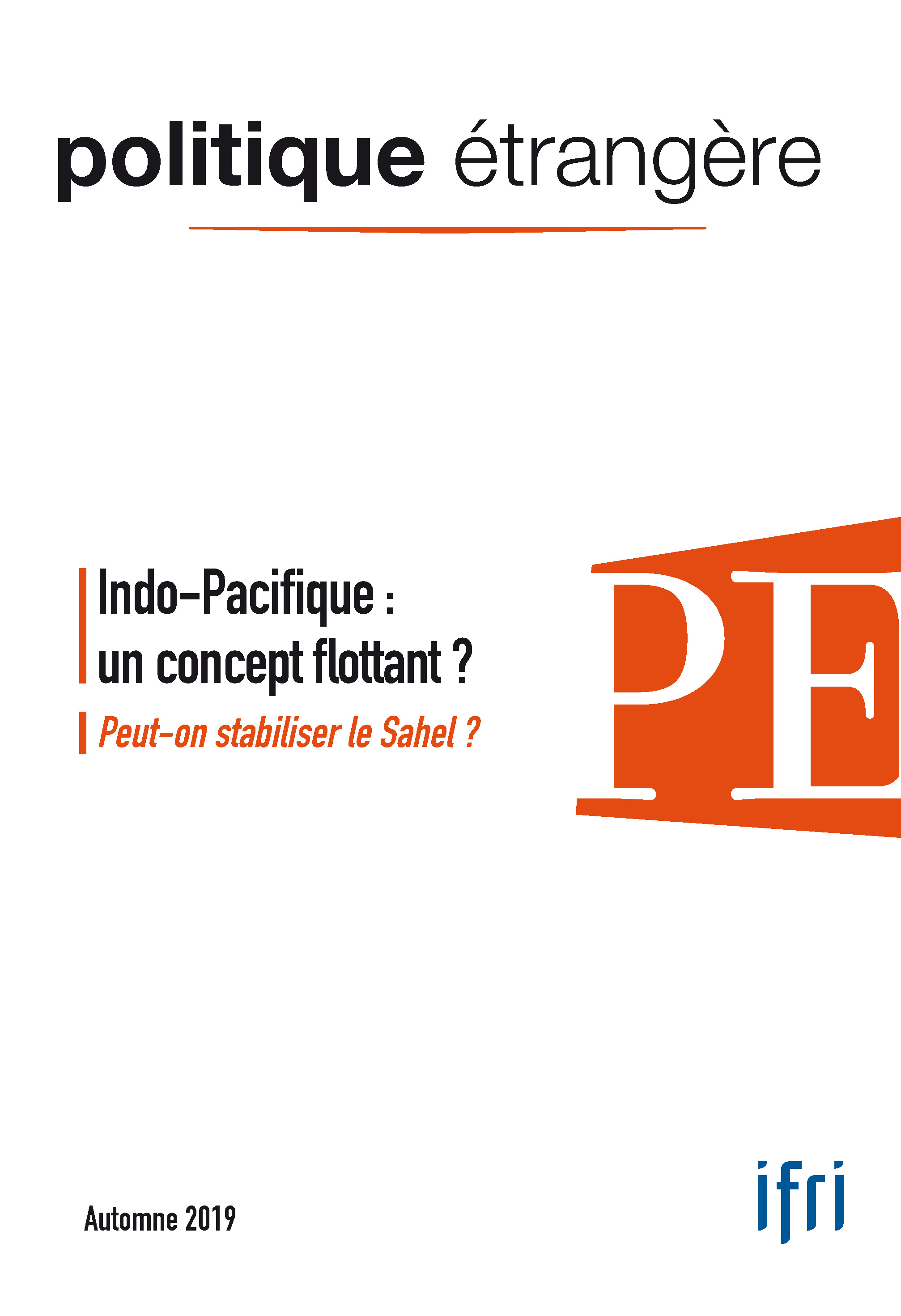
Indo-Pacifique : le concept, qui n’a que quelques années, veut exprimer une nouvelle structure de la mondialisation de la planète. En termes d’échanges économiques, et de distribution de puissance, c’est bien une zone unitaire qui se dessine du golfe Arabo-Persique au Pacifique, où se croisent, se mesurent, s’affrontent toutes les grandes puissances.

Il faut penser cette aire nouvelle, et les moyens d’y agir : dispositifs politiques, économiques et militaires.
Mais ce concept d’Indo-Pacifique est aussi une tentative d’encadrer la montée en puissance chinoise, de la brider dans un entrelacs de puissances limitant son poids. L’acceptera-t-elle ? Et pourra-t-on organiser la coexistence d’intérêts si divers, dans une zone si vaste, en tenant compte des spécificités régionales et locales ?
Le dossier de Politique étrangère pèse la pertinence d’un concept qui tente de penser une zone stratégique-pivot.
Autre espace d’importance, particulièrement pour les Européens : le Sahel – qui fait l’objet de la rubrique Contrechamps de ce numéro. Ce Sahel si proche de nous est-il condamné à la misère et à la violence ? Les États de la région parviendront-ils à rétablir leur autorité sur leur propre espace ? Les forces de sécurité à protéger les populations, et non à les insécuriser ? Et l’aide internationale a-t-elle vraiment pris la mesure des causes multiples de l’instabilité de la région, qui dépassent de beaucoup ce que nous résumons au terme de terrorisme ?
INDO-PACIFIQUE : UN CONCEPT FLOTTANT ?
De l’Indo-Pacifique à l’Océanie : une part oubliée du monde ?, par François Gaulme
La France et le concept d’Indo-Pacifique, par Christian Lechervy
La stratégie indo-pacifique de l’administration Trump : une difficile émergence, par Jean-Loup Samaan
L’Indo-Pacifique aux couleurs de la Chine, par Rory Medcalf
Les petits pays insulaires du Pacifique face aux changements climatiques, par Hervé Raimana Lallemant-Moe
CONTRECHAMPS
PEUT-ON STABILISER LE SAHEL ?
La stabilisation du Sahel, nouveau rocher de Sisyphe ?, par Jean-Marc Châtaigner
Sahel : soubassements d’un désastre, par Alain Antil (lire l'article)
ACTUALITÉS
L’UE est-elle prête pour les prochains défis migratoires ?, par Matthieu Tardis (lire l'article)
REPÈRES
Altermondialisme : vingt ans après la « bataille de Seattle », par Eddy Fougier et Anna Dimitrova
Allemagne-Namibie : enjeux d’une réconciliation post-coloniale, par Stephan Martens
LIBRES PROPOS
Comment brider le financement de la prolifération des armes de destruction massive ?, par Jean Masson
Les défenses anti-missiles américaines en question, par Adrien Schu
LECTURES
Sous la responsabilité de Marc Hecker
Of Privacy and Power: The Transatlantic Struggle over Freedom and Security, d'Henry Farrell et Abraham Newman
The Age of Surveillance Capitalism. The Fight for a Human Future at the New Frontier of Power, de Shoshanna Zuboff
Géopolitique des données numériques. Pouvoir et conflits à l’heure du Big Data, d'Amaël Cattaruzza
Par Julien Nocetti

Contenu disponible en :
Régions et thématiques
Utilisation
Comment citer cette publicationPartager
Téléchargez l'analyse complète
Cette page ne contient qu'un résumé de notre travail. Si vous souhaitez avoir accès à toutes les informations de notre recherche sur le sujet, vous pouvez télécharger la version complète au format PDF.
Indo-Pacifique : un concept flottant ? / Peut-on stabiliser le Sahel ?
En savoir plus
Découvrir toutes nos analyses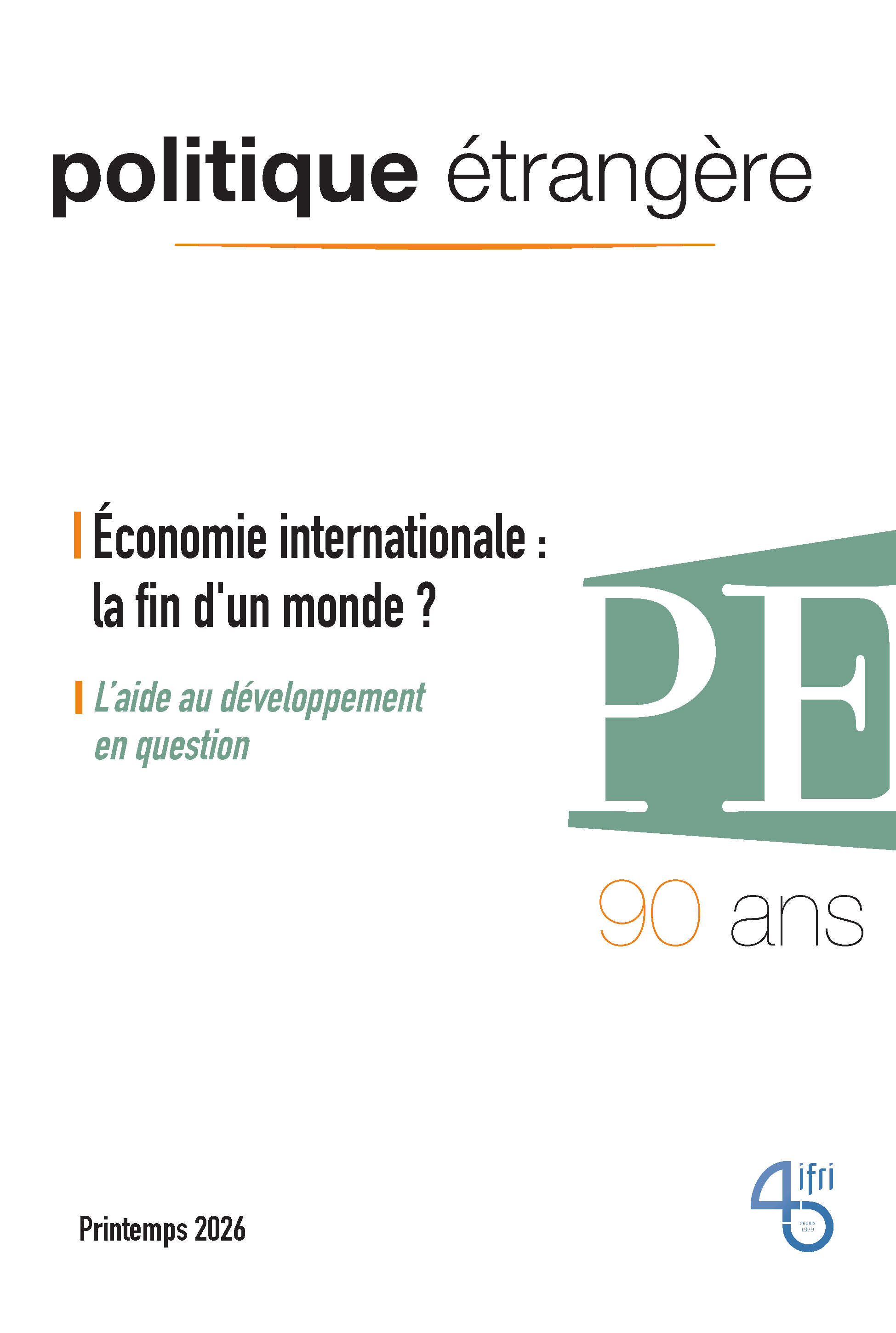
Économie internationale : la fin d'un monde ? / Politique étrangère, vol. 91, n° 1, 2026
L’économie mondiale est devenue le champ privilégié d’affrontement des volontés de puissance d’un monde où l’entente, la coordination et le multilatéralisme concerté semblent durablement marginalisés. Dans cette logique éclatée, comment s’articuleront les stratégies américaine et chinoise ? L’Union européenne arrivera-t-elle à briser le cadre de ses références multi-décennales pour s’affronter aux concurrences nouvelles ? Et pourra-t-elle, comme d’autres, avec d’autres, intégrer le virage annoncé d’une économie de production vers une économie numérique, de l’information ? Et quel rôle joueront dans cette économie internationale en transition les institutions financières et, en particulier, les banques centrales ?
Le Bangladesh entre crise politique et montée de l'islamisme
Le mouvement « Students Against Discrimination », à l'origine des manifestations de l'été 2024, a cristallisé le mécontentement d'une jeunesse confrontée à la réinstauration d'un quota controversé pour les descendants des muktijoddhas (les « combattants pour la liberté » de la guerre d'indépendance de 1971), après quinze années de dérive autoritaire de la Première ministre Sheikh Hasina.
Avant-propos
Dans ce numéro spécial de Politique étrangère consacré aux actes de la Conférence organisée par l'Ifri le 10 avril 2019 au Grand amphithéâtre de la Sorbonne, à l'occasion de son quarantième anniversaire, découvrez l'avant-propos de Thierry de Montbrial, fondateur et président de l'Ifri.
Avant-propos
Dans ce numéro spécial de Politique étrangère consacré aux actes de la Conférence organisée par l'Ifri le 10 avril 2019 au Grand amphithéâtre de la Sorbonne, à l'occasion de son quarantième anniversaire, découvrez l'avant-propos de Thierry de Montbrial, fondateur et président de l'Ifri.










