Justice et économie mondiale
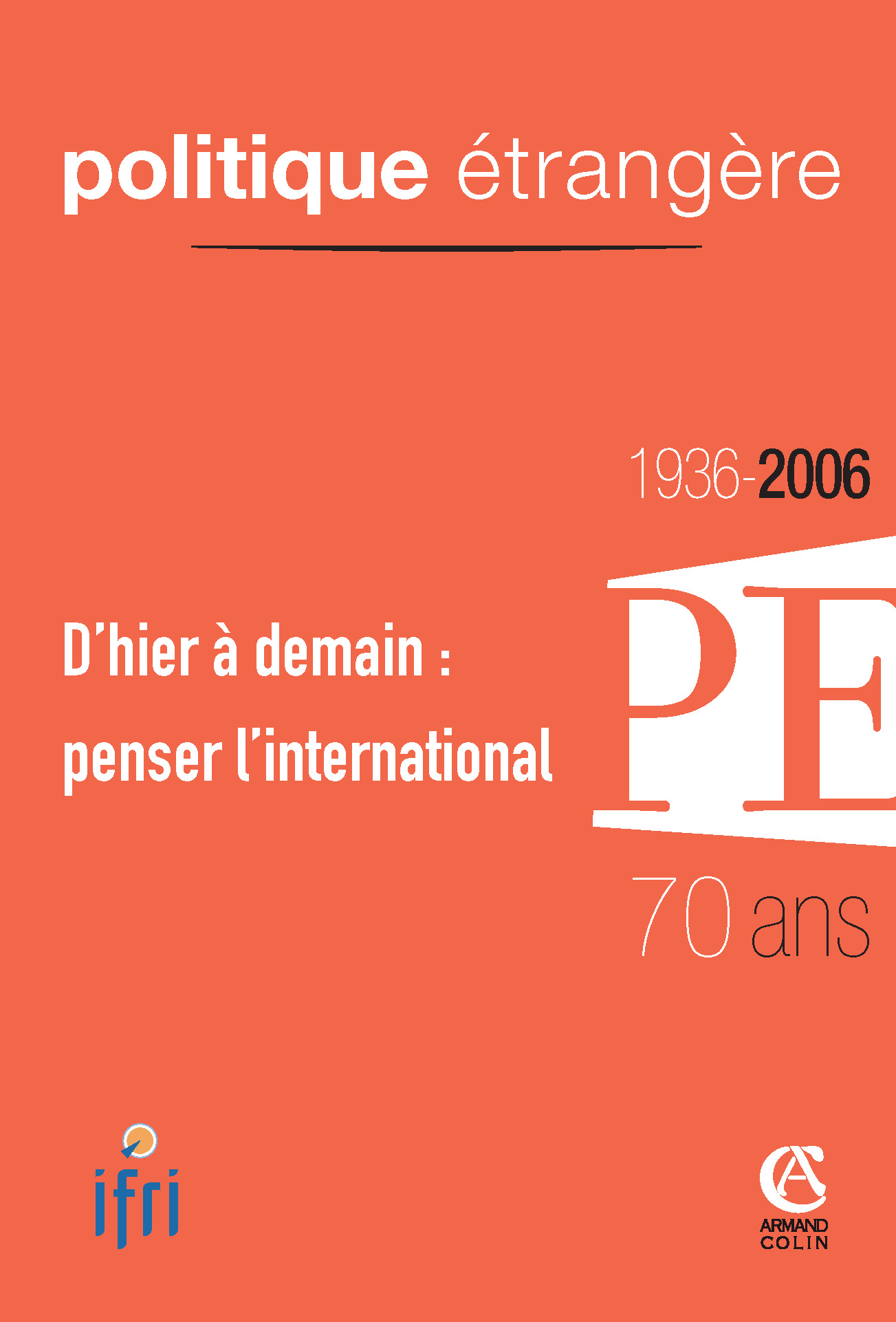
La 'justice économique internationale' n’est pas une notion aisée à définir. On tente ici de spécifier trois approches possibles de ce concept: une approche 'communautariste', une approche 'internationaliste libérale' et une approche 'cosmopolitiste'. Cette dernière, qui entend apporter la justice aux pauvres du monde, prend de plus en plus de place dans le débat international, y compris à travers l’action d’institutions comme la Banque mondiale ou le Fonds monétaire international.

Au-delà des griefs catégoriels, nombre d’activistes, d’officiels ou de spécialistes en sont venus à considérer la politique économique internationale actuelle et les résultats qui y sont associés comme fondamentalement « injustes », en particulier envers les « pauvres », les « sans qualification » et envers de nombreux pays, notamment en voie de développement.
Un analyste politique de Washington a qualifié la politique commerciale protectionniste des États-Unis et de l’Union européenne de « scandale éthique », tandis que le représentant américain au Commerce taxait les subventions européennes à l’agriculture « d’immorales ». Le ministre belge des Affaires étrangères a proclamé la nécessité d’une « mondialisation éthique », alors que l’ancien Haut-Commissaire des Nations unies aux droits de l’homme, Mary Robinson, lançait une Initiative pour une mondialisation éthique. L’ancien président de la Banque mondiale, James Wolfensohn, s’est lamenté : « quelque chose va de travers dans l’économie mondiale », tandis que son ancien économiste en chef Joseph Stiglitz, prix Nobel, remarquait avec désinvolture : « Bien sûr, nul n’espérait que le marché mondial serait juste… »
Dans les pays industrialisés, beaucoup de critiques mettent l’accent sur l’effet dissolvant de la mondialisation, surtout vis-à-vis des travailleurs sans qualification et du fonctionnement de l’État providence en général. Il faudrait avancer plus prudemment dans l’ouverture des marchés, pour éviter de déchirer les contrats sociaux nationaux. La recherche de justice économique implique donc des compromis entre divers objectifs.
On tentera ici de formaliser plusieurs conceptions contemporaines de la justice (ou de l’injustice) économique internationale. Ceci, en décrivant trois « modèles » permettant d’identifier les inquiétudes normatives essentielles exprimées à propos de la mondialisation et de ses conséquences économiques.
La justice économique internationale : modèles et données
Le problème de la justice économique ou distributive est fondamentalement lié aux principes et règles qui déterminent comment les sociétés allouent les biens, services et revenus, ainsi qu’aux schémas d’allocation qui en découlent. […]
PLAN DE L’ARTICLE
- La justice économique internationale : modèles et données
- Le modèle communautariste : mondialisation et contrat social intérieur
- Le modèle internationaliste libéral : le commerce international et la promesse de la convergence économique
- Le modèle cosmopolitique : apporter la justice aux pauvres du monde
- De la théorie à la politique : la justice économique et le système international
Ethan B. Kapstein, titulaire de la chaire de développement durable Paul Dubrule à l’INSEAD, est professeur associé au Center for Global Development et chercheur associé à l’Ifri. Son dernier ouvrage est : Economic Justice in an Unfair World: Toward a Level Playing Field (Princeton, Princeton University Press, 2006).

Contenu disponible en :
Régions et thématiques
Utilisation
Comment citer cette publicationPartager
Téléchargez l'analyse complète
Cette page ne contient qu'un résumé de notre travail. Si vous souhaitez avoir accès à toutes les informations de notre recherche sur le sujet, vous pouvez télécharger la version complète au format PDF.
Justice et économie mondiale
En savoir plus
Découvrir toutes nos analysesLe Bangladesh entre crise politique et montée de l'islamisme
Le mouvement « Students Against Discrimination », à l'origine des manifestations de l'été 2024, a cristallisé le mécontentement d'une jeunesse confrontée à la réinstauration d'un quota controversé pour les descendants des muktijoddhas (les « combattants pour la liberté » de la guerre d'indépendance de 1971), après quinze années de dérive autoritaire de la Première ministre Sheikh Hasina.
Avant-propos
Dans ce numéro spécial de Politique étrangère consacré aux actes de la Conférence organisée par l'Ifri le 10 avril 2019 au Grand amphithéâtre de la Sorbonne, à l'occasion de son quarantième anniversaire, découvrez l'avant-propos de Thierry de Montbrial, fondateur et président de l'Ifri.
Avant-propos
Dans ce numéro spécial de Politique étrangère consacré aux actes de la Conférence organisée par l'Ifri le 10 avril 2019 au Grand amphithéâtre de la Sorbonne, à l'occasion de son quarantième anniversaire, découvrez l'avant-propos de Thierry de Montbrial, fondateur et président de l'Ifri.
L'Europe et l'Afrique
Dans ce numéro spécial de Politique étrangère consacré aux actes de la Conférence organisée par l'Ifri le 10 avril 2019 au Grand amphithéâtre de la Sorbonne, à l'occasion de son quarantième anniversaire, découvrez l'entretien entre Thierry de Montbrial, fondateur et président de l'Ifri et Louise Mushikiwabo, ancienne ministre des Affaires étrangères du Rwanda, secrétaire générale de La Francophonie.








