L'Afrique et le XXe siècle : dépossession, renaissance, incertitudes
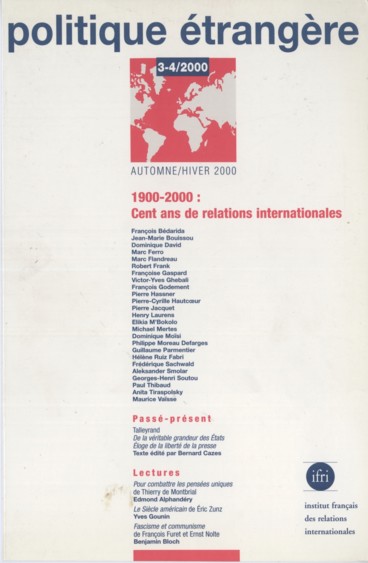
L’histoire de l’Afrique au XXe siècle semble encore aujourd’hui, à plus d’un titre, toujours à faire. Dans un monde où domine la vision des grandes puissances et des institutions qui en ont émané, la place de l’Afrique dans les relations internationales oscille ainsi, presque à défaut, entre la gloire et la tristesse : gloire d’un continent qui a su reconquérir en partie ce dont il avait été dépossédé par la colonisation, tristesse d’une Afrique apparemment souveraine où le meilleur ne l’a que rarement emporté sur le pire. Et pourtant, si la dépossession et la renaissance du continent n’ont cessé d’être mêlées dans un même processus historique de construction de l’indépendance, une Afrique nouvelle se dessine depuis le début des années 80, plus autonome et plus ouverte, mais aussi plus diverse et plus complexe que ne le laissait présager le paysage assez homogène de l’indépendance retrouvée.

Réduite à la lecture dominante des relations internationales qui fait la part belle aux États et à leurs organismes ainsi qu'aux structures et institutions internationales, l'histoire de l'Afrique au XXe siècle apparaîtrait bien simple, pauvre et triste pour les uns, glorieuse pour les autres : d'abord, une Afrique dépossédée, avec des territoires dominés par les colonisateurs au début du siècle ; puis, à partir de la fin des années 50, une Afrique souveraine, avec des États modernes et indépendants, la prouesse représentée par ce retour à la souveraineté étant toutefois ternie par les difficultés à trouver une stabilité et un rythme cohérent de développement.
On sait que l'anthropologie et la sociologie nous ont donné une autre lecture, fondée essentiellement sur le couple antagoniste « tradition »/« modernité », dont on trouve l'une des toutes premières énonciations dès 1926, sous la plume de l'africaniste Maurice Delafosse : « De ce heurt imprévu entre deux civilisations, dont l'une [l'européenne] avait marché tandis que Vautre [l'africaine] était restée stationnaire, il est résulté fatalement une période de trouble et de malaise dont on se demande quelles seront la durée et l'issue. La culture européenne détruira-t-elle l’édifice social africain et y substituera-t-elle l’édifice social européen ? Ou bien la civilisation africaine résistera-t- elle victorieusement à l’emprise de la civilisation européenne ? Ou encore des réactions réciproques de l’une sur l’autre naîtra-t-il une civilisation intermédiaire qui conservera le fond africain en le déguisant sous une vêture européenne ? »
On voit enfin que les secousses qui ébranlent aujourd'hui maintes régions d'Afrique donnent lieu à d'autres interprétations encore, privilégiant la coupure du siècle entre un temps, relativement long, de la stabilité (coloniale et post-coloniale) et, depuis une décennie environ, un temps de la crise, temps court, certes, mais qui ouvrirait sur des incertitudes durables.
À l'opposé de ces lectures binaires, dont les éléments contradictoires se succèdent dans le temps tout en s'excluant, je dirais volontiers que le XXe siècle offre à l'analyse trois Afriques : les deux premières — l'Afrique dominée et l'Afrique renaissante — coexistent dès le début du siècle, quoique leurs origines et leurs caractéristiques remontent plus loin dans le passé ; la troisième - l'Afrique nouvelle - est bien un produit du siècle, dont le profil est visible dès les années 30. Ce sont les articulations instables de ces trois Afriques qui dessinent les configurations troublantes de l'Afrique au seuil du XXIe siècle.
PLAN DE L’ARTICLE
- L'Afrique dominée
- L'Afrique renaissante
- L'Afrique nouvelle
Elikia M’Bokolo est directeur d’études à l’École des hautes études en sciences sociales (EHESS).

Contenu disponible en :
Régions et thématiques
Utilisation
Comment citer cette publicationPartager
Téléchargez l'analyse complète
Cette page ne contient qu'un résumé de notre travail. Si vous souhaitez avoir accès à toutes les informations de notre recherche sur le sujet, vous pouvez télécharger la version complète au format PDF.
L'Afrique et le XXe siècle : dépossession, renaissance, incertitudes
En savoir plus
Découvrir toutes nos analysesLe Bangladesh entre crise politique et montée de l'islamisme
Le mouvement « Students Against Discrimination », à l'origine des manifestations de l'été 2024, a cristallisé le mécontentement d'une jeunesse confrontée à la réinstauration d'un quota controversé pour les descendants des muktijoddhas (les « combattants pour la liberté » de la guerre d'indépendance de 1971), après quinze années de dérive autoritaire de la Première ministre Sheikh Hasina.
Avant-propos
Dans ce numéro spécial de Politique étrangère consacré aux actes de la Conférence organisée par l'Ifri le 10 avril 2019 au Grand amphithéâtre de la Sorbonne, à l'occasion de son quarantième anniversaire, découvrez l'avant-propos de Thierry de Montbrial, fondateur et président de l'Ifri.
Avant-propos
Dans ce numéro spécial de Politique étrangère consacré aux actes de la Conférence organisée par l'Ifri le 10 avril 2019 au Grand amphithéâtre de la Sorbonne, à l'occasion de son quarantième anniversaire, découvrez l'avant-propos de Thierry de Montbrial, fondateur et président de l'Ifri.
L'Europe et l'Afrique
Dans ce numéro spécial de Politique étrangère consacré aux actes de la Conférence organisée par l'Ifri le 10 avril 2019 au Grand amphithéâtre de la Sorbonne, à l'occasion de son quarantième anniversaire, découvrez l'entretien entre Thierry de Montbrial, fondateur et président de l'Ifri et Louise Mushikiwabo, ancienne ministre des Affaires étrangères du Rwanda, secrétaire générale de La Francophonie.









