L’armée française et la révolution militaire de la Première Guerre mondiale
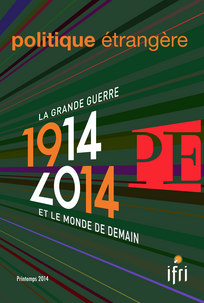
En 1914, la puissance de feu des armements modernes provoque une hécatombe. Pour limiter les pertes, les belligérants s’enterrent dans des tranchées. L’armée française est contrainte d’innover. Infanterie et artillerie subissent de profondes transformations. Les doctrines évoluent, permettant ainsi d’intégrer les nouveaux moyens – notamment chars et avions – aux schémas tactiques. En 1918, l’armée française, plus moderne et plus mobile que son adversaire allemand, finit par l’emporter.

Lorsque la Première Guerre mondiale s’achève, les armées engagées n’ont plus guère de ressemblance avec celles de 1914. Elles ressemblent en revanche beaucoup aux modèles d’armées actuels. Si les équipements aériens ou terrestres ont évidemment beaucoup évolué, leurs principes d’emploi ont presque tous été définis entre 1915 et 1918. Indice de l’évolution radicale imposée par cette guerre : un chef de groupe de combat d’infanterie de 1918 serait bien plus à l’aise dans un régiment de 2014 que dans ceux de 1914… Pour un pilote de chasse, un artilleur lourd ou un tankiste, la question ne se pose même pas, puisque leur emploi n’existait pas en 1914. Contrairement à une vision statique véhiculée par l’image des tranchées, la Grande Guerre a été l’occasion d’innovations radicales qui trouvent leur source dans la crise tactique naissant avec l’apparition des lignes fortifiées. À l’origine de nombreuses innovations tactiques et occupant en 1918 la première place dans plusieurs domaines techniques, comme la motorisation ou les moyens de transmission, l’armée française prend une part décisive à cette révolution militaire, au même titre que les armées allemande et britannique.
La crise tactique de 1914 et la première transformation de l’armée française
La première découverte majeure de la Grande Guerre est la puissance de feu des armes développées depuis 30 ans : fusils utilisant des munitions à poudre blanche, artillerie de campagne à tir rapide et mitrailleuse. L’arrivée décalée de ces innovations, leur diffusion encore modeste dans les armées qui avaient été engagées en Mandchourie et dans les Balkans n’avaient pas permis d’en mesurer pleinement les effets. C’est chose faite dès les premiers engagements d’août 1914 en France. Les pertes dépassent alors largement tout ce que l’on a pu connaître jusque-là : près de 80 000 soldats français sont tués du 13 au 30 août [1]. La première découverte majeure de la Grande Guerre est la puissance de feu des armes développées depuis 30 ans : fusils utilisant des munitions à poudre blanche, artillerie de campagne à tir rapide et mitrailleuse. L’arrivée décalée de ces innovations, leur diffusion encore modeste dans les armées qui avaient été engagées en Mandchourie et dans les Balkans n’avaient pas permis d’en mesurer pleinement les effets. C’est chose faite dès les premiers engagements d’août 1914 en France. Les pertes dépassent alors largement tout ce que l’on a pu connaître jusque-là : près de 80 000 soldats français sont tués du 13 au 30 août.
PLAN DE L’ARTICLE
- La crise tactique de 1914 et la première transformation de l’armée française
- La transformation de l’infanterie
- La création de l’artillerie lourde de campagne
- L’artillerie conquiert, l’infanterie occupe
- L’armée motorisée française gagne la guerre
- L’armée motorisée française
- Une nouvelle forme de manœuvre
- Les campagnes offensives
Michel Goya, officier de l’armée de Terre, breveté de l’École de guerre et docteur en histoire, a notamment publié Sous le feu. La mort comme hypothèse de travail (Paris, Tallandier, 2014).
Article publié dans Politique étrangère, vol. 79, n° 1, printemps 2014
Téléchargez l'analyse complète
Cette page ne contient qu'un résumé de notre travail. Si vous souhaitez avoir accès à toutes les informations de notre recherche sur le sujet, vous pouvez télécharger la version complète au format PDF.
L’armée française et la révolution militaire de la Première Guerre mondiale
Centres et programmes liés
Découvrez nos autres centres et programmes de rechercheEn savoir plus
Découvrir toutes nos analysesLance-roquettes multiples, une dépendance européenne historique et durable ?
Le conflit en Ukraine a souligné le rôle des lance-roquettes multiples (LRM) dans un conflit moderne, notamment en l’absence de supériorité aérienne empêchant les frappes dans la profondeur air-sol. De son côté, le parc de LRM européen se partage entre une minorité de plateformes occidentales à longue portée acquises à la fin de la guerre froide et une majorité de plateformes de conception soviétique ou post-soviétique axées sur la saturation à courte portée.
Vers une nouvelle maîtrise des armements ? Défis et opportunités de l’expiration de New START
Signé en 2010 entre Barack Obama et Dmitri Medvedev pendant une période de détente entre les deux grandes puissances, New START (New Strategic Arms Reduction Treaty) devrait – sauf revirement de dernière minute – expirer le 5 février 2026. Héritier des grands traités de réduction des armements stratégiques de la guerre froide entre l’URSS et les États-Unis, ce traité a permis de réduire les arsenaux nucléaires russes et américains de plus de 30 % par rapport au début du XXIe siècle, en instaurant des limites quantitatives sur le nombre de têtes nucléaires stratégiques déployées – c’est-à-dire immédiatement utilisables – et des mécanismes de transparence et de vérification mutuelles.
L’autonomisation dans le milieu sous-marin : une révolution sans limite ?
L’un des facteurs stratégiques déterminants de la guerre russo-ukrainienne en cours est le recours massif à des capacités dronisées, aériennes mais aussi maritimes et terrestres, qui révolutionnent la physionomie du champ de bataille. Pour autant, force est de constater qu’une partie significative de ces drones est encore télépilotée, téléopérée ou encore télésupervisée, attestant du fait que l’autonomisation des capacités militaires est encore en gestation.
Char de combat : obsolescence ou renaissance ?
Depuis février 2022, les forces russes et ukrainiennes ont perdu plus de 5 000 chars de combat, un volume très supérieur à l’ensemble du parc européen actuel. Fer de lance de la doctrine soviétique dont sont issus les deux belligérants, le char a été déployé en grand nombre et s’est avéré être une cible de choix pour des drones devenus de plus en plus nombreux et efficaces au fil des mois. Le grand nombre de vidéos de frappes de drone contre des chars a d’ailleurs poussé un certain nombre d’observateurs à conclure, une fois de plus, à l’obsolescence de ceux-ci sur un champ de bataille moderne. Cette approche doit être nuancée par une étude plus fine des pertes, les drones n’étant que rarement à l’origine de la perte elle-même causée par la conjugaison de plusieurs facteurs comme les mines, l’artillerie ou d’autres armes antichar.













