Le début de l'histoire : globalisation financière et relations internationales
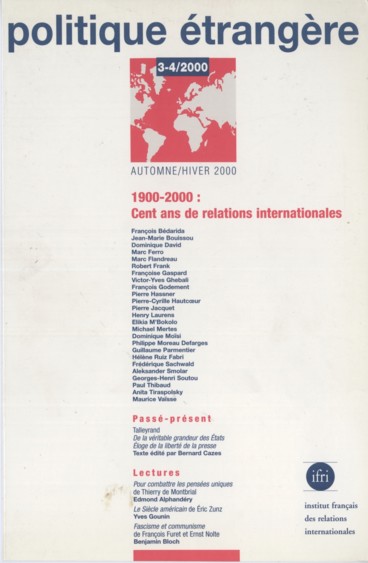
Avec la Première Guerre mondiale commencent à la fois le XXe siècle et la fin d’une période d’internationalisation économique et de régulation des déséquilibres par le marché : la crise de 1929 et la Seconde Guerre mondiale renforcent cette marche à l’étatisation des institutions de l’échange, du crédit, du travail et de la production. Puis, en deux décennies, à partir des années 70, ce mouvement s’inverse : les marchés se libéralisent, le libre-échange se propage, et l’ordre économique mondial, de nouveau, impose sa loi aux politiques nationales. Aux yeux de l’historien, il semble bien que la globalisation financière en cours soit au coeur d’un phénomène troublant : la résurgence, en pleine modernité, de la « civilisation du XIXe siècle ».
« On or about December 1910 human character changed. I am not saying that one went out, as one might into a garden, and there saw that a rose has flowered, or that a hen had laid an egg. The change was not sudden and definite like that. But a change there was, nevertheless ; and since one must be arbitrary, let us date it about the year 1910. »
V. Woolf, « Character in Fiction », dans Essays of Virginia Woolf 1919-1924

II y a un peu plus d'un demi-siècle, Karl Polanyi prononçait, dans La Grande transformation, l'oraison funèbre de la « civilisation du XIXe siècle ». Celle-ci avait reposé, disait-il, sur la croyance que les fonctions économiques essentielles au développement des nations pouvaient être assurées par le marché et, en quelque sorte, hors du cadre de la nation elle-même : l'ordre économique, transcendant la nation, avait ainsi été perçu comme forcément international. Mais une telle croyance, remarquait Polanyi, n'avait pas résisté aux deux guerres mondiales ni à la crise de 1929 qui marquèrent l'effondrement de l'internationalisme et le début d'une réorganisation économique sur des bases étatiques et nationales. En cette année 1944, Polanyi ne faisait que traduire un point de vue qui était l'épine dorsale de ce que l'on peut appeler le « consensus de Bretton Woods », puisque c'est la même année que fut signé le traité international sur lequel allait reposer l'architecture financière de l'après-guerre. S'il convenait certes de reconstruire un ordre occidental, celui-ci ne pouvait pas être capitaliste au vieux sens du terme, c'est-à-dire qu'il ne pouvait se fonder sur un ordre « naturel ». À ce programme tous adhérèrent, les Beveridge et les Roosevelt, les De Gaulle et les Adenauer. D'une certaine façon, plus conforme d'ailleurs aux idées de Schumpeter que de Marx — puisque c'étaient les bases idéologiques du système qui avaient été remises en cause -, le capitalisme était venu à bout de lui-même.
II y a un peu plus d'un demi-siècle, Karl Polanyi prononçait, dans La Grande transformation, l'oraison funèbre de la « civilisation du XIXe siècle ». Celle-ci avait reposé, disait-il, sur la croyance que les fonctions économiques essentielles au développement des nations pouvaient être assurées par le marché et, en quelque sorte, hors du cadre de la nation elle-même : l'ordre économique, transcendant la nation, avait ainsi été perçu comme forcément international. Mais une telle croyance, remarquait Polanyi, n'avait pas résisté aux deux guerres mondiales ni à la crise de 1929 qui marquèrent l'effondrement de l'internationalisme et le début d'une réorganisation économique sur des bases étatiques et nationales. En cette année 1944, Polanyi ne faisait que traduire un point de vue qui était l'épine dorsale de ce que l'on peut appeler le « consensus de Bretton Woods », puisque c'est la même année que fut signé le traité international sur lequel allait reposer l'architecture financière de l'après-guerre. S'il convenait certes de reconstruire un ordre occidental, celui-ci ne pouvait pas être capitaliste au vieux sens du terme, c'est-à-dire qu'il ne pouvait se fonder sur un ordre « naturel ». À ce programme tous adhérèrent, les Beveridge et les Roosevelt, les De Gaulle et les Adenauer. D'une certaine façon, plus conforme d'ailleurs aux idées de Schumpeter que de Marx — puisque c'étaient les bases idéologiques du système qui avaient été remises en cause -, le capitalisme était venu à bout de lui-même.
Alors on s'habitua, en Europe surtout, à raconter l'histoire des relations économiques internationales comme une marche à l'étatisation des institutions de l'échange, du crédit, du travail et de la production. Aux régulations de marché succédaient celles de l'État, à la banque privée la banque d'État, au travail marchandise les négociations collectives, et à la libre entreprise les monopoles publics. Sous l'angle international, les rapports économiques étaient d'abord des rapports interétatiques ; et si l'on déplorait l'hégémonie de certains, il fallait bien reconnaître qu'elle était la continuation logique de cet ordre politique : il fallait bien qu'un nouveau rapport de force garantît l'équilibre général. Tout ceci était d'ailleurs parfaitement compatible avec la croissance et le rattrapage économiques. Et nombre d'intellectuels ne s'y trompaient pas, pour qui ce capitalisme « macroéconomique » était le rejeton du capitalisme « microéconomique » qui l'avait précédé.
Et puis brusquement, en deux ou trois décennies, les relations économiques du monde occidental ont pris un tour apparemment si nouveau, que c'est toute la façon d'écrire l'histoire du XXe siècle qui a été remise en cause. […]
PLAN DE L’ARTICLE
- Transformations et re-transformations
- Que s'est-il passé ?
- Détour
- Spéculation
- Conclusion
- Références bibliographiques
Marc Flandreau est professeur des universités en économie et chercheur associé à l’Observatoire français des conjonctures économiques (OFCE).

Contenu disponible en :
Régions et thématiques
Utilisation
Comment citer cette publicationPartager
Téléchargez l'analyse complète
Cette page ne contient qu'un résumé de notre travail. Si vous souhaitez avoir accès à toutes les informations de notre recherche sur le sujet, vous pouvez télécharger la version complète au format PDF.
Le début de l'histoire : globalisation financière et relations internationales
En savoir plus
Découvrir toutes nos analysesLe Bangladesh entre crise politique et montée de l'islamisme
Le mouvement « Students Against Discrimination », à l'origine des manifestations de l'été 2024, a cristallisé le mécontentement d'une jeunesse confrontée à la réinstauration d'un quota controversé pour les descendants des muktijoddhas (les « combattants pour la liberté » de la guerre d'indépendance de 1971), après quinze années de dérive autoritaire de la Première ministre Sheikh Hasina.
Avant-propos
Dans ce numéro spécial de Politique étrangère consacré aux actes de la Conférence organisée par l'Ifri le 10 avril 2019 au Grand amphithéâtre de la Sorbonne, à l'occasion de son quarantième anniversaire, découvrez l'avant-propos de Thierry de Montbrial, fondateur et président de l'Ifri.
Avant-propos
Dans ce numéro spécial de Politique étrangère consacré aux actes de la Conférence organisée par l'Ifri le 10 avril 2019 au Grand amphithéâtre de la Sorbonne, à l'occasion de son quarantième anniversaire, découvrez l'avant-propos de Thierry de Montbrial, fondateur et président de l'Ifri.
L'Europe et l'Afrique
Dans ce numéro spécial de Politique étrangère consacré aux actes de la Conférence organisée par l'Ifri le 10 avril 2019 au Grand amphithéâtre de la Sorbonne, à l'occasion de son quarantième anniversaire, découvrez l'entretien entre Thierry de Montbrial, fondateur et président de l'Ifri et Louise Mushikiwabo, ancienne ministre des Affaires étrangères du Rwanda, secrétaire générale de La Francophonie.








