Le terrorisme en perspective
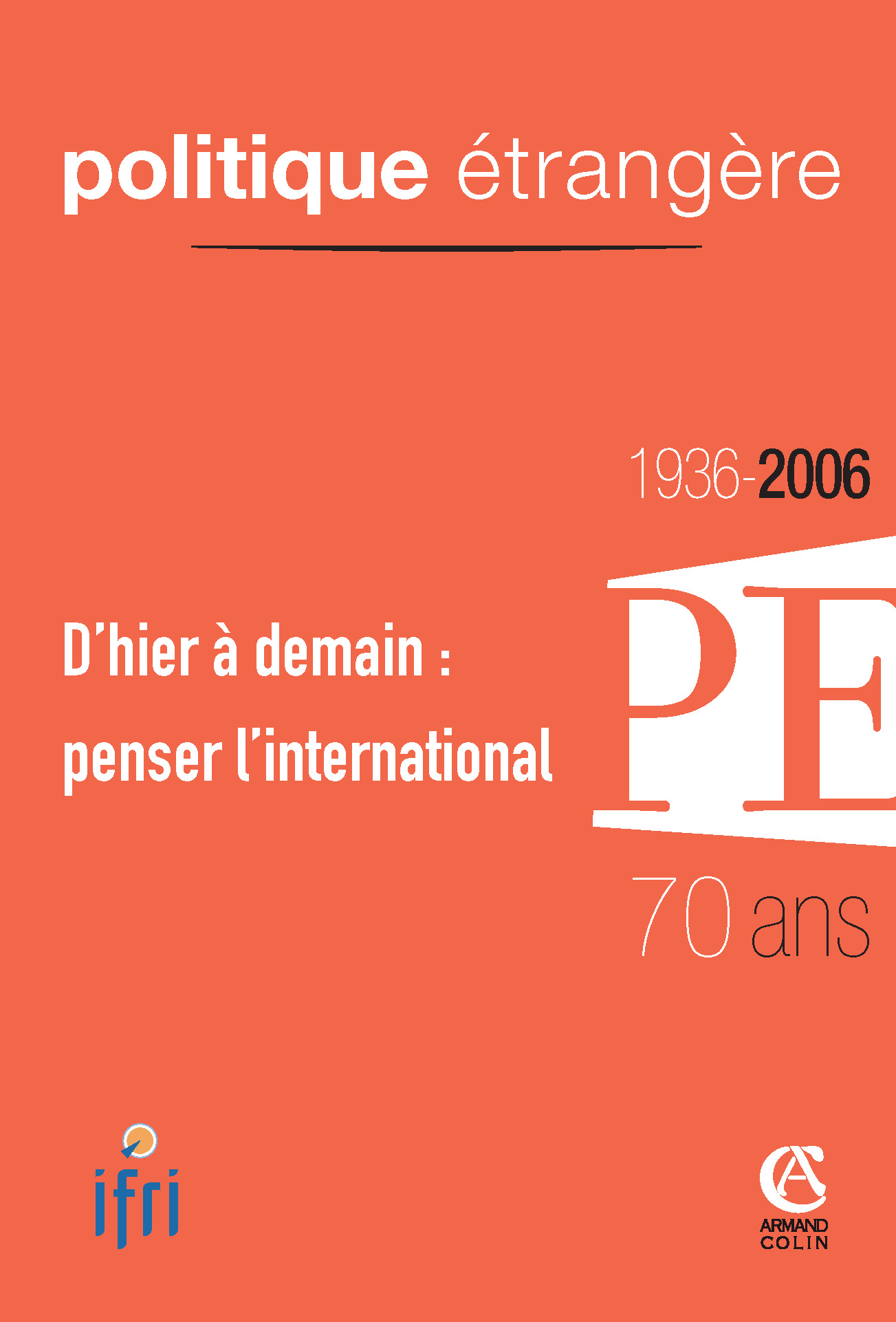
Les attentats du 11 septembre 2001 marquent l’entrée dans l’ère du terrorisme catastrophique. Depuis lors, le terrorisme a évolué. De nouvelles catégories de djihadistes ont émergé, en raison notamment de la dégradation de la situation en Irak. Le djihadisme finira sans doute par s’épuiser mais le terrorisme risque quant à lui de perdurer. Et la diffusion toujours plus large des technologies amènera des groupes de plus en plus limités à se doter de capacités de plus en plus destructrices.

Le terrorisme est une tactique qui sous-tend l’utilisation de moyens violents contre des non-combattants, à des fins politiques. Depuis environ 150 ans, la pratique terroriste fait preuve d’une remarquable continuité. Les attaques ont pratiquement toujours été menées à l’aide d’armes légères ou d’explosifs et ont généralement consisté à assassiner, prendre des otages, détourner des avions ou poser des bombes. Les terroristes sont historiquement conservateurs : ils n’ont que rarement essayé de nouvelles méthodes, préférant l’assurance d’une opération réussie à la poursuite – incertaine – d’effets plus importants. On relève toutefois quelques innovations sporadiques. L’attentat suicide tout d’abord – utilisé au début des années 1980 par les Tigres tamouls du Sri Lanka ou les chiites libanais – s’est maintenant diffusé chez les musulmans sunnites. Les Palestiniens, impressionnés par les résultats du Hezbollah, ont largement contribué à cette diffusion. Mais, d’une manière générale, les outils utilisés sont restés similaires.
Il en va de même pour l’échelle de la violence. La violence terroriste est particulièrement difficile à jauger en termes de volume. Le nombre d’attaques fluctue grandement en fonction de l’époque, et la distinction ténue entre terrorisme et insurrection rend les choses encore plus compliquées. Les effets directs de chaque attaque ont peu varié. Les attentats provoquant simultanément la mort de plus de 10 personnes sont peu fréquents. Ceux qui causent plus de 100 décès sont très rares. C’est une des raisons pour lesquelles l’attentat de Lockerbie en Écosse et celui du vol UTA 772 en 1989 sont devenus si emblématiques. La réflexion sur l’échelle de la violence a sa raison : le terrorisme veut produire des effets politiques significatifs par des actes de violence limités. D’où la fameuse expression : « Le terrorisme, c’est peu de victimes mais beaucoup de spectateurs ». Du fait de la répétition des mêmes tactiques et de la rareté des attaques de grande ampleur, le terrorisme est longtemps demeuré une préoccupation de sécurité de second ordre – même s’il s’agissait, pour les journalistes de tout poil, d’un sujet de premier ordre. Le risque de mourir d’une piqûre de guêpe ou d’être frappé par la foudre était généralement bien plus grand que celui de périr dans un attentat. […]
PLAN DE L’ARTICLE
- L’accélérateur irakien
- Trois catégories nouvelles de terroristes
- La diffusion du djihad
- Existe-t-il une sortie du terrorisme ?
- L’avenir du terrorisme sponsorisé par les États
- Au-delà de l’islam radical
Daniel Benjamin, ancien collaborateur du Conseil national de sécurité pour les menaces transnationales et le contre-terrorisme, a rejoint l’International Security Program du Center for Strategic and International Studies au titre de Senior Fellow (2001). Menant parallèlement une carrière de journaliste, il est aussi l’auteur, avec Steven Simon, de The Age of Sacred Terror (New York, Random House, 2002) et de The Next Attack (New York, Henry Holt/Times Books, 2005).

Contenu disponible en :
Régions et thématiques
Utilisation
Comment citer cette publicationPartager
Téléchargez l'analyse complète
Cette page ne contient qu'un résumé de notre travail. Si vous souhaitez avoir accès à toutes les informations de notre recherche sur le sujet, vous pouvez télécharger la version complète au format PDF.
Le terrorisme en perspective
Centres et programmes liés
Découvrez nos autres centres et programmes de rechercheEn savoir plus
Découvrir toutes nos analysesLa Bundeswehr : du changement d’époque (Zeitenwende) à la rupture historique (Epochenbruch)
La Zeitenwende (« changement d’époque ») annoncée par Olaf Scholz le 27 février 2022 passe à la vitesse supérieure. Soutenues financièrement par la réforme constitutionnelle du « frein à la dette » de mars 2025 et cautionnées par un large consensus politique et sociétal en faveur du renforcement et de la modernisation de la Bundeswehr, les capacités militaires de l’Allemagne devraient augmenter rapidement au cours des prochaines années. Appelée à jouer un rôle central dans la défense du continent européen sur fond de relations transatlantiques en plein bouleversement, la position allemande en matière politique et militaire traverse une profonde mutation.
Financer le réarmement de l’Europe FED, EDIP, SAFE : les instruments budgétaires de l’Union européenne
Lors d’un séminaire de travail organisé début novembre 2025 à Bruxelles et rassemblant des agents de l’Union européenne (UE) et des représentants civilo-militaires des États membres, un diplomate expérimenté prend la parole : « Honestly, I am lost with all these acronyms » ; une autre complète : « The European Union machine is even complex for those who follow it. »
Cartographier la guerre TechMil. Huit leçons tirées du champ de bataille ukrainien
Ce rapport retrace l'évolution des technologies clés qui ont émergé ou se sont développées au cours des quatre dernières années de la guerre en Ukraine. Son objectif est d'analyser les enseignements que l'OTAN pourrait en tirer pour renforcer ses capacités défensives et se préparer à une guerre moderne, de grande envergure et de nature conventionnelle.
L'Europe face au tournant de la DefTech. Repenser l'écosystème européen d'innovation de défense
« La façon dont je vois Iron Dome, c’est l’expression ultime de ce que sera le rôle des États-Unis dans les conflits futurs : non pas être les gendarmes du monde, mais en être l’armurerie », estimait en novembre 2023 Palmer Luckey, le fondateur d’Anduril, l’une des entreprises les plus en vue de la DefTech. L’ambition est claire : participer au réarmement mondial en capitalisant sur la qualité des innovations américaines et dominer le marché de l’armement, au moins occidental, par la maîtrise technologique.













