Trump II et l'Asie : le vent se lève…
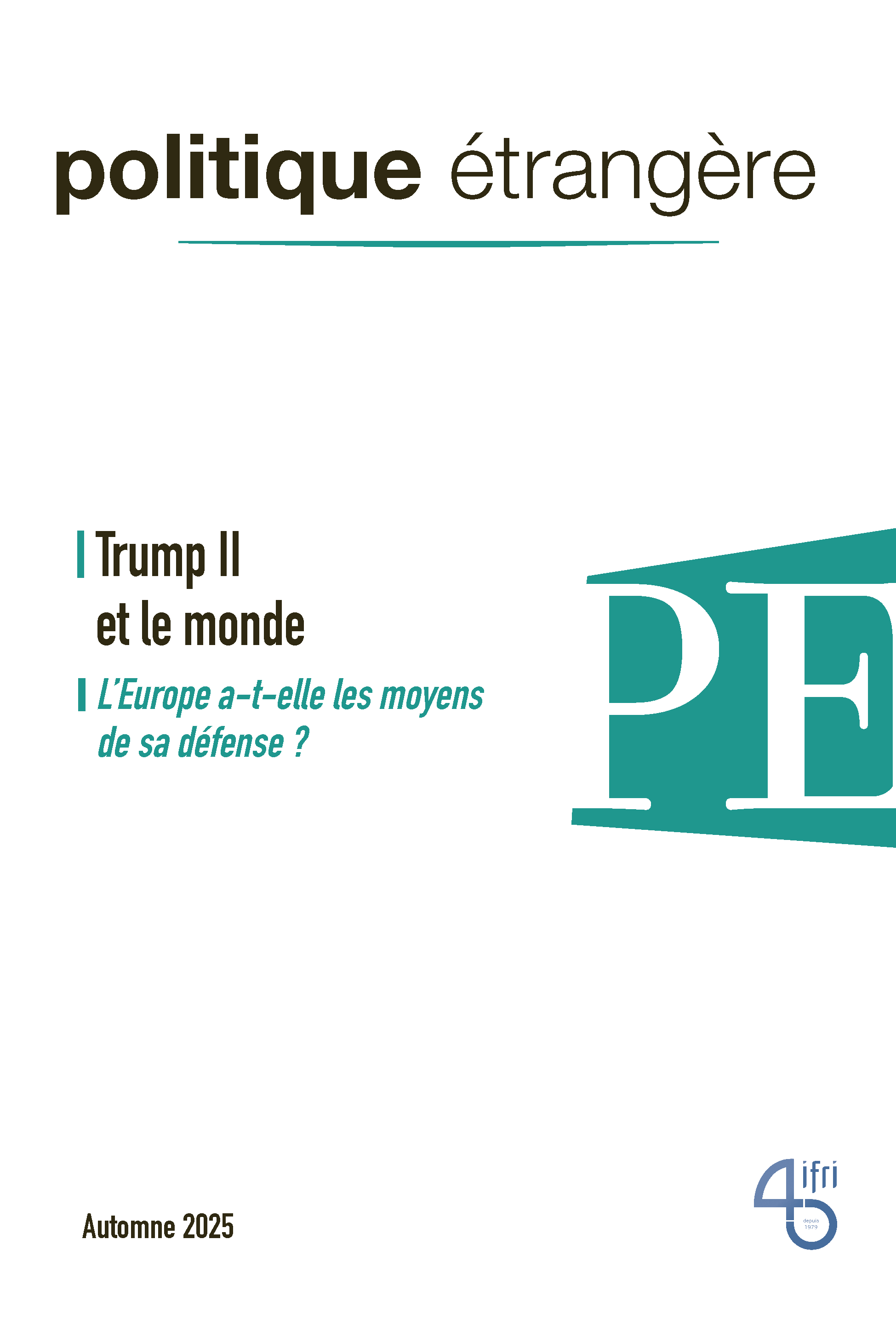
L'Indo-Pacifique est une priorité de l'administration Trump II, la Chine étant perçue comme le principal rival stratégique des États-Unis. Toutefois, Donald Trump a entamé son second mandat de manière déconcertante en durcissant les relations avec les partenaires traditionnels de Washington. Il a ensuite ouvert les hostilités avec Pékin, déclenchant une guerre commerciale plus intense encore que lors de son premier mandat. Les autorités chinoises n'entendent pas se laisser faire.

La nouvelle administration Trump n'a pas formulé de stratégie claire à l'égard de l'Asie. Les actions que l'on observe depuis janvier 2025 sont aussi déconcertantes que celles à l'égard de l'Europe. Cette politique étrangère ne discrimine plus les alliés, les partenaires et les rivaux mais érige le rapport de force comme seule règle présidant aux relations avec les États, conduisant Donald Trump à se montrer « fort avec les faibles et [souvent] faible avec les forts », selon la formule désormais consacrée. La politique asiatique de Trump se distingue toutefois de celle menée vis-à-vis de l'Europe en ce qu'elle s'inscrit dans une certaine tradition de politique étrangère américaine depuis le début du siècle, à savoir la volonté d'un basculement stratégique vers l'Asie – nommé « rééquilibrage stratégique » sous Barack Obama, puis « stratégie indopacifique » sous Trump I – pour faire face au véritable et unique rival stratégique des États-Unis au XXIe siècle : la République populaire de Chine.
Des premiers mois de l'administration Trump II, on peut retenir la réaffirmation des principes d'un « Indo-Pacifique libre et ouvert », formulés par la première administration Trump en 2019 et dont on verra sans doute une nouvelle mouture publiée au cours du second mandat. En effet, l'intérêt américain pour le concept et pour la région ne faiblit pas. Le secrétaire à la Défense Pete Hegseth s'est rendu deux fois en Indo-Pacifique entre mars et mai 2025, d'abord en visite auprès de deux alliés – Philippines et Japon – puis au Dialogue Shangri-La de Singapour. Il a vivement réaffirmé l'engagement des États-Unis à « instaurer la paix par la force » en Indo-Pacifique, « [leur] théâtre prioritaire ». Pour ce faire, Hegseth a présenté la triple mission qui lui a été confiée par le président : « restaurer l'éthique guerrière, rebâtir [l']armée et rétablir la dissuasion », la Chine étant explicitement la puissance visée (citée près de 30 fois dans le discours).
La permanence de la stratégie indopacifique et de la rivalité avec Pékin n'explique pas pour autant les bouleversements induits par la nouvelle administration américaine à l'égard de ses partenaires et alliés en Asie, ni même à l'égard du rival qu'elle entend dissuader.
PLAN DE L'ARTICLE
Vu de New Delhi : les États-Unis, partenaire stratégique mais pas de confiance
L'Asie du Sud-Est entre coercitions américaines et chinoises
Un Japon irrité mais prisonnier de son alliance
Le nouveau président sud-coréen face à de multiples défis internationaux
Chine/États-Unis : exacerbation de la rivalité commerciale
Taïwan : un atout stratégique pour Washington
Marc Julienne est directeur du Centre Asie de l'Ifri.
Article publié dans Politique étrangère, vol. 90, n° 3, 2025.
Texte citation
Depuis son retour à la Maison-Blanche, Donald Trump est bien moins tonitruant quand il s'adresse à ou parle de la Chine que quand il traite du Canada, de l'Europe et de l'OTAN, ou de ses alliés asiatiques.


Contenu disponible en :
Thématiques et régions
Utilisation
Comment citer cette publicationPartager
Centres et programmes liés
Découvrez nos autres centres et programmes de rechercheEn savoir plus
Découvrir toutes nos analysesL'Europe et l'Afrique
Dans ce numéro spécial de Politique étrangère consacré aux actes de la Conférence organisée par l'Ifri le 10 avril 2019 au Grand amphithéâtre de la Sorbonne, à l'occasion de son quarantième anniversaire, découvrez l'entretien entre Thierry de Montbrial, fondateur et président de l'Ifri et Louise Mushikiwabo, ancienne ministre des Affaires étrangères du Rwanda, secrétaire générale de La Francophonie.
Conclusions
Dans ce numéro spécial de Politique étrangère consacré aux actes de la Conférence organisée par l'Ifri le 10 avril 2019 au Grand amphithéâtre de la Sorbonne, à l'occasion de son quarantième anniversaire, découvrez l'allocution de Jean-Yves Le Drian, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères.
Nouveaux défis mondiaux et sécurité européenne
Dans ce numéro spécial de Politique étrangère consacré aux actes de la Conférence organisée par l'Ifri le 10 avril 2019 au Grand amphithéâtre de la Sorbonne, à l'occasion de son quarantième anniversaire, découvrez le débat animé par Nicole Gnesotto entre Wolfgang Ischinger, Jean-Marie Guéhenno, Julian King et Hubert Védrine.
Les industriels face aux nouveaux protectionnismes
Dans ce numéro spécial de Politique étrangère consacré aux actes de la Conférence organisée par l'Ifri le 10 avril 2019 au Grand amphithéâtre de la Sorbonne, à l'occasion de son quarantième anniversaire, découvrez le débat animé par Thierry de Montbrial entre Jean-Paul Agon et Patrick Pouyanné.











