Turquie : le syndrome de Sèvres, ou la guerre qui n'en finit pas
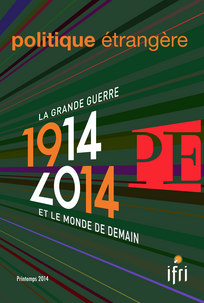
Le traité de Sèvres symbolise pour les Turcs la liquidation de l’Empire et l’action des puissances extérieures pour démembrer la Turquie. L’effet historique du traité survit sous forme de syndrome, justifiant une vision obsidionale de la survie nationale. Au-delà de l’actuel néo-ottomanisme, un dialogue repensé avec l’Europe pourrait peut-être donner au pays un rapport nouveau à sa mémoire et l’aider à dépasser un syndrome manié par toutes les composantes de sa classe politique.

La Première Guerre mondiale a séparé l’Europe de la Turquie. Le constat s’impose, alors que la commémoration de son centenaire rassemble les nations d’Europe de l’Ouest dans le souvenir d’un désastre historique qui a engendré d’autres épreuves finalement unificatrices. La Turquie sacrifie de son côté à un récit parallèle : celui de la gestation de la nation turque moderne à partir d’un Empire ottoman défait. La pulsion nationaliste reste vive et 2015 célébrera plus en Turquie la bataille des Dardanelles qu’elle ne marquera le souvenir du génocide arménien.
La mémoire est pourtant secouée aujourd’hui dans le pays sur un fond d’éternel questionnement identitaire. La fabrique de l’histoire y a produit tout au long du XXe siècle un récit positif intégrateur, surmontant le cauchemar de la fin de l’Empire, triant et mettant en ordre les événements depuis la fondation de la République. Mais des failles apparaissent désormais çà et là, des débats s’ouvrent sur un passé à découvrir pour beaucoup. Un questionnement s’esquisse ainsi sur un motif historique persistant et fondateur de la conscience collective turque contemporaine : le traité de Sèvres, dont les clauses léonines furent imposées en 1920 à l’Empire par les pays vainqueurs. Un traité fantôme, remplacé en 1923 par le traité de Lausanne, mais qui reste le point de départ d’une peur réflexe chez les Turcs : la hantise de la trahison et de la perte, couramment désignée par l’expression « syndrome de Sèvres ».
Les variations infinies du discours politique turc autour du motif de Sèvres semblent désormais notablement anachroniques, de plus en plus décalées des rapports de force réels, aussi bien sur le plan régional qu’en Turquie même. Le trauma initial, jamais dépassé, dont le souvenir est cultivé par les générations politiques successives, perpétue en Turquie une obsession sécuritaire. La survivance du syndrome et son instrumentalisation tactique par certains acteurs du système de pouvoir sont finalement révélatrices des empêchements de la démocratie turque, longtemps confinée dans un entre-soi paranoïaque.
La Première Guerre mondiale vue de Turquie
La Première Guerre mondiale a laissé sur la Turquie une empreinte particulière, s’inscrivant pour les Turcs dans un continuum d’affrontements de plusieurs décennies avec les puissances européennes et qui se poursuivent jusqu’en 1922. La République de Turquie, née d’une « guerre d’indépendance » refondatrice, est le vainqueur paradoxal d’une guerre qui a achevé l’Empire. […]
PLAN DE L'ARTICLE
- La Première Guerre mondiale vue de Turquie
- Choisir son camp
- Sèvres, stade ultime de la perte
- Le sursaut national : la Turquie, vainqueur paradoxal
- Extension du domaine de Sèvres : la Turquie en otage
- Apparition et déclinaisons du syndrome de Sèvres
- Le relais du syndrome
- Le pays enfermé
- Contourner, prolonger ou dépasser Sèvres : le dilemme turc
- Le syndrome et la maladie
- La voie néo-ottomane : contourner Sèvres, ou le dépasser
Article publié dans Politique étrangère, vol. 79, n° 1, printemps 2014
Dorothée Schmid est Responsable du programme Turquie contemporaine et Moyen-Orient de l’Ifri.

Contenu disponible en :
Régions et thématiques
Utilisation
Comment citer cette publicationPartager
Téléchargez l'analyse complète
Cette page ne contient qu'un résumé de notre travail. Si vous souhaitez avoir accès à toutes les informations de notre recherche sur le sujet, vous pouvez télécharger la version complète au format PDF.
Turquie : le syndrome de Sèvres, ou la guerre qui n'en finit pas
Centres et programmes liés
Découvrez nos autres centres et programmes de rechercheEn savoir plus
Découvrir toutes nos analysesLe Canada et la reconnaissance de l'État palestinien
Le 21 septembre 2025, le Canada est devenu le 148ème pays à reconnaître l'État palestinien. Cette mesure a été coordonnée avec le Royaume-Uni et l'Australie en face d'une forte opposition américaine et israélienne.
La République d’Irlande et la question palestinienne
Depuis le milieu du XXᵉ siècle, la politique étrangère de la République d’Irlande s’est construite sur un double héritage qui lui confère une position unique parmi les États d’Europe occidentale.
Turquie 2050 - Train ITI ; Mansur Yavaş ; Turquie - Syrie
Repères sur la Turquie n° 34 - Le programme « Turquie 2050 » développe une analyse prospective sur les thèmes de la diplomatie, de la politique intérieure et de l’économie turques afin d’y anticiper les dynamiques des trente prochaines années.
Turquie 2050 - Corridors ; Communauté LGBTI ; Turquie - Chypre Nord
Repères sur la Turquie n° 33 - Le programme « Turquie 2050 » développe une analyse prospective sur les thèmes de la diplomatie, de la politique intérieure et de l’économie turques afin d’y anticiper les dynamiques des trente prochaines années.













