La guerre en Ukraine : quelles alternatives à la "guerre d'usure" ?

Tatiana Kastouéva-Jean, directrice du Centre Russie/Eurasie à l'Ifri, analyse le contexte de la guerre en Ukraine en novembre 2024 avec l'arrivée au pouvoir aux Etats-Unis de Donald Trump mais aussi les résiliences et les fragilités de la Russie et de l'Ukraine.
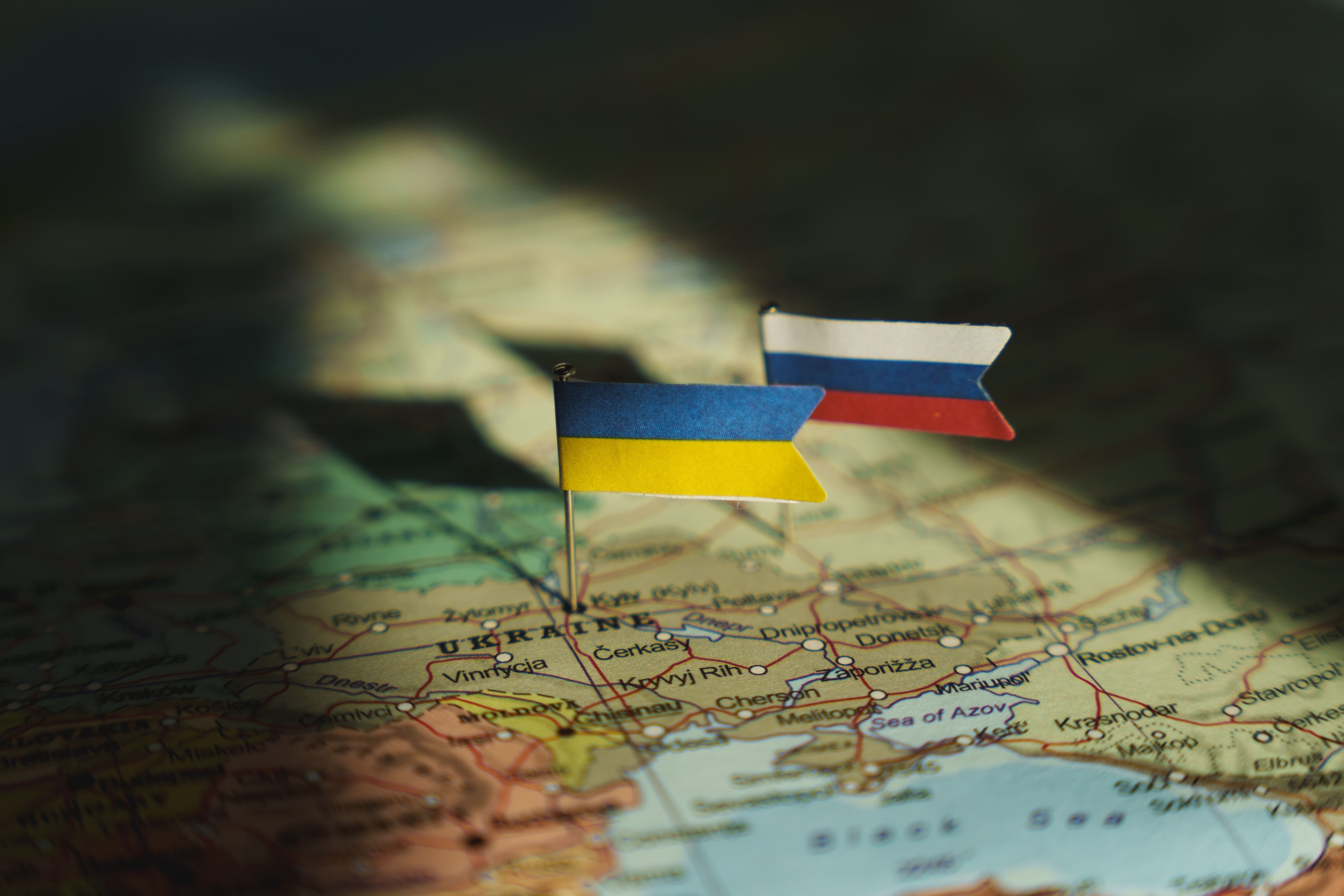
Titre Edito
La guerre en Ukraine : quelles alternatives à la « guerre d’usure » ?
La guerre en Ukraine : quelles alternatives à la « guerre d’usure » ?
Deux ans et demi depuis le début de la guerre en Ukraine, aucune sortie ne semble se profiler à l’horizon. Les deux belligérants ont déclaré leurs ouvertures aux négociations, mais leurs positions restent irréconciliables tant sur les territoires à l’Est de l’Ukraine que sur les questions politiques et stratégiques.
Ce que souhaite l’Ukraine pour que la paix soit durable (le rétablissement de l’intégrité territoriale, la reconnaissance des crimes de guerre et le paiement des réparations par la Russie, l’adhésion à l’OTAN et des garanties de sécurité) n’est pas acceptable pour Moscou. Forte de son statut de puissance nucléaire, la Russie est convaincue que sa victoire militaire est inéluctable même si elle prend plus de temps que prévu. Tant l’agressé que l’agresseur craignent qu’une « pause » dans la guerre à la faveur d’un cessez-le-feu profitera à l’ennemi pour se réarmer et mieux préparer un nouveau cycle de confrontation. Les différentes médiations proposées par la Chine, le Brésil ou l’Afrique du Sud ne semblent pas réalistes dans ce contexte.
Sur le plan militaire, l’avantage numérique de la Russie est compensé par l’audace et la capacité de créer des surprises stratégiques (démontrée notamment par les bombardements des dépôts de munitions ou d’hydrocarbures en Russie et l’offensive dans la région de Koursk) des forces armées ukrainiennes, en grande partie équipées et entraînées par les pays de l’OTAN. De son côté, la Russie bénéficie de l’aide des partenaires qui lui fournissent des munitions et des missiles, comme l’Iran et la Corée du Nord, alors que la Chine lui procure des composantes électroniques et des semi-conducteurs, nécessaires pour son complexe militaro-industriel.
Dans ces conditions, l’initiative a changé plusieurs fois de camp (actuellement elle est entre les mains de la Russie à Koursk et dans le Donbass) et les pertes humaines sont considérables des deux côtés sans qu’aucun des adversaires ne soit capable de chasser complètement l’autre des territoires à l’Est et au Sud de l’Ukraine. La « guerre d’usure » amène les observateurs à analyser non seulement le rapport des forces militaires et à compter les kilomètres cédés ou (re)conquis, mais aussi les facteurs de la résilience politique, économique et sociale de chaque protagoniste et la solidité de ses soutiens internationaux. Lourdement éprouvée, combien de temps l’Ukraine pourra-t-elle résister sans augmentation décisive de l’aide occidentale ? Poutine, bénéficiera-il éternellement des moyens financiers nécessaires pour continuer cette guerre, ainsi que de l’adhésion de la population et des élites ? La question clé de l’automne 2024 porte sur la politique de l’Occident : pourra-t-il maintenir le soutien à l’Ukraine après les élections américaines et augmenter les livraisons d’armements tout en levant les restrictions sur leur utilisation en territoire russe comme le demande Kyiv ?
Article publié dans la Revue Sécurité et Stratégie - N° 37, décembre 2024.

Contenu disponible en :
Thématiques et régions
Utilisation
Comment citer cette publicationPartager
Téléchargez l'analyse complète
Cette page ne contient qu'un résumé de notre travail. Si vous souhaitez avoir accès à toutes les informations de notre recherche sur le sujet, vous pouvez télécharger la version complète au format PDF.
La guerre en Ukraine : quelles alternatives à la "guerre d'usure" ?
Centres et programmes liés
Découvrez nos autres centres et programmes de rechercheEn savoir plus
Découvrir toutes nos analysesLa Russie, les Palestiniens et Gaza : ajustements après le 7 octobre
L'Union soviétique (URSS), puis la Fédération de Russie en tant que successeur légal internationalement reconnu, ont toujours cherché à jouer un rôle visible dans les efforts visant à résoudre le conflit israélo-palestinien.
La « Deathonomics » russe : coûts sociaux, politiques et économiques de la guerre en Ukraine
La présente Note analyse l’apparition d’un phénomène nouveau pour la société russe, désigné sous le terme d’« économie de la mort » (Deathonomics). Il s’agit de la formation, au cours des années de guerre en Ukraine, d’une force mercenaire venue compléter les systèmes soviétique (la conscription) et russe (l’armée professionnelle) au sein des forces armées. Vers la fin de l’année 2023, ce phénomène a conduit à faire du service militaire l’un des domaines d’activité les mieux rémunérés, ce qui n’avait pas été observé en Russie à une telle échelle depuis la fin du XVIIe siècle.
La politique russe de recrutement de combattants et d’ouvrières en Afrique subsaharienne
La guerre russo-ukrainienne, déclenchée le 24 février 2022, s’est rapidement internationalisée. La Russie et l’Ukraine se sont très vite efforcées de mobiliser leurs alliés afin d’obtenir un soutien politique et diplomatique, ainsi que des ressources militaires et économiques. Mais les deux belligérants ont aussi cherché à recruter des étrangers à titre privé pour soutenir leurs efforts de guerre respectifs. Cette politique est globale et s’étend de l’Amérique latine à l’Extrême-Orient. L’Afrique subsaharienne, dans ce panorama, présente un intérêt particulier car elle constitue un vivier de recrutement vaste et facilement accessible, en raison de taux de pauvreté élevés dans la plupart des pays de la zone conjugués à un important désir d’émigration.
Le Kazakhstan après le double choc de 2022. Conséquences politiques, économiques et militaires
L’année 2022 a été marquée par un double choc pour le Kazakhstan : en janvier, le pays a connu la plus grave crise politique depuis son indépendance, et en février, la Russie a lancé une invasion à grande échelle de l’Ukraine, remettant en question les frontières entre les pays post-soviétiques. Ces événements successifs ont eu un impact profond sur la politique intérieure et extérieure du Kazakhstan.















