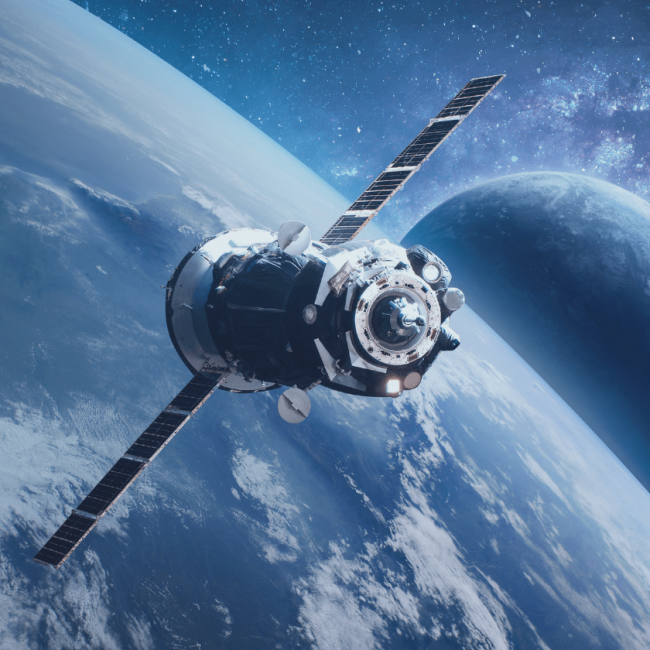Dynamiques et tensions normatives dans le domaine spatial : vers une américanisation du droit de l’espace ?
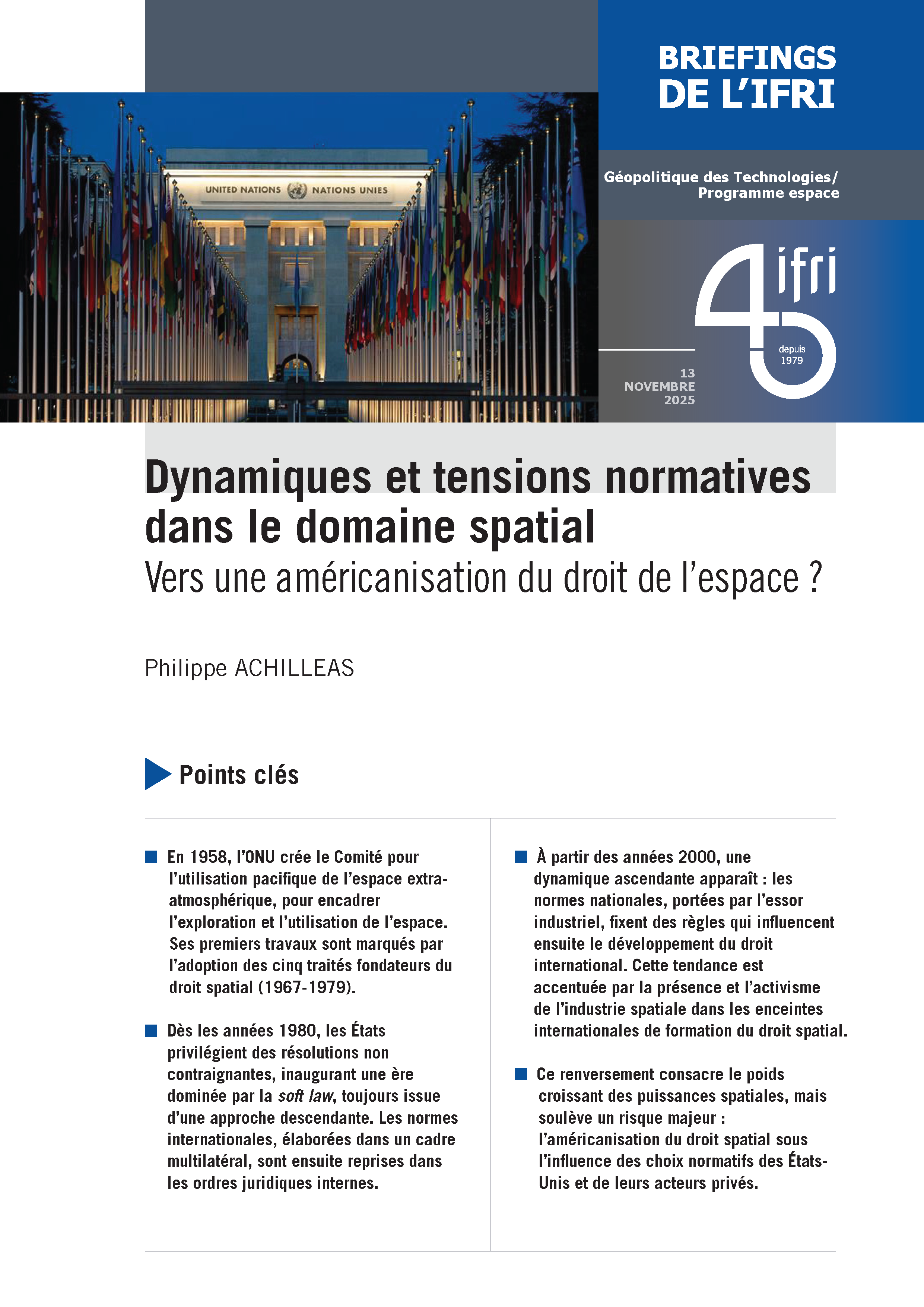
La construction du droit spatial a progressivement évolué d’une dynamique normative descendante dominée par l’impulsion fondatrice de l’ONU, vers une normativité ascendante, portée par les pratiques nationales et industrielles. Cette évolution s’accompagne aujourd’hui d’une compétition normative croissante, qui fait peser le risque d’une américanisation du droit de l’espace et soulève la question d’une réponse européenne.

Titre
Points clés
En 1958, l’ONU crée le Comité pour l’utilisation pacifique de l’espace extra-atmosphérique, pour encadrer l’exploration et l’utilisation de l’espace. Ses premiers travaux sont marqués par l’adoption des cinq traités fondateurs du droit spatial (1967-1979).
Dès les années 1980, les États privilégient des résolutions non contraignantes, inaugurant une ère dominée par la soft law, toujours issue d’une approche descendante. Les normes internationales, élaborées dans un cadre multilatéral, sont ensuite reprises dans les ordres juridiques internes.
À partir des années 2000, une dynamique ascendante apparaît : les normes nationales, portées par l’essor industriel, fixent des règles qui influencent ensuite le développement du droit international. Cette tendance est accentuée par la présence et l’activisme de l’industrie spatiale dans les enceintes internationales de formation du droit spatial.
Ce renversement consacre le poids croissant des puissances spatiales, mais soulève un risque majeur : l’américanisation du droit spatial sous l’influence des choix normatifs des États-Unis et de leurs acteurs privés.
Une normativité descendante façonnée par le rôle moteur de l’ONU
Le lancement de Spoutnik 1 par l’Union soviétique, le 4 octobre 1957, inaugure l’ère spatiale et pose immédiatement des questions juridiques inédites. Dès 1958, les Nations unies créent un comité ad hoc chargé notamment d’étudier les problèmes juridiques soulevés par les activités spatiales. L’année suivante, ce comité est transformé en un organe permanent placé sous l’autorité de l’Assemblée générale des Nations unies (AGNU), le Comité pour l’utilisation pacifique de l’espace extra-atmosphérique (CUPEEA). Il est doté d’un sous-comité juridique chargé du développement progressif du droit de l’espace. Son fonctionnement repose sur la règle du consensus, qui garantit que les recommandations formulées sont acceptées par tous, grandes puissances et petits États, et confère une légitimité universelle à ses travaux.
Cette création témoigne de la volonté immédiate de la communauté internationale d’encadrer juridiquement les activités spatiales. Elle se traduit par l’adoption rapide par l’AGNU d’un premier ensemble normatif avec la Déclaration des principes juridiques régissant les activités des États en matière d’exploration et d’utilisation de l’espace extra-atmosphérique, annexée à la résolution 1962 (XVIII) du 13 décembre 1963.
L’âge d’or des traités spatiaux
La course à la Lune accélère la nécessité d’un cadre juridique applicable à l’espace et aux corps célestes, afin d’éviter que la conquête spatiale ne devienne une source de conflits. Les États-Unis acceptent la proposition soviétique d’adopter un traité général, à condition qu’il soit complété par des conventions d’application. Le Traité sur les principes régissant les activités des États en matière d’exploration et d’utilisation de l’espace extra-atmosphérique, y compris la Lune et les autres corps célestes, ouvert à la signature le 27 janvier 1967, reprend et développe les grands principes posés par la déclaration de 1963 : liberté de l’espace, non-appropriation de l’espace et des corps célestes, interdiction des armes de destruction massive en orbite autour de la terre et utilisation exclusivement pacifique des corps célestes, responsabilité internationale... En 2025, il compte 114 États parties.
Ce texte fondateur est complété par quatre conventions spécifiques :
- l’Accord sur le sauvetage des astronautes, le retour des astronautes et la restitution des objets lancés dans l’espace extra-atmosphérique, du 22 avril 1968 (98 États parties en 2025)
- la Convention sur la responsabilité internationale pour les dommages causés par des objets spatiaux, du 29 mars 1972 (101 États parties en 2025)
- la Convention sur l’immatriculation des objets lancés dans l’espace extra-atmosphérique, du 14 janvier 1975 (73 États parties en 2025)
- enfin, l’Accord régissant les activités des États sur la Lune et les autres corps célestes, du 18 décembre 1979 (17 États parties en 2025).
Inspiré par une proposition initiale de l’Argentine et porté par les États en développement, l’Accord sur la Lune applique les principes du Traité de l’espace aux corps célestes du système solaire, notamment en ce qui concerne la liberté de recherche scientifique. Il innove en déclarant la Lune et ses ressources naturelles « patrimoine commun de l’humanité » et en appelant à la mise en place d’un régime international gouvernant l’exploitation des ressources des corps célestes. L’Accord sur la Lune s’inspire directement des négociations parallèles relatives à la refonte du droit de la mer, qui reconnaissent les grands fonds marins comme patrimoine commun de l’humanité et instituent une autorité internationale chargée d’organiser l’exploitation de leurs ressources. Toutefois, cette approche rencontre l’opposition des deux superpuissances, l’URSS et les États-Unis, pour des raisons distinctes. Pour l’URSS, le Traité de l’espace de 1967 interdisant toute appropriation des corps célestes, l’adoption d’un nouvel instrument était inutile, d’autant qu’il ouvrait la voie à une exploitation commerciale de l’espace inacceptable par Moscou. Pour les États-Unis, il n’était pas question de restreindre leur liberté d’action sur les corps célestes, ni de soumettre l’exploitation des ressources à un régime international de partage. Malgré son entrée en vigueur en 1984, l’Accord sur la Lune ne rassemble en 2025 que 17 États parties, ce qui en fait un échec diplomatique marquant la fin de l’âge d’or du droit spatial fondé sur des traités internationaux.
Le relais des résolutions normatives onusiennes
À partir des années 1980, la production normative se poursuit par l’adoption de résolutions de l’AGNU relevant du domaine du droit souple (soft law). Si ces textes n’ont pas la force contraignante des traités, ils orientent les comportements étatiques et peuvent contribuer à la formation du droit coutumier. Leur adoption révèle certaines tensions.
Les principes de diffusion directe par satellite (1982) ont été adoptés par vote à l’AGNU, à l’initiative de l’URSS, faute de consensus au CUPEEA. Le débat opposait alors les États-Unis, favorables à la libre circulation des flux audiovisuels comme prolongement de la liberté d’expression, aux pays socialistes et à de nombreux pays en développement qui craignaient une atteinte à leur souveraineté culturelle et informationnelle. La recherche du consensus s’est vite avérée impossible.
Au contraire, les principes relatifs à la télédétection de la Terre depuis l’espace (1986) ont été adoptés par consensus, ouvrant la voie au marché de l’imagerie spatiale. Ce succès a été rendu possible grâce au ralliement des pays en développement, initialement réticents. Le basculement s’est opéré lorsque les puissances spatiales ont offert des garanties selon lesquelles la télédétection ne serait pas utilisée contre les droits et intérêts légitimes des pays observés, et qu’un accès non discriminatoire aux données concernant leurs territoires leur serait assuré. De même, un consensus a pu être atteint pour l’adoption des Principes relatifs à l’utilisation des sources d’énergie nucléaire dans l’espace extra-atmosphérique (1992), élaborés à la suite de l’accident du satellite soviétique Cosmos 954, équipé d’un générateur nucléaire, qui s’est écrasé sur le territoire canadien en 1978. Un dernier texte clôt cette période : la déclaration sur la coopération internationale dans l’exploration et l’utilisation de l’espace au bénéfice et dans l’intérêt de tous les États (1996).
Une dynamique descendante structurante
Qu’il soit le fruit de conventions contraignantes ou de normes d’application plus souples, le droit de l’espace se construit au niveau international avant d’être transposé dans les ordres internes. Ainsi, suivant cette logique descendante, les lois spatiales nationales s’articulent autour des articles VI (responsabilité internationale et contrôle des activités dans l’espace), VII (responsabilité pour les dommages causés par les objets spatiaux) et VIII (immatriculation des objets spatiaux) du Traité de l’espace. Autrement dit, la dynamique normative se diffuse du haut vers le bas, du droit international vers les législations nationales.
Une normativité ascendante sous l’impulsion des pratiques nationales
À partir des années 2000, la dynamique normative du droit spatial se transforme profondément. Trois évolutions expliquent ce basculement. D’abord, la multiplication des activités spatiales nécessite des règles opérationnelles précises, notamment en matière de sécurité des opérations et de gestion des débris spatiaux. Ensuite, les opérateurs commerciaux, confrontés directement aux défis techniques et financiers, exigent d’être associés à l’élaboration des normes qui conditionnent leurs activités. Enfin, les États-Unis disposent d’un secteur privé dynamique et innovant, capable d’imposer des standards techniques qui tendent à s’ériger en normes de fait pour l’ensemble de la communauté internationale.
L’adoption de normes techniques
Dans ce nouveau contexte, le CUPEEA cherche à maintenir son rôle de forum universel de développement du droit de l’espace. Mais il s’appuie désormais davantage sur les pratiques industrielles pour « révéler » les bonnes mesures susceptibles d’être reconnues comme normes internationales. Ce mécanisme se manifeste particulièrement dans le domaine de la gestion des débris spatiaux, avec les lignes directrices sur la réduction des débris spatiaux adoptées par le CUPEEA en 2007 et faites siennes par l’AGNU. L’ONU s’est en fait directement inspiré des recommandations techniques formulées en amont par le Comité interagences sur les débris spatiaux (IADC), qui regroupe les principales agences spatiales. Dans la même logique, les Lignes directrices pour la durabilité à long terme des activités spatiales ont été adoptées par consensus au CUPEEA, en juin 2019, en s’appuyant sur les pratiques nationales. Ce mode d’élaboration du droit international, qui valorise l’expérience et les normes techniques de l’industrie, présente toutefois un biais structurel : il favorise les États disposant d’une base industrielle spatiale solide et d’entreprises capables d’influencer directement la production de normes. Dans les faits, il renforce la position des États-Unis, qui transforment leurs choix normatifs internes en standards globaux.
Ressources spatiales et trafic orbital : les nouveaux fronts de la régulation
Le basculement vers une normativité ascendante apparaît de manière particulièrement nette dans le domaine de l’exploitation des ressources des corps célestes. Les États-Unis ouvrent la voie avec l’U.S. Commercial Space Launch Competitiveness Act, promulgué le 25 novembre 2015, qui reconnaît aux entreprises américaines un droit de propriété sur les ressources spatiales qu’elles extraient, tout en affirmant que cette exploitation ne constitue pas une violation du principe de non-appropriation inscrit dans le Traité de l’espace. Cette initiative inspire directement d’autres États désireux de soutenir leur industrie : le Luxembourg adopte en 2017 une loi sur l’exploitation des ressources de l’espace, suivi par les Émirats arabes unis en 2019 et le Japon en 2021. Ces législations nationales reprennent l’approche américaine en légitimant une exploitation privée des ressources, créant ainsi une convergence normative issue des droits internes.
Les États-Unis consolident ensuite leur influence sur le plan international en lançant les Accords Artemis, présentés en octobre 2020 comme un cadre de coopération pour le programme lunaire Artemis porté par la NASA. Ces accords, de nature non contraignante et conclus sur une base bilatérale entre Washington et chacun de ses partenaires, reflètent largement les principes de la loi américaine de 2015. Leur portée politique est considérable : en 2025, on compte 56 signataires, soit près de la moitié des États parties au Traité de l’espace. Dans les faits, les Accords Artemis permettent aux États-Unis d’orienter les discussions internationales en leur faveur, notamment à l’ONU. Au sein du Groupe de travail (GT) du CUPEEA sur l’exploitation des ressources des corps célestes, les débats sont désormais façonnés par cette approche américaine qui contourne la question centrale de la licéité même de l’exploitation des ressources. Le multilatéralisme onusien se retrouve ainsi affaibli par la consolidation d’une coalition plurilatérale alignée sur la position normative des États-Unis.
Lors des débats, la Chine, pourtant également intéressée par l’exploitation des ressources spatiales, adopte une attitude prudente et laisse la Russie assumer le rôle d’opposant à la vision américaine. Cette réserve pourrait s’expliquer par un calcul politique. Pékin, soucieuse de préserver son image d’acteur multilatéral responsable, ne pourrait apparaître en soutien d’une initiative libérale largement portée par les États-Unis, même si ses intérêts convergent avec ceux de Washington. Bien qu’isolé au sein du GT, Moscou conserve une arme de dernier recours. Son veto suffit à empêcher l’adoption d’un texte par consensus. Toutefois, cette capacité de blocage n’exclut pas la possibilité, pour les États alignés sur la position américaine, de contourner l’impasse en soumettant directement le projet à l’AGNU pour adoption à la majorité – une stratégie déjà expérimentée par l’URSS dans les années 1980 lors du débat sur la télévision directe par satellite. Nous l’avons vu, les positions des États-Unis et de l’URSS étaient inconciliables et le consensus impossible au sein du CUPEEA. En 1982, l’URSS a donc choisi de soumettre directement son projet de résolution à l’AGNU, en contournant le processus de consensus du Comité. Sa proposition, soutenue par un large groupe d’États inquiets d’une possible domination culturelle américaine à travers les satellites de diffusion, a finalement été adoptée par vote.
La question de la gestion du trafic spatial illustre aussi avec acuité les tensions actuelles entre approche multilatérale descendante et dynamique ascendante. L’augmentation rapide du nombre d’objets en orbite, liée au déploiement de constellations de satellites en orbite basse, appelle des règles communes de coordination pour éviter les collisions et interférences. Toutefois, aucun consensus n’émerge au sein du CUPEEA, où les États hésitent à définir les contours d’un régime international complexe qui viendrait limiter leur souveraineté. Ce n’est qu’en 2025 que le Comité a décidé la mise en place d’un groupe d’experts (expert group) spécialisé sur la question. Les discussions progressent désormais, mais uniquement sous l’angle de la surveillance de la situation spatiale (Space Situational Awareness), perçue comme une approche technique et coopérative moins sensible politiquement que la mise en place d’un véritable régime international de gestion du trafic spatial.
Dans ce vide normatif, les États-Unis ont pris l’initiative en définissant une politique nationale de gestion du trafic spatial. La Space Policy Directive-3 (National Space Traffic Management Policy), signée le 18 juin 2018 sous la première administration Trump, prévoit le transfert des missions de suivi et de notification du département de la Défense (DoD) vers le département du Commerce (DoC). Cette directive fixe les bases d’un système civil de gestion du trafic spatial, élaboré en partenariat étroit avec l’industrie privée et destiné à devenir un cadre international de fait. Plusieurs projets de loi au Congrès ont cherché à donner une assise législative à cette politique, dont l’ORBITS Act de 2023 (S.447) qui établit des obligations plus strictes en matière de retrait de débris et confirme le rôle central du DoC.
Face à cette stratégie américaine, la Chine défend une approche multilatérale fondée sur un rôle accru de l’Union internationale des télécommunications (UIT). Ce forum est aussi privilégié par de nombreux opérateurs privés : non seulement parce qu’ils participent activement aux travaux de l’UIT en tant que membres du secteur privé, mais aussi parce que l’UIT a déjà démontré sa compétence dans la gestion d’une ressource critique, la ressource « spectre-orbite », où elle administre depuis des décennies un système mondial de coordination et d’enregistrement des fréquences et des orbites associées. L’UIT cherche précisément à s’affirmer sur la question de la gestion du trafic spatial, quitte à empiéter sur le domaine de compétence traditionnel du CUPEEA. La base de compétence de l’UIT demeure relativement étroite. L’organisation ne peut intervenir que dans le cadre de la coopération internationale relative à l’utilisation du spectre des fréquences radioélectriques et des orbites qui leur sont associées, conformément à son mandat. Son action se limite ainsi aux aspects techniques et de coordination orbitale, sans s’étendre à la gestion opérationnelle ou juridique du trafic spatial au sens large, domaine qui relève encore d’autres instances internationales, notamment du CUPEEA.
Pour cette raison, les entreprises regroupées au sein d’associations professionnelles, telles que l’Association mondiale des opérateurs de satellite (GSOA) et la Space Data Association, sont de plus en plus présentes aux travaux du CUPEEA, dans l’espoir d’influencer l’orientation des futures discussions sur la gestion du trafic spatial. Leur participation se fait toutefois sous le statut limité de membres observateurs, qui ne leur confère aucun droit de vote. Le secteur privé est également invité à participer aux activités parallèles aux sessions du Comité, notamment les tables rondes et les présentations techniques. Ce positionnement en marge des négociations formelles explique la multiplication des initiatives des entreprises visant à peser sur les débats et à orienter l’élaboration des normes futures. Leur influence est d’autant plus significative que les contraintes budgétaires affectant l’ONU réduisent l’activité du Comité et que plusieurs délégations nationales manquent désormais d’expertise spatiale spécialisée, laissant davantage d’espace aux acteurs privés les mieux organisés.
Le défi normatif américain et la réponse européenne
Pour contrebalancer la puissance normative américaine, la Commission européenne a, de son côté, proposé en juin 2025 l’adoption d’un cadre réglementaire cohérent à l’échelle de l’Union européenne (UE). L’un des objectifs de la proposition de législation spatiale de l’UE (EU Space Act) est de favoriser l’émergence de normes techniques communes applicables à l’ensemble des États membres, tout en prévenant le risque de fragmentation du marché intérieur par la multiplication des législations spatiales nationales. La Commission européenne affiche également la volonté d’étendre l’application du droit de l’Union à tout fournisseur non européen proposant des services spatiaux au sein du marché européen, selon une logique désormais bien identifiée d’« effet Bruxelles » (Brussels effect). Cette stratégie normative a été appliquée avec succès dans le domaine des données personnelles avec le règlement UE 2016/679 général sur la protection des données, du Conseil du 27 avril 2016, plus connu sous l’appellation RGPD, qui s’est imposé comme la norme mondiale en la matière. Elle traduit l’ambition croissante de l’UE de se positionner comme une puissance régulatrice dans le domaine spatial, capable de structurer le marché mondial par la force de son cadre juridique et de ses exigences de conformité. La réponse officielle du gouvernement américain, transmise le 4 novembre 2025, exprime de vives préoccupations quant au projet européen, jugé trop contraignant et susceptible d’imposer des charges réglementaires excessives aux entreprises américaines opérant sur le marché européen. Cette réaction montre que l’initiative de la Commission européenne a déjà produit un effet d’influence, en amenant les États-Unis à prendre en considération les orientations réglementaires européennes, signe que l’Union est désormais perçue comme une potentielle force régulatrice dans le domaine spatial.
Cependant, pour que l’UE puisse réellement peser dans la compétition normative internationale, elle devra s’appuyer sur un écosystème industriel spatial solide et innovant en mesure de produire des standards techniques mondiaux. Le rôle de la Commission consiste donc non seulement à proposer un cadre réglementaire harmonisé, mais aussi à créer les conditions d’un leadership industriel, en soutenant la normalisation, l’innovation technologique et la diffusion des standards européens dans les forums internationaux. Il conviendrait toutefois de veiller à ce que cette initiative réglementaire n’alourdisse pas excessivement les charges de l’industrie européenne par des procédures complexes et coûteuses, au moment où l’administration américaine, sous la pression du secteur privé, pourrait au contraire assouplir ses propres exigences.

Contenu disponible en :
Thématiques et régions
ISBN / ISSN
Utilisation
Comment citer cette publicationPartager
Téléchargez l'analyse complète
Cette page ne contient qu'un résumé de notre travail. Si vous souhaitez avoir accès à toutes les informations de notre recherche sur le sujet, vous pouvez télécharger la version complète au format PDF.
Dynamiques et tensions normatives dans le domaine spatial : vers une américanisation du droit de l’espace ?
Centres et programmes liés
Découvrez nos autres centres et programmes de rechercheEn savoir plus
Découvrir toutes nos analysesL’espace, îlot de coopération dans un monde divisé ? Ariane 6 et la Station spatiale internationale face aux recompositions géopolitiques
La semaine dernière a marqué un double événement historique pour l’Europe spatiale : le premier vol d’Ariane 6 dans sa configuration la plus puissante et l’envol de l’astronaute française Sophie Adenot vers la Station spatiale internationale (ISS). Ces deux succès posent une question en filigrane : l’espace peut-il demeurer un lieu de coopération dans un monde de plus en plus structuré par la compétition économique et les rivalités stratégiques ?
Les narratifs spatiaux. Enjeux stratégiques et perspective européenne
Les récits que les puissances construisent autour de l’espace jouent aujourd’hui un rôle déterminant dans leur stratégie. Aux États-Unis, la référence à la frontière et à la destinée manifeste continue de structurer un narratif d’expansion, où l’exploration spatiale incarne la vocation nationale à repousser les limites et à maintenir une excellence technologique. En Russie, le spatial demeure un instrument central de puissance et de prestige, hérité de l’époque soviétique mais désormais réorienté par un récit privilégiant la militarisation. La Chine inscrit son « rêve spatial » dans un projet de renaissance nationale : ses réussites technologiques et scientifiques deviennent les vecteurs de son nouveau statut international. D’autres acteurs, comme l’Inde, le Japon ou les Émirats arabes unis, mobilisent l’espace pour affirmer leur modernité, renforcer leur autonomie ou projeter un leadership régional.
La durabilité des opérations spatiales : une opportunité pour un leadership européen?
Alors que le domaine spatial est plus que jamais réinvesti par des stratégies de puissance, et fait face à l’accroissement et à la diversification des activités en orbite, le discours sur la « durabilité » des opérations spatiales offre un nouveau cadre d’analyse pour la gouvernance de l’espace.
Le modèle spatial européen : une ambition à renouveler face aux transformations stratégiques
Le modèle spatial européen, fondé sur la science, la coopération et le commerce, est désormais fragilisé par les évolutions des relations internationales et les bouleversements économiques induits par le New Space. Face à la guerre en Ukraine et au désengagement américain, l’Europe doit repenser sa stratégie en ajoutant un quatrième pilier dédié à la défense, afin de renforcer sa souveraineté et décourager d’éventuelles agressions contre le continent.