États-Unis/Taïwan : le temps de la confusion stratégique

En s’opposant à la volonté de la Chine d’annexer Taïwan, les États-Unis d’Amérique contribuent, depuis des décennies, au maintien du statu quo, toute tentative d’invasion chinoise entraînant, avec une potentielle intervention américaine, le risque d’une nouvelle guerre mondiale. Mais dans l’agitation suscitée par les conséquences internationales du retour au pouvoir de Donald Trump, une question sème le trouble dans les esprits : à l’égard de Taïwan, quelle sera l’attitude d’une administration dédaigneuse des alliés des États-Unis mais obsédée par la compétition avec la Chine ?
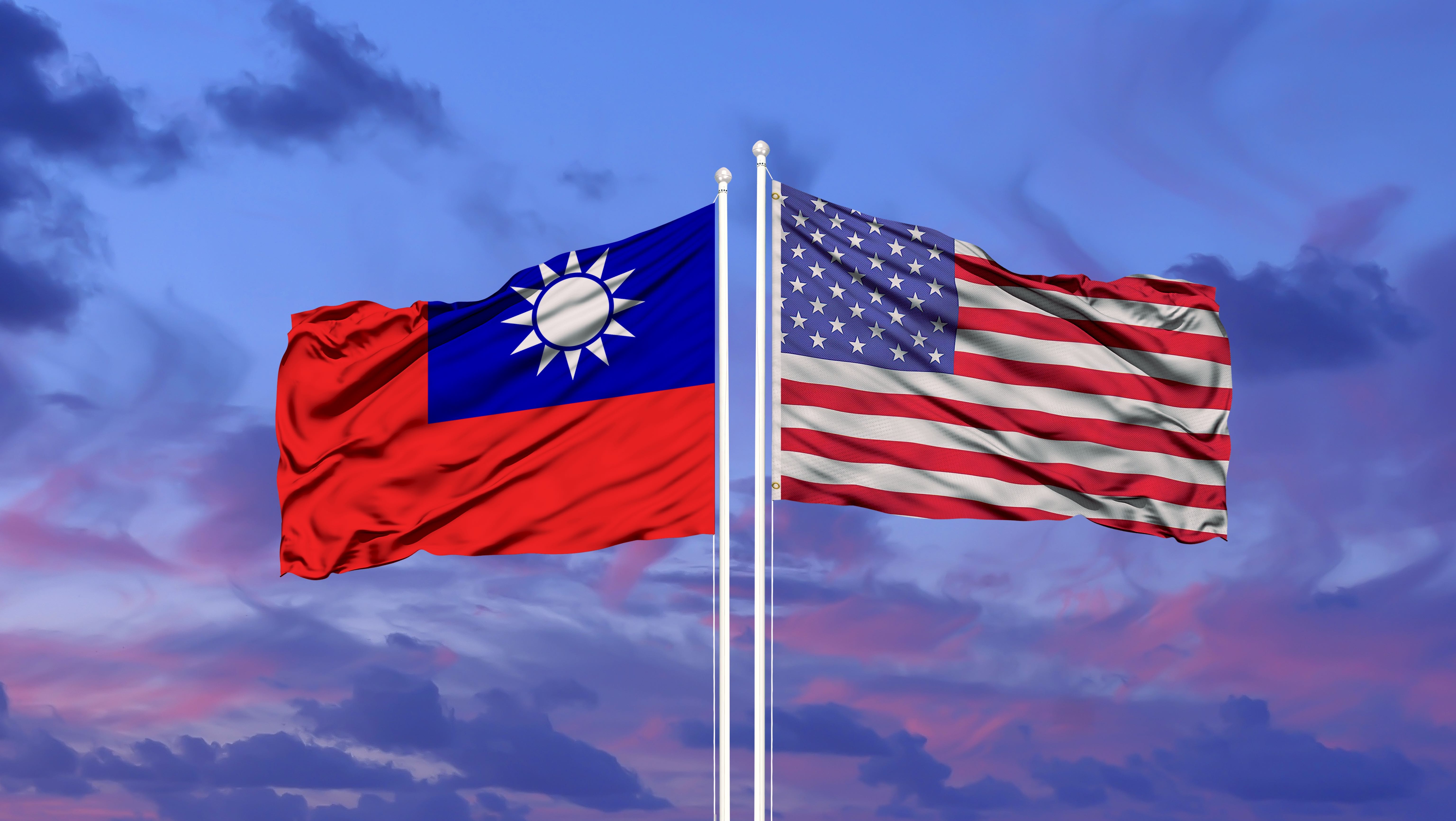
À ce sujet, deux thèses ont été exprimées. La première va dans le sens de la pérennité de la protection américaine de Taïwan : si les États-Unis s’apprêtent à abandonner l’Ukraine à la Russie, ce serait pour se concentrer sur leur véritable ennemi, la Chine. La seconde affirme au contraire que Taïwan pourrait perdre le soutien américain : les États-Unis la sacrifieraient à la Chine contre des compensations dans l’hémisphère occidental. Mais la politique de Donald Trump n’a probablement pas la cohérence que lui prêtent ces représentations et il paraît aussi excessif de tabler sur la protection pérenne de Taïwan que d’annoncer sa trahison par les États-Unis. L’ambiguïté stratégique risque plutôt de succéder à la confusion stratégique.
L’évaluation de l’importance de Taïwan pour la nouvelle administration américaine suppose d’examiner ce qu’il reste du cadre mis en place pour les relations avec l’île du temps de la Pax Americana, qui semble toucher à son terme. Pendant des décennies, Taïwan a été au cœur du dispositif américain en Asie orientale, verrouillant l’expansion de la Chine vers le Pacifique. Taipei aura désormais fort à faire, dans cette nouvelle ère incertaine, pour convaincre le président américain de son intérêt à maintenir ce verrou. Si rien n’autorise pour le moment à conclure au désengagement américain, les signaux équivoques envoyés par une nouvelle administration Trump déjà divisée augmentent les risques d’un mauvais calcul de la Chine à un moment déjà extrêmement dangereux pour les relations sino-américaines. Sans tendre vers la guerre imminente, cela la rend déjà un peu moins improbable.

Contenu disponible en :
Thématiques et régions
ISBN / ISSN
Utilisation
Comment citer cette publicationPartager
Téléchargez l'analyse complète
Cette page ne contient qu'un résumé de notre travail. Si vous souhaitez avoir accès à toutes les informations de notre recherche sur le sujet, vous pouvez télécharger la version complète au format PDF.
États-Unis/Taïwan : le temps de la confusion stratégique
Centres et programmes liés
Découvrez nos autres centres et programmes de rechercheEn savoir plus
Découvrir toutes nos analysesJapon : le raz-de-marée Takaichi et le nouveau visage du pouvoir
La Première ministre Sanae Takaichi a transformé sa popularité exceptionnelle en une victoire politique historique. Les élections anticipées du 8 février ont offert au Parti libéral démocrate (PLD) une majorité écrasante, grâce au soutien massif de jeunes électeurs séduits par son image iconoclaste et dynamique, et des conservateurs rassurés par sa vision d’affirmation nationale. Cette popularité pose les bases d’une stratégie ambitieuse tant sur le plan intérieur que sur le plan international.
Élections en Thaïlande : les conservateurs consolident leur ancrage
À rebours des sondages, le parti conservateur pro-business Bhumjaithai a dominé les élections législatives anticipées du 8 février 2026 et s’est imposé à la Chambre basse avec 193 sièges sur 500, enregistrant une progression record par rapport aux 71 députés élus en 2023.
Crise politique en Thaïlande : la tactique du chaos
La Thaïlande a replongé à l’été 2025 dans une crise politique profonde. La suspension de la Première ministre, Paetongtarn Shinawatra, par la Cour constitutionnelle a provoqué l’implosion de la coalition au pouvoir. Cette crise ressemble pourtant aux précédentes. Une banalité répétitive qui interroge à la fois le sens des responsabilités des principaux dirigeants et qui génère au sein de la population un cynisme mâtiné de résignation.

Ouverture du G7 à la Corée du Sud : relever les défis mondiaux contemporains
L'influence mondiale du G7 s'est affaiblie à mesure que des puissances telles que la Chine remodèlent la gouvernance internationale à travers des initiatives telles que les BRICS et l'Organisation de Coopération de Shanghai (OCS). Le G7 ne représentant plus aujourd'hui que 10 % de la population mondiale et 28 % du PIB mondial, sa pertinence est de plus en plus remise en question.











