The Kashmir Uprising and India-Pakistan Relations: A need for conflict resolution, not management
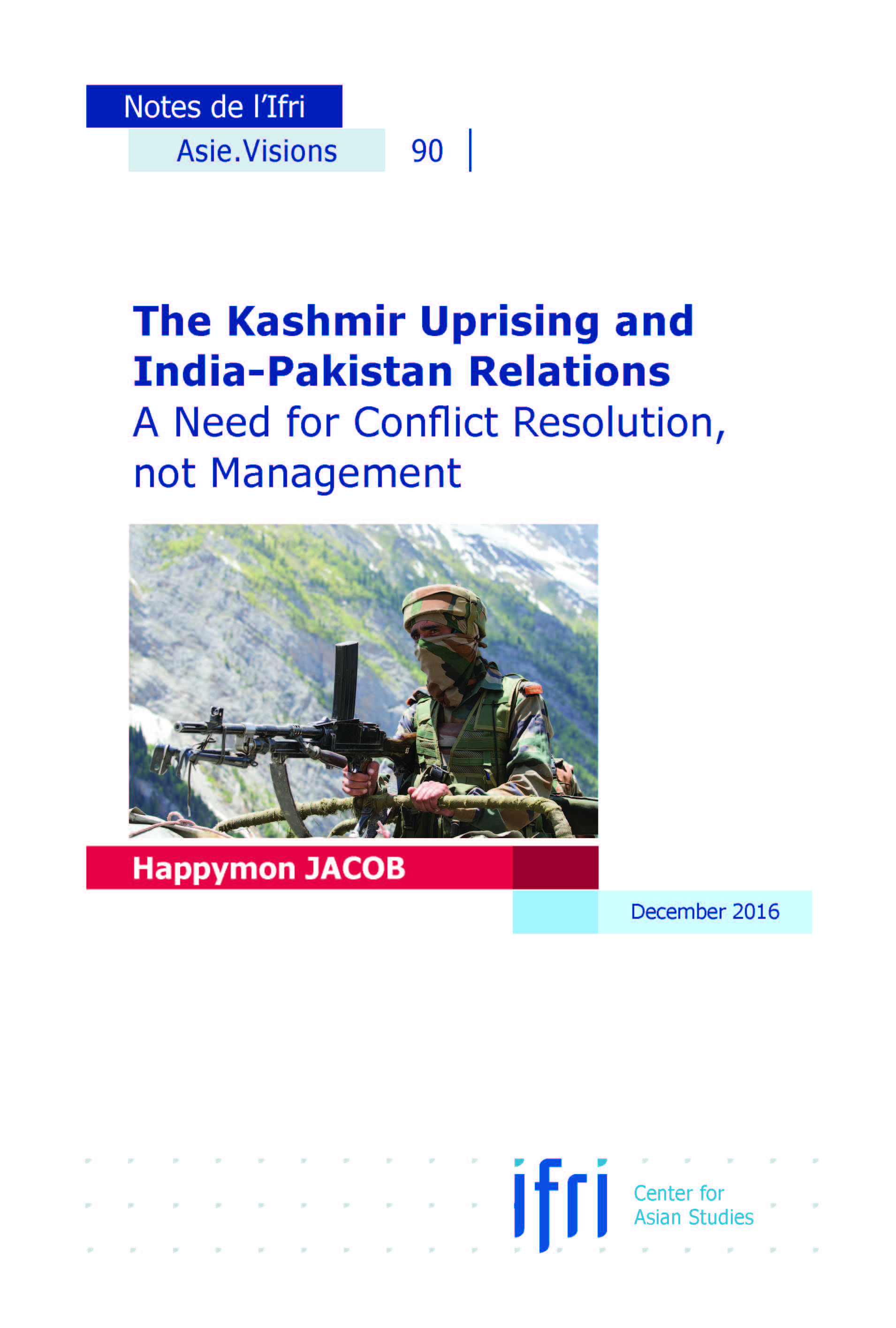
Cette étude analyse les causes et les conséquences de l’insurrection de 2016 au Cachemire, en formulant six arguments liés entre eux.

Tout d’abord, elle soutient qu’en dépit des multiples différends opposant l’Inde au Pakistan, y compris sur le Glacier de Siachen ou sur Sir Creek, le Cachemire continue d’être le conflit le plus marquant : il constitue en effet un élément clé du rapprochement entre les deux rivaux sud-asiatiques. D’ailleurs, lorsque les deux parties se sont vraiment penchées sur la question du Cachemire, entre 2003 et 2007/2008, leurs relations se sont sensiblement améliorées sur d’autres fronts.
Ensuite, la complicité directe ou indirecte de l’Etat pakistanais dans les actes terroristes perpétrés contre l’Inde explique, en tout premier lieu, l’incapacité des deux pays à faire aboutir leurs dialogues bilatéraux.
Troisièmement, cette étude souligne que le retour à la normalité au Cachemire peut s’avérer illusoire. Le soulèvement de 2008 était complètement inattendu, étant donné que la précédente insurrection s’était soldée par un échec et que la relation entre l’Inde et le Pakistan avait connu des avancées positives. Ainsi, depuis 2008, le retour à la normale – c’est-à-dire une situation où la population semble vaquer à ses affaires quotidiennes sans s’engager dans un activisme politique déclaré ou dans des manifestations – n’est qu’un répit provisoire entre de graves émeutes. Penser que cette normalité temporaire signifie l’arrêt définitif des mouvements insurrectionnels s’est avéré trompeur plus d’une fois.
Quatrièmement, cette étude soutient que la nouvelle insurrection qui se développe au Cachemire ressemble assez peu à celle qui a commencé à la fin des années 1980 et qui s’est essoufflée dans le milieu des années 1990. Aujourd’hui, il y a au Cachemire une nouvelle vague de jeunes militants éduqués, dont une bonne partie est animée par des motivations religieuses, ce qui est très différent des années 1990. Il s’agit incontestablement d’un mouvement autochtone. New Delhi devra faire des efforts exceptionnels pour empêcher le Cachemire de basculer à nouveau dans l’insurrection.
Cinquièmement, le conflit du Cachemire est l’expression d’une contestation politique agissant à plusieurs niveaux, à laquelle il faudrait répondre de façon concrète mais aussi symbolique. Si le gouvernement BJP n’a pas pu établir de dialogue avec les séparatistes Cachemiris, c’est notamment parce que son positionnement politique entre directement en conflit – au plan symbolique – avec celui des séparatistes.
Enfin, la dynamique électorale en Inde a un clair impact sur la capacité de New Delhi à résoudre le conflit au Cachemire. Résoudre ce conflit de manière satisfaisante pour les deux parties ferait effectivement sens d’un point de vue stratégique, mais pas nécessairement au regard des considérations électorales de court-terme : or ce sont bien ces dernières qui semblent façonner la politique du BJP au Cachemire.
Ce contenu est disponible en anglais: The Kashmir Uprising and India-Pakistan Relation: A need for conflict resolution, not management

Contenu disponible en :
Régions et thématiques
Utilisation
Comment citer cette publicationPartager
Centres et programmes liés
Découvrez nos autres centres et programmes de rechercheEn savoir plus
Découvrir toutes nos analysesJapon : le raz-de-marée Takaichi et le nouveau visage du pouvoir
La Première ministre Sanae Takaichi a transformé sa popularité exceptionnelle en une victoire politique historique. Les élections anticipées du 8 février ont offert au Parti libéral démocrate (PLD) une majorité écrasante, grâce au soutien massif de jeunes électeurs séduits par son image iconoclaste et dynamique, et des conservateurs rassurés par sa vision d’affirmation nationale. Cette popularité pose les bases d’une stratégie ambitieuse tant sur le plan intérieur que sur le plan international.
Élections en Thaïlande : les conservateurs consolident leur ancrage
À rebours des sondages, le parti conservateur pro-business Bhumjaithai a dominé les élections législatives anticipées du 8 février 2026 et s’est imposé à la Chambre basse avec 193 sièges sur 500, enregistrant une progression record par rapport aux 71 députés élus en 2023.
Crise politique en Thaïlande : la tactique du chaos
La Thaïlande a replongé à l’été 2025 dans une crise politique profonde. La suspension de la Première ministre, Paetongtarn Shinawatra, par la Cour constitutionnelle a provoqué l’implosion de la coalition au pouvoir. Cette crise ressemble pourtant aux précédentes. Une banalité répétitive qui interroge à la fois le sens des responsabilités des principaux dirigeants et qui génère au sein de la population un cynisme mâtiné de résignation.

Ouverture du G7 à la Corée du Sud : relever les défis mondiaux contemporains
L'influence mondiale du G7 s'est affaiblie à mesure que des puissances telles que la Chine remodèlent la gouvernance internationale à travers des initiatives telles que les BRICS et l'Organisation de Coopération de Shanghai (OCS). Le G7 ne représentant plus aujourd'hui que 10 % de la population mondiale et 28 % du PIB mondial, sa pertinence est de plus en plus remise en question.











