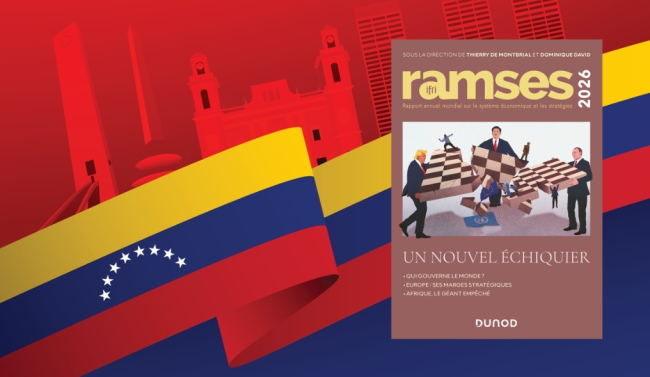La guerre commerciale sino-américaine : quel bilan à l'issue de la présidence Trump ?
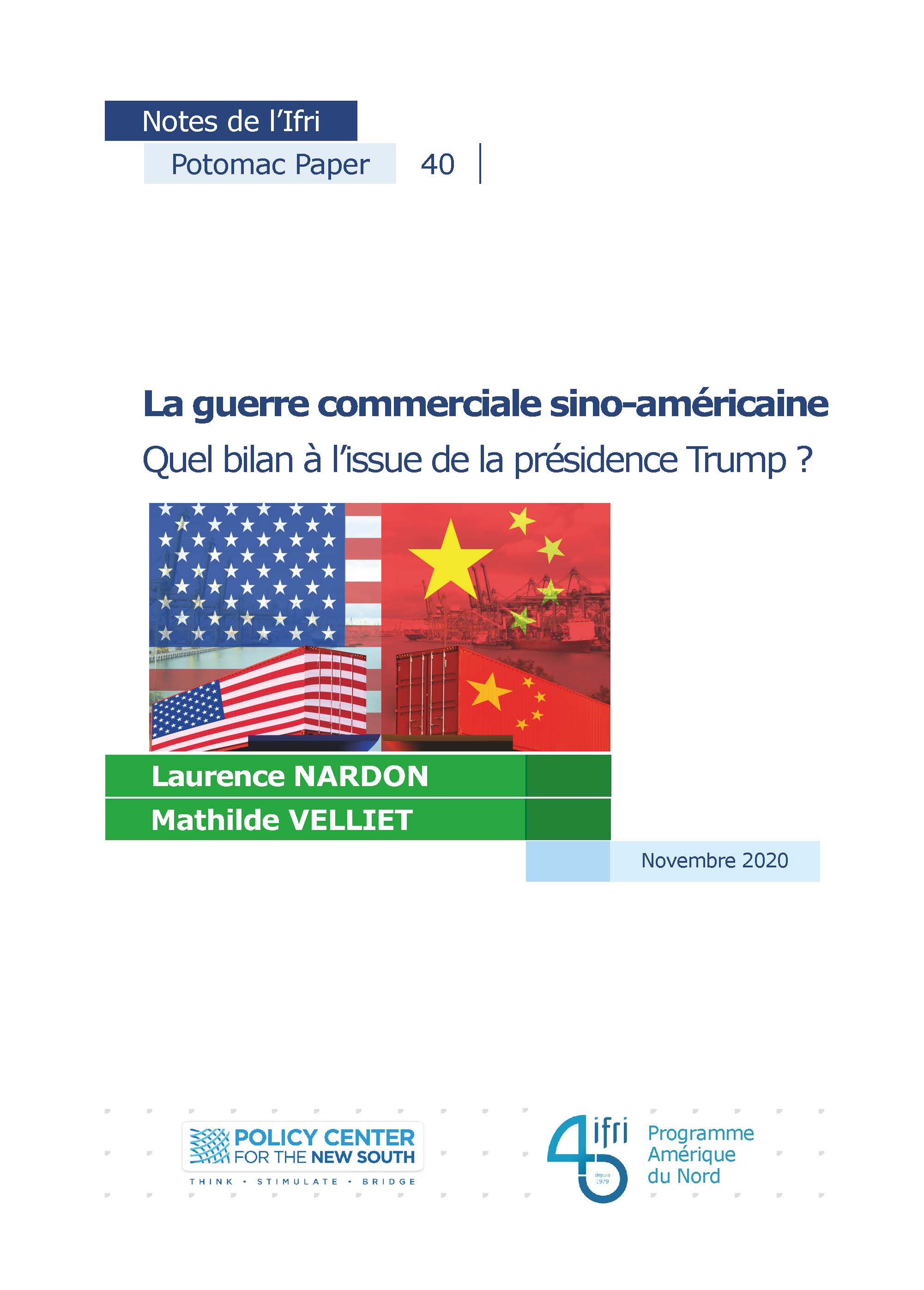
En 2016, l’une des grandes promesses de campagne de Donald Trump était de mettre fin aux pratiques chinoises jugées injustes et responsables du déficit commercial américain en imposant d’importants droits de douane. A l’issue de son mandat, un premier bilan de sa politique - et de la "guerre commerciale" qui en a découlé - peut être dressé.

Les pratiques dénoncées par Trump – sous-évaluation du yuan, transferts forcés de technologie, violations de la propriété intellectuelle, manque d’ouverture aux importations – s’inscrivent dans la ligne directe des reproches formulés par les Américains (et, dans une certaine mesure, les Européens) depuis vingt ans. La « guerre commerciale » matérialisée par la hausse des droits de douane en 2018-2019 ne représente donc pas tant un changement de fond qu’une rupture de méthode. Par l’imposition massive de barrières douanières unilatérales, l’administration Trump s’est écartée de la tradition américaine qui privilégie les mécanismes multilatéraux et l’utilisation ponctuelle de droits de douanes ciblés.
Quelle est le rôle de cette guerre commerciale dans la compétition technologique et stratégique sino-américaine ? Quelles conséquences l’escalade tarifaire de 2018-2019 a-t-elle eues sur les économies américaine et chinoise ? Quel sera son impact sur la gouvernance multilatérale du commerce ? A la suite de l’accord « Phase Un », signé en janvier 2020, quelles perspectives de résolution de ces différends ?

Contenu disponible en :
Régions et thématiques
ISBN / ISSN
Utilisation
Comment citer cette publicationPartager
Téléchargez l'analyse complète
Cette page ne contient qu'un résumé de notre travail. Si vous souhaitez avoir accès à toutes les informations de notre recherche sur le sujet, vous pouvez télécharger la version complète au format PDF.
La guerre commerciale sino-américaine : quel bilan à l'issue de la présidence Trump ?
Centres et programmes liés
Découvrez nos autres centres et programmes de rechercheEn savoir plus
Découvrir toutes nos analysesVenezuela : un pouvoir affermi
Nicolás Maduro semble plus impopulaire que jamais dans la population vénézuélienne, mais il verrouille aussi de manière toujours plus affirmée le système politique et institutionnel du pays. À l’extérieur, Donald Trump semble engager un nouveau bras de fer avec le gouvernement vénézuélien, dans une logique qui paraît très imprévisible.
De l'IRA à l'OBBA : les entreprises françaises de l'énergie aux États-Unis
Adopté en 2022 sous l’administration Biden, l’Inflation Reduction Act (IRA) a marqué un tournant historique dans la politique énergétique américaine, offrant une visibilité supposée de long terme et attirant les investissements. De 2022 à 2024, les investissements américains dans les énergies propres ont atteint près de 500 milliards de dollars (+ 71 % en deux ans).
Le Brésil à un an des élections générales d’octobre 2026
Les élections générales brésiliennes auront lieu le 4 octobre 2026 afin d’élire le président, le vice-président, les membres du Congrès national, les gouverneurs, les vice-gouverneurs et les assemblées législatives des états de la fédération. Pour les élections du président et des gouverneurs, un second tour sera organisé le 25 octobre si aucun candidat n’obtient la majorité des suffrages au premier tour.
États-Unis : la liberté d’expression face aux attaques du mouvement MAGA
La séquence ouverte par l’assassinat de l’influenceur conservateur Charlie Kirk le 10 septembre 2025 illustre l’importance et la relative fragilité du principe de liberté d’expression dans la société américaine.