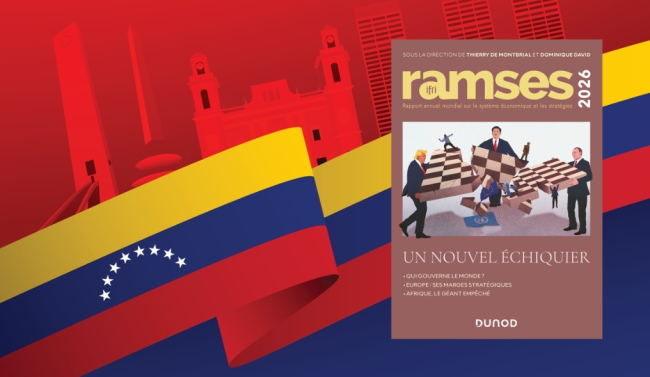Les think tanks américains sous Trump 2. Le "blob" en péril ?

Principalement voués aux questions de politique étrangère, les think tanks de Washington jouent un rôle clé de réflexion et d’expertise au service du gouvernement fédéral, auquel ils fournissent par ailleurs des cadres d’élite à l’occasion des alternances politiques. Le trumpisme vient aujourd’hui en bousculer les codes et le fonctionnement.

Cette riche industrie s’est constituée à partir des années 1910 : dans le contexte de l’ère progressiste, elle établit alors une approche technocratique du gouvernement et repose sur la philanthropie privée. Après 1945, de nouveaux centres financés par le gouvernement fédéral et les grandes entreprises d’armement accompagnent la mue du pays en superpuissance stratégique et militaire. En version non partisane ou néo-conservatrice, ils sont à peu près tous au service du consensus internationaliste libéral de l’après-guerre.
Dès les années 2010, lorsque le terme moqueur de « blob » leur est accolé par le conseiller de Barack Obama, Ben Rhodes, on leur reproche un conformisme intellectuel ayant couvert les guerres en Afghanistan et en Irak, ainsi qu’un modèle de financement qui autorise l’opacité de leurs donateurs. Ironiquement, le désengagement de l’état trumpien risque aujourd’hui d’augmenter la part de leurs financements venus de l’étranger ou d’acteurs privés poursuivant des agendas particuliers.
Têtes de pont au sein d’un vaste ensemble pro-Trump, la Heritage Foundation, le America First Policy Institute et le Claremont Institute viennent contester l’ordre établi du « blob » et défendre un programme America First nationaliste et conservateur. Malgré des opinions différentes sur le rôle des États-Unis dans le monde (importance de la force militaire ou position restrainer), sur l’importance de la menace chinoise (prioritizers) ou sur le poids de l’alliance avec Israël face à l’Iran, ils ont en commun le rejet de l’ordre international libéral et des élites de la capitale. Ils ont fourni de nombreux responsables à l’administration Trump 2. Face à leur radicalité politique, certains think tanks plus anciens questionnent leur propre tradition non partisane.
La décision du président Trump de frapper l’Iran aux côtés des Israéliens à la mi-juin 2025 constitue en première analyse une preuve supplémentaire de sa volatilité et du court-termisme stratégique inhérent à son unilatéralisme. Mais les néo-conservateurs partisans des interventions militaires et du changement de régime y voient sans doute le signe de leur possible retour en grâce. Faut-il les croire ?


Contenu disponible en :
Thématiques et régions
ISBN / ISSN
Utilisation
Comment citer cette publicationPartager
Téléchargez l'analyse complète
Cette page ne contient qu'un résumé de notre travail. Si vous souhaitez avoir accès à toutes les informations de notre recherche sur le sujet, vous pouvez télécharger la version complète au format PDF.
Les think tanks américains sous Trump 2. Le "blob" en péril ?
Centres et programmes liés
Découvrez nos autres centres et programmes de rechercheEn savoir plus
Découvrir toutes nos analysesVenezuela : un pouvoir affermi
Nicolás Maduro semble plus impopulaire que jamais dans la population vénézuélienne, mais il verrouille aussi de manière toujours plus affirmée le système politique et institutionnel du pays. À l’extérieur, Donald Trump semble engager un nouveau bras de fer avec le gouvernement vénézuélien, dans une logique qui paraît très imprévisible.
De l'IRA à l'OBBA : les entreprises françaises de l'énergie aux États-Unis
Adopté en 2022 sous l’administration Biden, l’Inflation Reduction Act (IRA) a marqué un tournant historique dans la politique énergétique américaine, offrant une visibilité supposée de long terme et attirant les investissements. De 2022 à 2024, les investissements américains dans les énergies propres ont atteint près de 500 milliards de dollars (+ 71 % en deux ans).
Le Brésil à un an des élections générales d’octobre 2026
Les élections générales brésiliennes auront lieu le 4 octobre 2026 afin d’élire le président, le vice-président, les membres du Congrès national, les gouverneurs, les vice-gouverneurs et les assemblées législatives des états de la fédération. Pour les élections du président et des gouverneurs, un second tour sera organisé le 25 octobre si aucun candidat n’obtient la majorité des suffrages au premier tour.
États-Unis : la liberté d’expression face aux attaques du mouvement MAGA
La séquence ouverte par l’assassinat de l’influenceur conservateur Charlie Kirk le 10 septembre 2025 illustre l’importance et la relative fragilité du principe de liberté d’expression dans la société américaine.