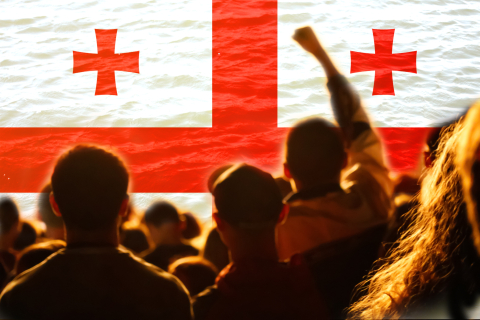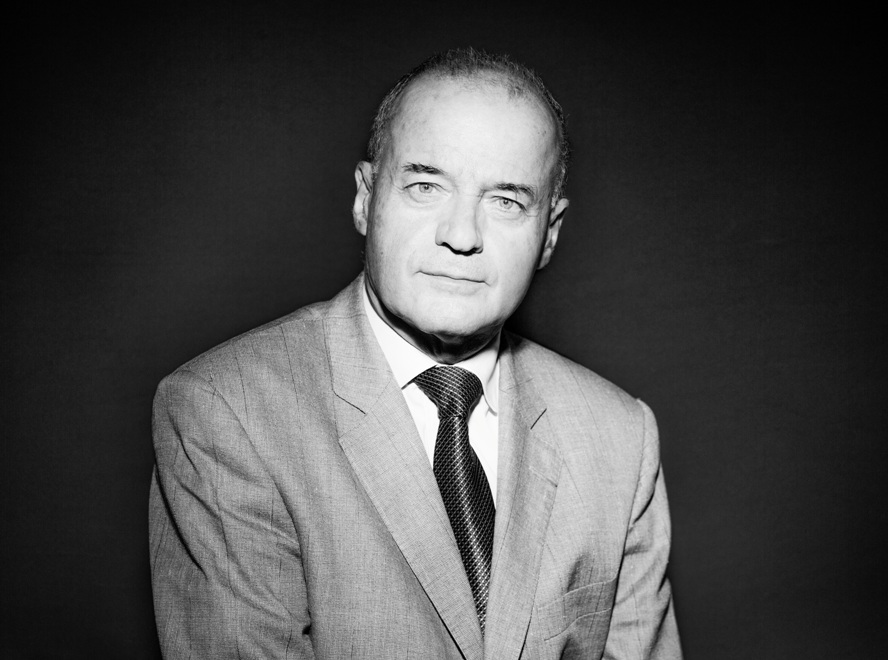Pour l'Europe, une conception globale de sécurité ?

Le prochain sommet européen consacré à la défense commune remet en lumière le débat sur les institutions collectives chargées de notre sécurité, leurs relations et leur efficacité.
L’efficacité de l’Alliance dépend de la capacité de ses membres à assumer les tâches identifiées par son dernier Concept stratégique : défense collective, gestion des crises, sécurité collective. Mais les interprétations divergent sur l’articulation de ces trois rôles.
La défense collective, la dissuasion globale de l’agression, demeurent fondamentales pour nombre des alliés. Il ne s’agit plus de raisonner en termes de guerre froide ; mais de réaffirmer que même si elle doit assumer des tâches nouvelles, l’OTAN doit d’abord préserver la capacité de défendre ses propres Etats-membres. On peut imaginer d’élargir le rôle de l’Alliance au service de la sécurité collective, mais seulement si est réaffirmée et préservée sa fonction de défense. L’efficacité du rôle de l’OTAN au service de la paix dépend d’ailleurs de son efficacité au service de cette défense collective.
L’OTAN et ses membres doivent donc : 1) actualiser leurs plans de défense ; 2) décider d’investissements suffisants en matière d’infrastructures militaires, à partir du budget commun – c’est cet investissement qui rend visible l’engagement de défense de l’Alliance, et peut pousser les Etats européens à renforcer leur part dans le budget de l’organisation ; 3) concrétiser cet engagement par des entraînements et manœuvres communs.
Les sommets de Lisbonne et de Chicago ont remis en lumière ces objectifs, rappelant l’importance de l’article 5 du traité de Washington, et le nécessaire développement des capacités militaires : interopérabilité, entraînement, exercices... L’importance de la Force de réaction rapide a aussi été soulignée. En novembre dernier, la Pologne a accueilli, avec les trois Etats baltes - et avec une significative contribution française - le premier exercice live de cette force (Steadfast Jazz) sur un scénario " de l’article 5 ". De tels exercices devraient se multiplier : ils renforcent l’opérationnalité des forces pour l’ensemble de nos capacités.
Les deux rives de l’Atlantique comptent
C’est la force du lien transatlantique qui fonde l’OTAN. Les actuels glissements de la stratégie américaine pourraient pourtant affaiblir l’engagement américain. Ces changements s’appuient sur quelques présupposés : pour l’heure, les Européens sont des partenaires de l’Amérique face aux défis globaux ; et l’Europe est en mesure d’assumer plus largement sa sécurité. Cette dernière assertion est hélas contestable ; la prendre pour un acquis serait dangereux pour nos défenses.
Américains et Européens doivent demeurer interopérables, s’entraîner ensemble, rapprocher encore leurs appareils militaires : le déploiement en Pologne d’un détachement aérien est à cet égard un symbole positif. Les Européens ne peuvent que souhaiter que les changements en cours aux Etats-Unis maintiennent un volant suffisant de forces américaines pouvant être affectées au Vieux continent.
Le recul global des budgets de défense menace l’efficacité militaire de l’Alliance. Il doit être stoppé, et les efforts multinationaux peuvent constituer une solution : la smart defense (OTAN), le processus de mutualisation et partage des moyens - pooling and sharing - des Européens, vont dans le bon sens, s’ils aident à couper les coupes - et non à justifier des coupes supplémentaires… Notre niveau d’ambition militaire doit se maintenir, non se réduire.
L’Union européenne est loin d’avoir réalisé son potentiel en matière de sécurité et de défense. Les missions et opérations militaires de l’UE ont montré une incontestable capacité à intervenir - politiquement, militairement - dans les crises, mais aussi de sévères trous capacitaires. La Politique commune de sécurité et de défense (PCSD) est un instrument pour agir ; elle doit se renforcer : de nouveaux moyens de planification, de conduite des opérations, et de coordination civilo-militaire.
Deux idées font ici obstacle. La première voit dans tout progrès militaire européen une duplication des moyens de l’OTAN ; l’autre est que le renforcement de la PSDC réduit la marge de manœuvre des politiques nationales de défense. Ces deux assertions sont fausses, il faut le répéter. Et l’UE ne doit pas se contenter des missions dont elle se juge aujourd’hui capable, avec ou sans l’OTAN ; elle doit plutôt élargir le spectre de ces opérations. La PSDC n’a pas besoin de nouvelles institutions, mais de volonté politique, d’une impulsion semblable à celle qui l’a lancée voici plus de dix ans.
Certes, ceci suppose que l’UE définisse une politique étrangère. Cette politique est aujourd’hui gérée, pour leur propre compte, par les Etats-membres parallèlement à la Politique étrangère et de sécurité commune (PESC). L’UE doit d’abord se donner les moyens de décisions communes concernant les régions les moins sûres de son environnement : Europe de l’Est, Méditerranée, Moyen-Orient, Afrique sub-saharienne… L’UE devrait pouvoir unifier les politiques étrangères de ses Etats-membres dans des positions cohérentes.
Jusqu’ici, les Européens ont largement joué sur la dimension technique pour occulter la dimension politique. Ils doivent maintenant se mesurer à l’ensemble de leur problématique de sécurité : des choix politiques et diplomatiques jusqu’aux capacités militaires, en passant par la planification des opérations.
Tribune publiée sur Le Cercle Les Echos.fr le 13 décembre 2013.
Bogdan KLICH, sénateur, ancien ministre de la Défense de Pologne et Dominique DAVID, directeur exécutif de l’Institut français des relations internationales (Ifri).

Contenu disponible en :
Régions et thématiques
Utilisation
Comment citer cette publicationPartager
Centres et programmes liés
Découvrez nos autres centres et programmes de rechercheEn savoir plus
Découvrir toutes nos analysesChar de combat : obsolescence ou renaissance ?
Depuis février 2022, les forces russes et ukrainiennes ont perdu plus de 5 000 chars de combat, un volume très supérieur à l’ensemble du parc européen actuel. Fer de lance de la doctrine soviétique dont sont issus les deux belligérants, le char a été déployé en grand nombre et s’est avéré être une cible de choix pour des drones devenus de plus en plus nombreux et efficaces au fil des mois. Le grand nombre de vidéos de frappes de drone contre des chars a d’ailleurs poussé un certain nombre d’observateurs à conclure, une fois de plus, à l’obsolescence de ceux-ci sur un champ de bataille moderne. Cette approche doit être nuancée par une étude plus fine des pertes, les drones n’étant que rarement à l’origine de la perte elle-même causée par la conjugaison de plusieurs facteurs comme les mines, l’artillerie ou d’autres armes antichar.
Quelle autonomie capacitaire pour l’Europe ? Une analyse multi-domaine
La dégradation de la situation sécuritaire en Europe depuis l’invasion à grande échelle de l’Ukraine incite les pays européens à accroître significativement leurs capacités militaires pour rester dissuasifs face à la menace majeure que représente désormais la Fédération de Russie. Par ailleurs, la politique américaine de burden shifting incite les Européens à envisager une moindre contribution des États-Unis à la défense du continent en général. Ce constat appelle à identifier plus finement le degré d’autonomie capacitaire des nations européennes et de leurs armées.
« Glaives de fer ». Une analyse militaire de la guerre d’Israël à Gaza
Le 7 octobre 2023, l’attaque du Hamas baptisée « Déluge d’al-Aqsa » a provoqué un choc majeur et a conduit Israël à déclencher la guerre la plus longue de son histoire. L’opération « Glaives de fer » se distingue par son intensité inédite, tant par l’engagement de forces terrestres massives que par la puissance de feu déployée.
Comprendre l'écosystème d'acquisition de l'OTAN
L’Organisation du traité de l’Atlantique nord (OTAN) achète chaque année des biens et des services à hauteur de plusieurs milliards d’euros. Il convient toutefois de distinguer ce qui est financé en commun de ce qui l’est nationalement, par chacun des alliés. Cette grille de lecture doit permettre aux entreprises, selon leur taille et leur secteur d’activité, d’identifier les opportunités de marché et quel sera l’acteur de l’acquisition. Il faut donc comprendre la manière dont l’Alliance détermine ses besoins et comment elle les finance afin de pouvoir identifier, selon le secteur d’activité, quels seront les acteurs de l’acquisition.