L'Alliance atlantique 1949-2009
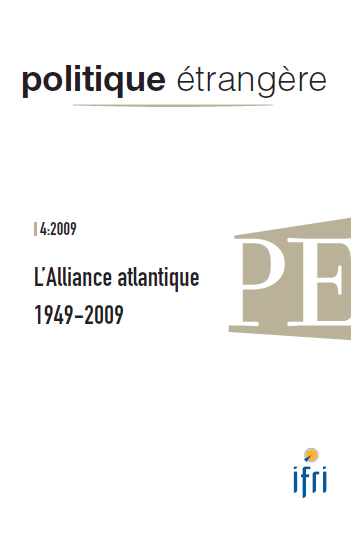
Un peu plus de soixante années après sa création, les interrogations sur l'avenir de l'Alliance se développent au confluent de trois constats. L'illisibilité du monde rend l'Alliance "inévitable", comme un des rares pôles de stabilité, de solidarité sur une planète parcourue d'incertitudes. Deuxième constat : le doute américain. Gendarme universel pour quelques esprits simples au début des années 1990, les États-Unis auraient consumé leur puissance dans l'aventurisme bushien. L'avenir oubliera les deux caricatures. Pour les membres de l'Alliance, les États-Unis demeureront encore longtemps l'ami nécessaire dont on redoute à la fois la puissance et le possible lâchage… Le troisième constat est, bien évidemment, cet incurable ethnocentrisme européen : si les Européens savaient voir le monde et la place qu'ils y tiennent, ils abandonneraient plus vite leurs médiocres impuissances. L'histoire va, ailleurs, plus vite, et pose dans son cheminement chaotique des questions auxquelles les autres répondent, l'Alliance pourra donc jouer, dans les années à venir, sans l'Europe, ou presque sans elle – et ce, même si les savoir-faire spécifiques des Européens peuvent lui être utiles.
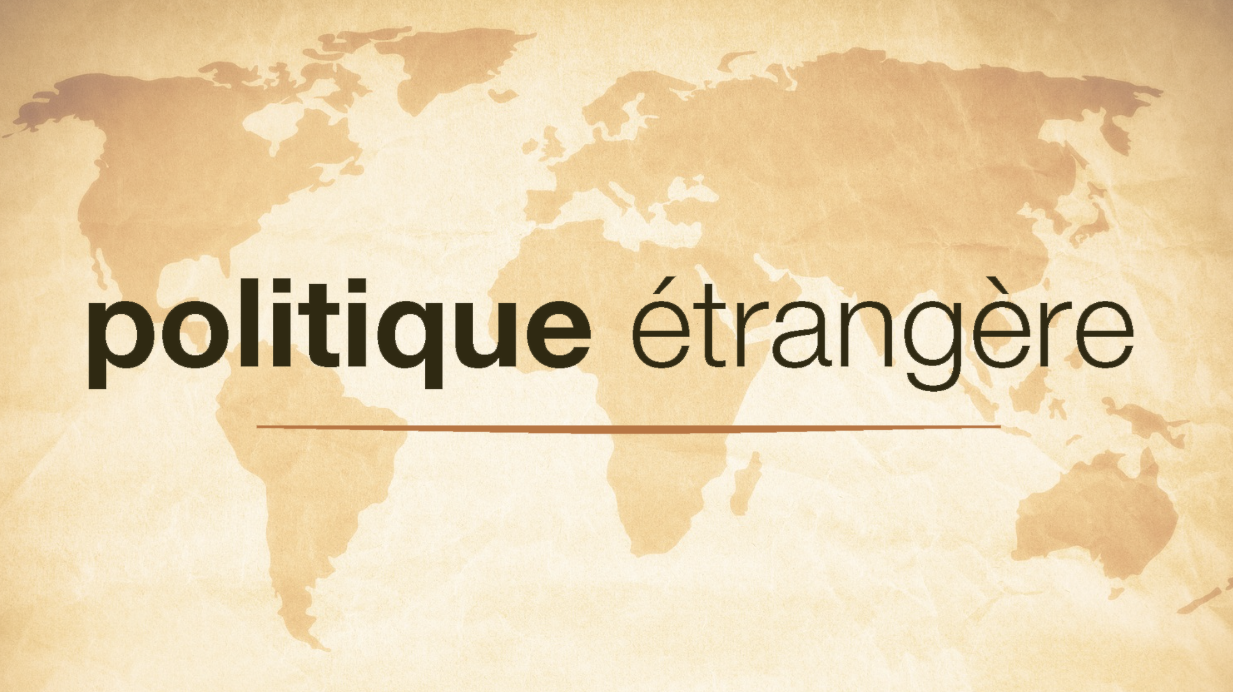
« 1989 : quarante ans d'existence, et la victoire sans feu. L'Alliance atlantique est bien alors le plus clair symbole de la victoire de l'Occident, puisque le camp d'en face se défait en détricotant le pacte de Varsovie. Victorieuse sans responsabilité directe dans la victoire, l’Alliance est à l’avant-poste pour les gains et les risques de cette dernière : l’acquis d’un Occident qui s’imagine brusquement être le monde ; et le danger d’un occidentalo-centrisme qui ne mettra que dix ans à se dissiper. Les acquis, les succès, les états d’âme, les erreurs et les échecs, bref les débats de l’Alliance sont bien le reflet – légèrement distordu mais fidèle tout de même – d’un Occident qui ne connaît plus ses limites et qui, en pleine gloire, s’interroge sur son avenir.
Depuis 1989, l’Alliance atlantique – comme l’Organisation du traité de l’Atlantique nord (OTAN), puisqu’on rappellera au seuil de ce numéro que les Français aiment à distinguer les deux, institutionnellement et politiquement, bien que seuls à le faire –, l’Alliance atlantique a fait montre d’une formidable ductilité, d’une exceptionnelle capacité d’adaptation au monde nouveau. Les sceptiques – souvent français, pas toujours –, se sont trompés en imaginant que sa torpeur bureaucratique l’empêcherait de suivre une histoire marchant si vite. Pour d’évidentes raisons liées au rejet de la trop récente domination soviétique, et pour d’autres, plus complexes, qu’on laissera aux futurs historiens, l’Alliance s’est révélée depuis 15 ans une formidable machine à produire du « vouloir vivre ensemble ». C’est là sans doute son succès le plus spectaculaire – plus inattendu que celui qu’a produit, sur le long terme, sa considérable puissance militaire. Et pourtant son efficacité militaire – supposée, puisqu’elle n’avait jamais été questionnée…– a également constitué une carte décisive : l’OTAN est depuis 20 ans (sans doute pour longtemps encore) la seule coalition militaire immédiatement crédible. Pour cette raison, elle reprendra la main dans les Balkans en 1994 quelques années après y avoir été marginalisée ; et c’est aussi pourquoi pour tous ses membres, jeunes ou anciens, elle est vue au premier chef comme une garantie de sécurité suprême, inaliénable au sens le plus fort de ce terme. [...] »
(Extrait de l'Éditorial, par Dominique David)
SOMMAIRE
Le cadre du débat
Une Alliance bien vivante et qui s’adapte, par Lord Robertson of Port Ellen
L’OTAN, de Washington (1949) à Strasbourg-Kehl (2009), par Karl-Heinz Kamp
De l'OTAN élargie à l'OTAN globale ?
Un programme pour l'OTAN : vers un réseau de sécurité mondiale, par Zbigniew Brzezinski
Le débat sur une OTAN globale, par Michael Clarke
Quelle orientation future pour l’OTAN ?, par Christopher S. Chivvis
L'OTAN, l'Europe, la Russie
L’Alliance : un point de vue d’Europe centrale, par Bogdan Klich
OTAN et PESD : complexités institutionnelles et réalités politiques, par Jolyon Howorth
L’OTAN et la Russie : vu de Moscou, par Sergueï Rogov
OTAN-Russie : la « question russe » est-elle européenne ?, par Thomas Gomart
La France et l'OTAN
La France et l’OTAN : une histoire, par Maurice Vaïsse
Le « retour » de la France dans l’OTAN : une décision inopportune, par Jean-Pierre Chevènement
Réformer l'OTAN ?
L’OTAN et les armes nucléaires, par Ian Anthony
La réforme de l’OTAN : besoin, obstacles et nouvelles perspectives, par Diego Ruiz Palmer
Contre-point, 1964
La réforme de l’OTAN et le système de sécurité du monde libre, par Eugen Gerstenmaier

Contenu disponible en :
Régions et thématiques
ISBN / ISSN
Utilisation
Comment citer cette publicationPartager
Centres et programmes liés
Découvrez nos autres centres et programmes de rechercheEn savoir plus
Découvrir toutes nos analysesFinancer le réarmement de l’Europe FED, EDIP, SAFE : les instruments budgétaires de l’Union européenne
Lors d’un séminaire de travail organisé début novembre 2025 à Bruxelles et rassemblant des agents de l’Union européenne (UE) et des représentants civilo-militaires des États membres, un diplomate expérimenté prend la parole : « Honestly, I am lost with all these acronyms » ; une autre complète : « The European Union machine is even complex for those who follow it. »
Cartographier la guerre TechMil. Huit leçons tirées du champ de bataille ukrainien
Ce rapport retrace l'évolution des technologies clés qui ont émergé ou se sont développées au cours des quatre dernières années de la guerre en Ukraine. Son objectif est d'analyser les enseignements que l'OTAN pourrait en tirer pour renforcer ses capacités défensives et se préparer à une guerre moderne, de grande envergure et de nature conventionnelle.
L'Europe face au tournant de la DefTech. Repenser l'écosystème européen d'innovation de défense
« La façon dont je vois Iron Dome, c’est l’expression ultime de ce que sera le rôle des États-Unis dans les conflits futurs : non pas être les gendarmes du monde, mais en être l’armurerie », estimait en novembre 2023 Palmer Luckey, le fondateur d’Anduril, l’une des entreprises les plus en vue de la DefTech. L’ambition est claire : participer au réarmement mondial en capitalisant sur la qualité des innovations américaines et dominer le marché de l’armement, au moins occidental, par la maîtrise technologique.
Lance-roquettes multiples, une dépendance européenne historique et durable ?
Le conflit en Ukraine a souligné le rôle des lance-roquettes multiples (LRM) dans un conflit moderne, notamment en l’absence de supériorité aérienne empêchant les frappes dans la profondeur air-sol. De son côté, le parc de LRM européen se partage entre une minorité de plateformes occidentales à longue portée acquises à la fin de la guerre froide et une majorité de plateformes de conception soviétique ou post-soviétique axées sur la saturation à courte portée.











