Le business russe entre l'Europe et l'Amérique
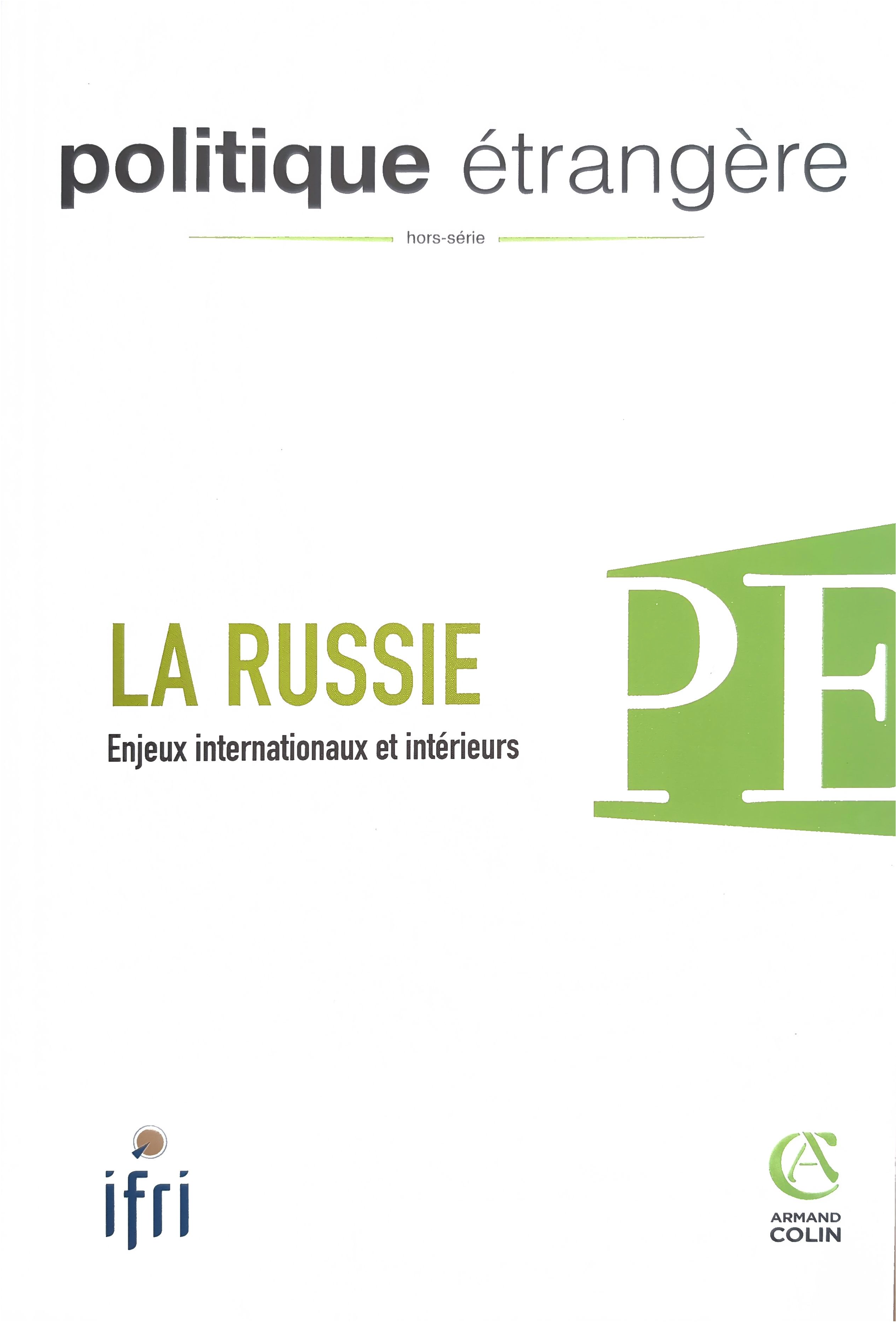
Moscou n’a pas de stratégie de long terme et manœuvre selon les intérêts de sa classe dirigeante, dans une sorte de géo-économie privatisée. Elle est donc résolument post-impériale, et ses relations avec l’Union européenne et les États-Unis dépendent au premier chef des accords financiers et économiques à conclure. Les relations avec l’Union pourront s’améliorer plus rapidement que les relations avec Washington, sans que l’on puisse prévoir une mue rapide de la Russie en démocratie « à l’européenne ».

Pour débattre de la politique étrangère de la Russie à l’aube du XXIe siècle, il faut d’abord tenter de cerner ses motivations profondes. Celles-ci se démarquent fortement du récent passé soviétique comme du plus lointain passé tsariste. Pour faire court, on pourrait dire que l’affaire de la Russie d’aujourd’hui c’est la Russie elle-même, et précisément... les affaires. La Russie actuelle est résolument post-impériale, bien qu’elle se considère encore comme une grande puissance. Elle est aussi un des pays les moins idéologisés de la planète. En dépit des discussions débilitantes sur l’Eurasisme, etc., les idées y comptent peu. Les intérêts, par contre, y règnent en maîtres.
La Russie est dirigée par ceux qui la possèdent, dans sa plus grande part. Ils n’ont pas hérité du pouvoir ou de leurs biens : ils ont dû batailler ferme pour parvenir là où ils sont. Leurs rangs ne comptent pas un seul homme politique classique, presque tous sont des capitalistes bureaucrates. Rien d’étonnant donc à ce que l’élite russe considère le monde à l’aune d’intérêts sonnants et trébuchants. Ses actions ont une devise : In Capital we Trust. Pour les membres de cette élite, les classiques valeurs (hormis le dollar, l’euro et le rouble) ne présentent que peu d’intérêt. La traditionnelle puissance militaire elle-même ne fascine guère plus. Du plus haut jusqu’en bas du pouvoir, on excelle à faire varier les prix de l’énergie, et non à décompter les ogives nucléaires. La géopolitique importe dans la mesure où elle pèse sur les intérêts économiques, mais certainement pas comme principe directeur : c’est de la géo-pétrolitique…
Seul le gaz surpasse le pétrole en importance. L’augmentation vertigineuse des prix du gaz par Gazprom à la fin 2005, qui a conduit à l’interruption des approvisionnements vers l’Ukraine le jour de l’An, fut le coup de grâce porté à l’ancienne Union soviétique. Moscou envoyait un message clair à ses voisins : les relations spéciales sont révolues, même pour les loyalistes comme l’Arménie ou la Biélorussie ; les subventions sont terminées, et tout le monde passe à la caisse : l’étranger, c’est tout le monde. La Russie considère donc ses voisins comme des espaces économiques où elle jouit encore de certains avantages comparatifs, et n’hésite pas à en user. Moscou n’entend pas jouer plus longtemps la carte de l’intégration. Elle invente un nouveau jeu : l’expansion économique dans son voisinage. [...]
PLAN DE L’ARTICLE
- La Russie et l’Europe : égalité et libre accès aux actifs
- Russie et Amérique : la limitation des dommages
- Deux logiques pour deux partenariats ?
- Existe-t-il un scénario positif ?
- Que faire ?
Ce texte a été publié pour la première fois dans le n°1:2007 de Politique étrangère.
Dmitri Trenin, Senior Associate au Carnegie Endowment for International Peace, est directeur d'études au centre moscovite du même institut. Parmi ses livres récents, on peut lire Integration and Identity: Russia as a New West (Moscou, Evropa, 2006); Russland: die gestrandete Weltmacht (Hambourg Murmann, 2005) et The End of Eurasia: Russia on the Border between Geopolitics and Globalization (Washington, Carnegie Endowment for International Peace, 2002).
Texte traduit de l’anglais par Jessica Allevione.

Contenu disponible en :
Régions et thématiques
Utilisation
Comment citer cette publicationPartager
Téléchargez l'analyse complète
Cette page ne contient qu'un résumé de notre travail. Si vous souhaitez avoir accès à toutes les informations de notre recherche sur le sujet, vous pouvez télécharger la version complète au format PDF.
Le business russe entre l'Europe et l'Amérique
Centres et programmes liés
Découvrez nos autres centres et programmes de rechercheEn savoir plus
Découvrir toutes nos analysesL'Europe et l'Afrique
Dans ce numéro spécial de Politique étrangère consacré aux actes de la Conférence organisée par l'Ifri le 10 avril 2019 au Grand amphithéâtre de la Sorbonne, à l'occasion de son quarantième anniversaire, découvrez l'entretien entre Thierry de Montbrial, fondateur et président de l'Ifri et Louise Mushikiwabo, ancienne ministre des Affaires étrangères du Rwanda, secrétaire générale de La Francophonie.
Conclusions
Dans ce numéro spécial de Politique étrangère consacré aux actes de la Conférence organisée par l'Ifri le 10 avril 2019 au Grand amphithéâtre de la Sorbonne, à l'occasion de son quarantième anniversaire, découvrez l'allocution de Jean-Yves Le Drian, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères.
Nouveaux défis mondiaux et sécurité européenne
Dans ce numéro spécial de Politique étrangère consacré aux actes de la Conférence organisée par l'Ifri le 10 avril 2019 au Grand amphithéâtre de la Sorbonne, à l'occasion de son quarantième anniversaire, découvrez le débat animé par Nicole Gnesotto entre Wolfgang Ischinger, Jean-Marie Guéhenno, Julian King et Hubert Védrine.
Les industriels face aux nouveaux protectionnismes
Dans ce numéro spécial de Politique étrangère consacré aux actes de la Conférence organisée par l'Ifri le 10 avril 2019 au Grand amphithéâtre de la Sorbonne, à l'occasion de son quarantième anniversaire, découvrez le débat animé par Thierry de Montbrial entre Jean-Paul Agon et Patrick Pouyanné.









