Les conséquences stratégiques et politiques des armes nouvelles
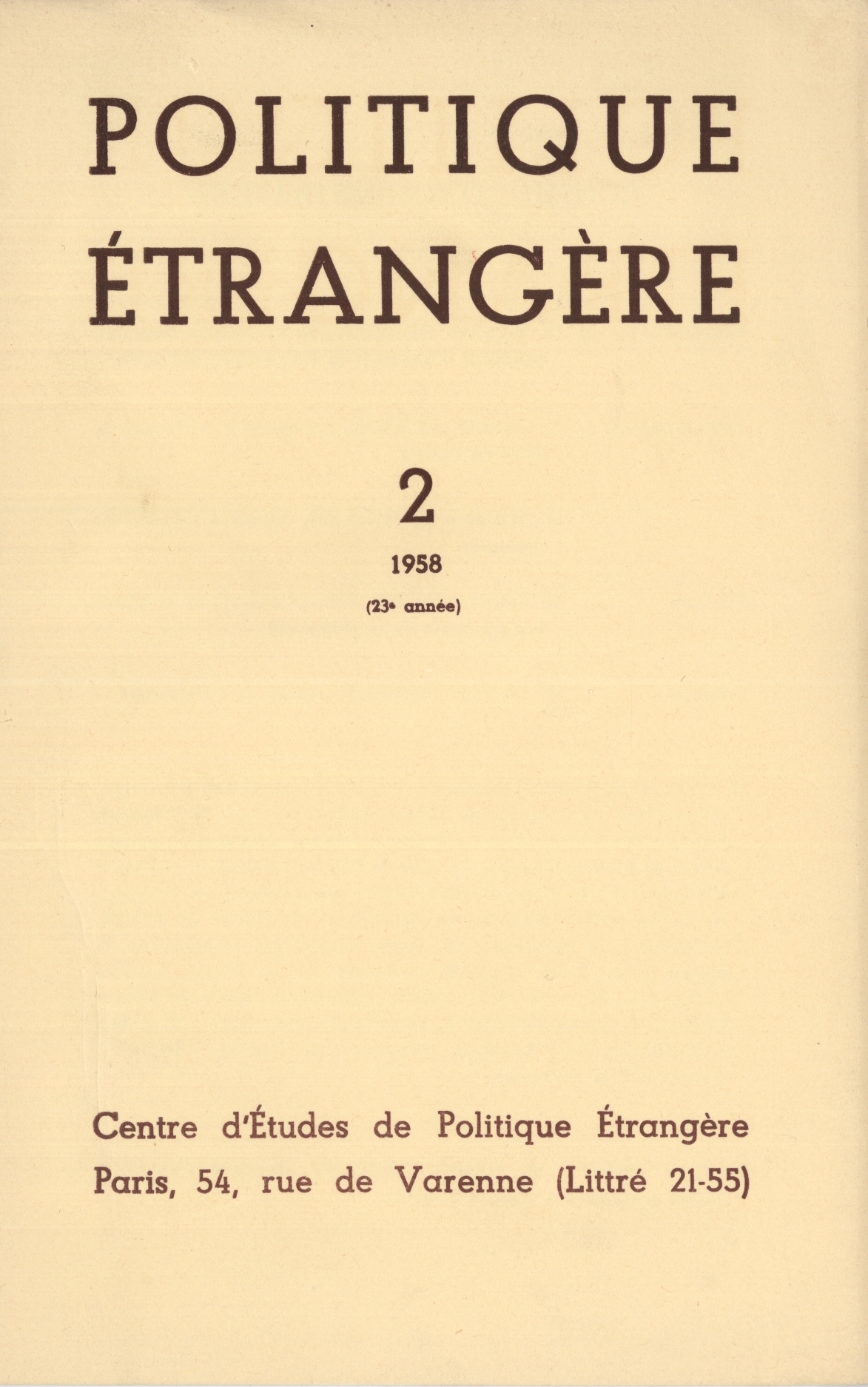
Si je voulais résumer les problèmes de l'armement, je dirais qu'ils sont caractérisés par deux phénomènes. L'un est leur accélération au cours des siècles. On peut, grosso modo, distinguer un certain nombre de périodes. Pendant la première, qui a duré des millénaires, la destruction de l'homme par l'homme était, si j'ose dire, individuelle, depuis l'époque de la hache en pierre taillée jusqu'au projectile plein de la Révolution, engin qui, lorsqu'il atteignait son but, détruisait un homme.
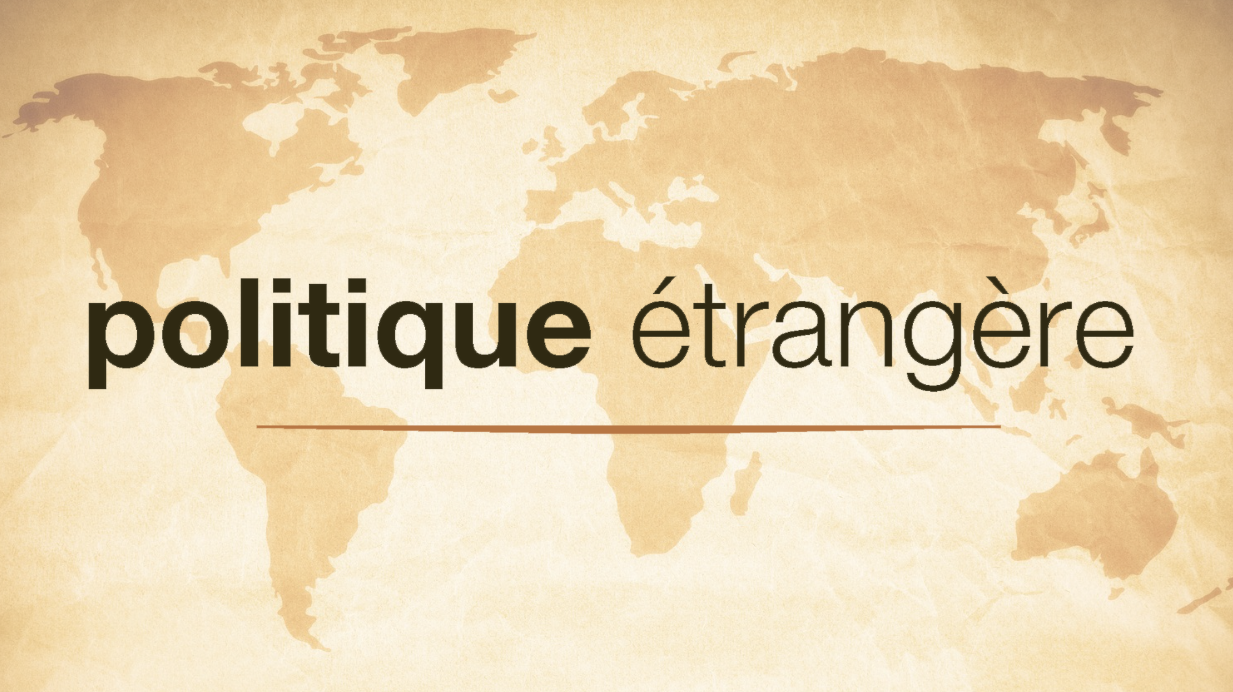
Il n'y a pas de très grands progrès durant toute cette période, de même que les Encyclopédistes n'avaient pas tellement accru leurs connaissances par rapport à celles d'Archimède ou des philosophes chinois de deux millénaires antérieurs. Puis vient une période d'un siècle et demi de destruction artisanale, marquée par l'invention d'un Anglais, Shrapnell, donnant à Wellington le moyen d'envoyer un obus qui, en éclatant en nombreux morceaux, pouvait toucher un certain nombre d'hommes quand il arrivait au but. Cette période, d'ailleurs, coïncide avec l'évolution de la technique, avec la mise au point de la machine à vapeur et, par elle, des grandes concentrations humaines de la société anonyme et de l'industrie moderne.
Ensuite, durant une trentaine d'années, à partir de la veille de la première guerre mondiale, arrive une période de destruction en petite série : les gaz, les liquides enflammés, les canons à tir rapide et fauchant, les mitrailleuses lançant, pendant quelques secondes, des projectiles à la cadence de 1.000 à la minute, les bombes d'avion de plus en plus lourdes. Tout cela permet de réaliser, si le coup arrive au but, la destruction d'une compagnie ou d'un îlot d'immeubles dans une ville bombardée.
Cette période se termine en 1944, où commence la destruction en grande série, avec les deux bombes d'Hiroshima et de Nagasaki, qui acculent à la capitulation un Empire de 72 millions d'habitants à l'époque, fanatiquement dévoué à son empereur-dieu, et profondément imbu de vertus militaires, mais qui, dans ces deux uniques coups au but, avait compté 215.000 morts et un nombre équivalent de blessés.
Enfin depuis 7 ans, depuis 1952 pour l'Occident et neuf mois plus tard pour l'U.R.S.S., c'est la destruction presque universelle ou la destruction au moins à l'échelle des nations qui est possible par l'engin thermonucléaire.
PLAN DE L'ARTICLE
I. Par Jules Moch
II. Par le général Pierre M. Gallois, du cadre de réserve

Contenu disponible en :
Régions et thématiques
Utilisation
Comment citer cette publicationPartager
Téléchargez l'analyse complète
Cette page ne contient qu'un résumé de notre travail. Si vous souhaitez avoir accès à toutes les informations de notre recherche sur le sujet, vous pouvez télécharger la version complète au format PDF.
Les conséquences stratégiques et politiques des armes nouvelles
En savoir plus
Découvrir toutes nos analysesLe Bangladesh entre crise politique et montée de l'islamisme
Le mouvement « Students Against Discrimination », à l'origine des manifestations de l'été 2024, a cristallisé le mécontentement d'une jeunesse confrontée à la réinstauration d'un quota controversé pour les descendants des muktijoddhas (les « combattants pour la liberté » de la guerre d'indépendance de 1971), après quinze années de dérive autoritaire de la Première ministre Sheikh Hasina.
Avant-propos
Dans ce numéro spécial de Politique étrangère consacré aux actes de la Conférence organisée par l'Ifri le 10 avril 2019 au Grand amphithéâtre de la Sorbonne, à l'occasion de son quarantième anniversaire, découvrez l'avant-propos de Thierry de Montbrial, fondateur et président de l'Ifri.
Avant-propos
Dans ce numéro spécial de Politique étrangère consacré aux actes de la Conférence organisée par l'Ifri le 10 avril 2019 au Grand amphithéâtre de la Sorbonne, à l'occasion de son quarantième anniversaire, découvrez l'avant-propos de Thierry de Montbrial, fondateur et président de l'Ifri.
L'Europe et l'Afrique
Dans ce numéro spécial de Politique étrangère consacré aux actes de la Conférence organisée par l'Ifri le 10 avril 2019 au Grand amphithéâtre de la Sorbonne, à l'occasion de son quarantième anniversaire, découvrez l'entretien entre Thierry de Montbrial, fondateur et président de l'Ifri et Louise Mushikiwabo, ancienne ministre des Affaires étrangères du Rwanda, secrétaire générale de La Francophonie.








