L'Europe à découvert ?
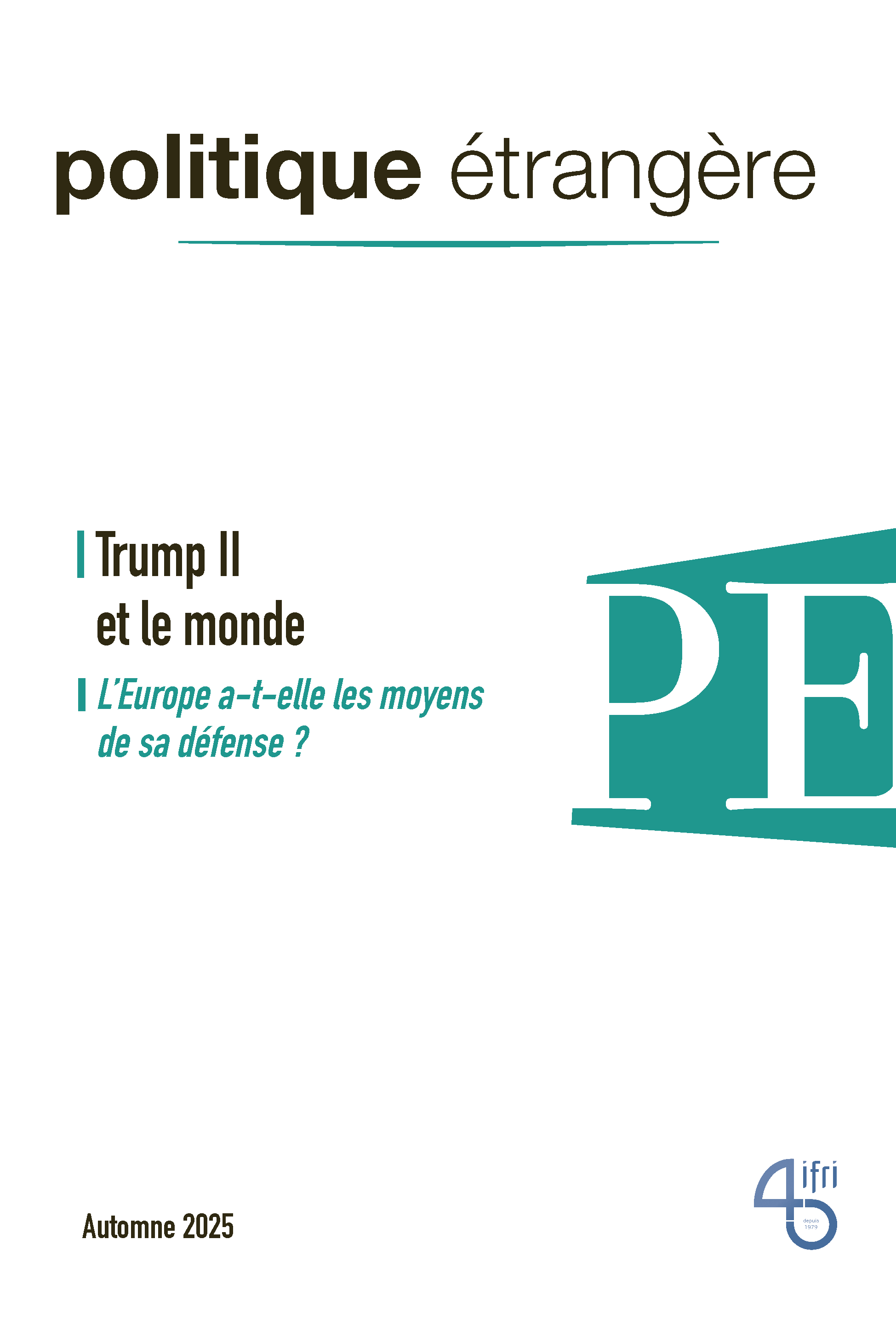
Alors que la Russie continue de menacer l'Europe, l'administration Trump ne cache pas son intention de se désengager – au moins partiellement – de la défense du continent pour se concentrer sur la compétition stratégique avec la Chine. Elle met ainsi la pression sur ses alliés européens pour qu'ils investissent davantage en matière militaire. Le sommet de l'OTAN qui s'est tenu à La Haye en juin 2025 a abouti à des engagements ambitieux des États membres pour relever leurs dépenses de défense.

Après avoir bénéficié depuis la fin de la guerre froide d'une période exceptionnelle de paix et de prospérité, le continent européen est rattrapé par la guerre et l'incertitude. Dans un contexte marqué par le recul des normes internationales, de la sécurité collective et du multilatéralisme ainsi que par le recours désinhibé des États-puissances à l'intimidation et la coercition, le Vieux Continent est ébranlé par un « effet ciseau », entre des menaces plus aiguës et des alliés moins fiables.
Alors qu'en 1991, 1999 et 2010 les « Concepts stratégiques » de l'Organisation du traité de l'Atlantique nord (OTAN) soulignaient que la zone euro-atlantique était « en paix », l'irénisme n'est désormais plus de mise. Au sommet de Madrid de juin 2022, les Alliés constataient le retour de la guerre et d'un adversaire structurant : la Fédération de Russie. En dépit de pertes humaines et matérielles considérables, et de la démonstration de ses défaillances qualitatives, Moscou a choisi de redoubler d'efforts dans son agression contre l'Ukraine, basculant vers une économie de guerre soutenant une massification de son format d'armée pour faire face à un « Occident collectif » désigné comme l'ennemi.
Dans ce contexte, les États-Unis semblent désormais faire un pas de côté. Alors que l'administration de Donald Trump multiplie piques politiques
et bras de fer commerciaux avec l'Europe, sur fond de remise en cause des principes de la sécurité collective et de la solidarité, le Pentagone entend réduire son empreinte militaire en Europe. S'il n'est pas pour l'heure question de quitter l'Alliance, ni même de rapatrier toutes les forces déployées, l'objectif est bien de voir « les Européens […] assumer la responsabilité de leur propre sécurité conventionnelle sur le continent ».
PLAN DE L'ARTICLE
Le primat transatlantique de la défense de l'Europe
* Le poids de l'histoire
* Un pivot « récalcitrant »
La prégnance de la menace russe
* Une hostilité stratégique durable
* Un rapport de force militaire incertain
* Une compétition économique et sociétale
Quels scénarios pour l'avenir ?
Élie Tenenbaum est directeur du Centre des études de sécurité de l'Ifri.
Guillaume Garnier, ancien officier supérieur de l'armée de Terre, est chercheur associé à l'Ifri.
Article publié dans Politique étrangère, vol. 90, n° 3, 2025.
Texte citation
[...] les Européens devront renoncer au confort de l'illusion stratégique et faire preuve d'une résolution et d'une convergence politique que l'on peine à discerner dans le paysage actuel. C'est pourtant le prix à payer pour éviter les affres de l'impuissance.

Directeur du Centre des études de sécurité de l'Ifri

Contenu disponible en :
Thématiques et régions
Utilisation
Comment citer cette publicationPartager
Centres et programmes liés
Découvrez nos autres centres et programmes de rechercheEn savoir plus
Découvrir toutes nos analysesLe Bangladesh entre crise politique et montée de l'islamisme
Le mouvement « Students Against Discrimination », à l'origine des manifestations de l'été 2024, a cristallisé le mécontentement d'une jeunesse confrontée à la réinstauration d'un quota controversé pour les descendants des muktijoddhas (les « combattants pour la liberté » de la guerre d'indépendance de 1971), après quinze années de dérive autoritaire de la Première ministre Sheikh Hasina.
Avant-propos
Dans ce numéro spécial de Politique étrangère consacré aux actes de la Conférence organisée par l'Ifri le 10 avril 2019 au Grand amphithéâtre de la Sorbonne, à l'occasion de son quarantième anniversaire, découvrez l'avant-propos de Thierry de Montbrial, fondateur et président de l'Ifri.
Avant-propos
Dans ce numéro spécial de Politique étrangère consacré aux actes de la Conférence organisée par l'Ifri le 10 avril 2019 au Grand amphithéâtre de la Sorbonne, à l'occasion de son quarantième anniversaire, découvrez l'avant-propos de Thierry de Montbrial, fondateur et président de l'Ifri.
L'Europe et l'Afrique
Dans ce numéro spécial de Politique étrangère consacré aux actes de la Conférence organisée par l'Ifri le 10 avril 2019 au Grand amphithéâtre de la Sorbonne, à l'occasion de son quarantième anniversaire, découvrez l'entretien entre Thierry de Montbrial, fondateur et président de l'Ifri et Louise Mushikiwabo, ancienne ministre des Affaires étrangères du Rwanda, secrétaire générale de La Francophonie.











