Octobre 1917 : révolution dans les relations internationales. Les trois leviers de la politique étrangère soviétique
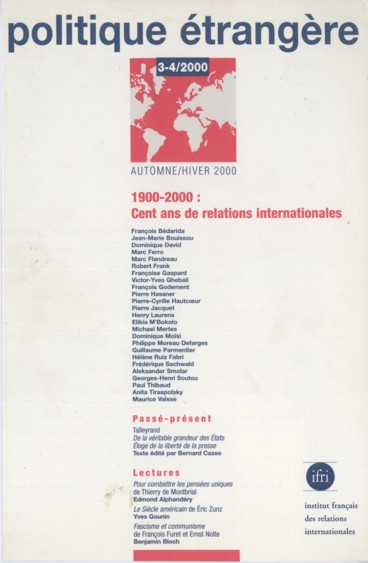
1917 : tandis que l'Europe s'enfonce dans la guerre, l'empire des tsars bascule dans un nouveau monde, celui du marxisme-léninisme. Renonçant à étendre la révolution hors de leurs frontières, les dirigeants soviétiques apportent trois changements majeurs dans les relations internationales : une remise en cause — plutôt limitée — de la diplomatie traditionnelle, l'utilisation des partis communistes nationaux dans la gestion des relations extérieures, et une véritable politique des nationalités prônant le droit à l'autodétermination.

En octobre 1917, l'action de Lénine se situa dans le cadre d'une victoire de la révolution en Europe. La paix révolutionnaire devait être contagieuse, et c'est pour cela que les bolcheviks adressèrent leur appel à tous les belligérants et pas seulement aux puissances centrales. À Stockholm, un appel de la gauche du mouvement de Zimmerwald, rédigé par Karl Radek et cosigné par les bolcheviks et par le Comité socialiste international, invitait les soldats de tous les pays à mettre bas les armes et tous les prolétaires à se joindre à la révolution russe.
Dans la pratique, l'application de ces principes tout comme la poursuite de ces objectifs passèrent par la manipulation de trois leviers : la diplomatie du nouvel État soviétique, la liaison du parti bolchevique avec les partis révolutionnaires de tous les autres pays, et la politique soviétique des nationalités. Le lien spécifique entre les modes d'action propres à ces trois champs de l'activité des soviets constitue l'une des innovations majeures que la révolution d'octobre a apportées aux relations internationales.
À dire vrai — premier levier — les bolcheviks jugeaient que la notion même de diplomatie, de relations entre États, serait bientôt remise en cause et même, à la limite, que celles-ci seraient destinées à disparaître. « Je lancerai quelques proclamations, et je fermerai boutique », disait Trotski, commissaire du peuple aux Affaires étrangères. Dans la réalité, on sait qu'il en alla autrement à cause de « l'immobilité de cadavre du prolétariat allemand » : il n'y eut de soulèvement révolutionnaire ni en Allemagne ni ailleurs en Europe, et les pourparlers de Brest-Litovsk achevèrent de tromper les espoirs de ceux qui en attendaient un. Mieux valait une paix catastrophique qu'une progression des armées de Guillaume II de Riga vers Petrograd... Dans ce contexte, la sauvegarde de l'État soviétique était devenue une nécessité prioritaire : plus tard, en août 1918, menacée par les Blancs et les Alliés, la République soviétique échangea même une aide militaire allemande contre une abstention de faire de la propagande dans les États des puissances centrales. Il s'agissait d'un accord secret, alors que Trotski avait affirmé qu'une fois au pouvoir les bolcheviks renonceraient à cette forme de diplomatie.
Aussi, bien avant Staline, Lénine et Trotski estimaient-ils déjà nécessaire de sacrifier la révolution européenne à la sauvegarde de leur propre régime. Selon l'expression fameuse de Boukharine, « la diplomatie soviétique naissait sur un tas de fumier ». […]
PLAN DE L’ARTICLE
- Partis communistes et nationalités
- De la Finlande au coup de Prague
Marc Ferro est directeur d’études et président de l’Association pour la recherche à l’École des hautes études en sciences sociales (EHESS).

Contenu disponible en :
Régions et thématiques
Utilisation
Comment citer cette publicationPartager
Téléchargez l'analyse complète
Cette page ne contient qu'un résumé de notre travail. Si vous souhaitez avoir accès à toutes les informations de notre recherche sur le sujet, vous pouvez télécharger la version complète au format PDF.
Octobre 1917 : révolution dans les relations internationales. Les trois leviers de la politique étrangère soviétique
En savoir plus
Découvrir toutes nos analysesLe Bangladesh entre crise politique et montée de l'islamisme
Le mouvement « Students Against Discrimination », à l'origine des manifestations de l'été 2024, a cristallisé le mécontentement d'une jeunesse confrontée à la réinstauration d'un quota controversé pour les descendants des muktijoddhas (les « combattants pour la liberté » de la guerre d'indépendance de 1971), après quinze années de dérive autoritaire de la Première ministre Sheikh Hasina.
Avant-propos
Dans ce numéro spécial de Politique étrangère consacré aux actes de la Conférence organisée par l'Ifri le 10 avril 2019 au Grand amphithéâtre de la Sorbonne, à l'occasion de son quarantième anniversaire, découvrez l'avant-propos de Thierry de Montbrial, fondateur et président de l'Ifri.
Avant-propos
Dans ce numéro spécial de Politique étrangère consacré aux actes de la Conférence organisée par l'Ifri le 10 avril 2019 au Grand amphithéâtre de la Sorbonne, à l'occasion de son quarantième anniversaire, découvrez l'avant-propos de Thierry de Montbrial, fondateur et président de l'Ifri.
L'Europe et l'Afrique
Dans ce numéro spécial de Politique étrangère consacré aux actes de la Conférence organisée par l'Ifri le 10 avril 2019 au Grand amphithéâtre de la Sorbonne, à l'occasion de son quarantième anniversaire, découvrez l'entretien entre Thierry de Montbrial, fondateur et président de l'Ifri et Louise Mushikiwabo, ancienne ministre des Affaires étrangères du Rwanda, secrétaire générale de La Francophonie.








