L'activisme commercial croissant de la Chine au sein de l'Asean et ses conséquences pour l'UE
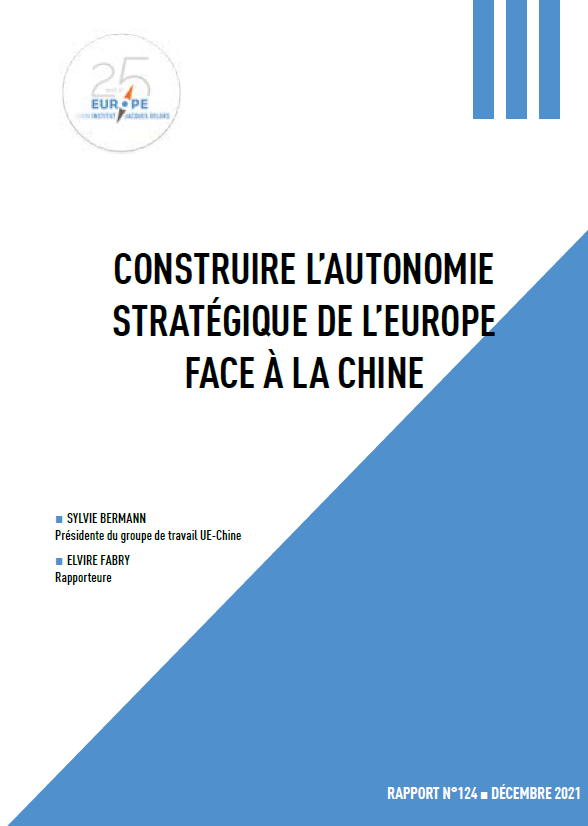
L’Institut Jacques Delors a constitué début 2021 un groupe de travail qui rassemble des chercheurs, universitaires, praticiens et représentants des milieux d’affaires émanant de divers Etats membres, pour se concentrer sur des enjeux structurants de la relation bilatérale UE-Chine. Françoise Nicolas formule des recommandations pour que l'UE développe ses relations avec l'Asie du Sud-Est où la Chine continue de gagner de l'influence.
Au cours des dernières années et ce, même si la Chine étend son empreinte en Asie du Sud-Est depuis la fin des années 1990, le pays est devenu de plus en plus actif dans la région, notamment dans le cadre de l’initiative phare du Président chinois Xi Jinping, la Belt and Road Initiative (BRI). L’activisme de la Chine dans la région est avant tout de nature économique et le commerce est le principal moyen pour elle de renforcer son influence sur cette partie du monde.
Le centre de gravité du monde s’étant déplacé vers l’Asie, L’Union européenne doit également y être présente. Elle doit développer ses relations avec les pays de la région longtemps négligés au seul profit de la Chine, c’est en particulier le cas des pays d’Asie du Sud-Est, où la Chine s’est fortement investie et continuera de gagner de l’influence après la ratification de l’Accord régional économique global (RCEP) de novembre 2020.
L’UE aurait intérêt à conclure la négociation engagée avec l’Indonésie, qui forte de près de 300 millions d’habitants sera d’ici à la fin de la décennie au minimum la cinquième économie mondiale. En outre, tout en donnant un nouveau souffle aux négociations bilatérales engagées avec la Malaisie, la Thaïlande et les Philippines, elle doit travailler à la relance du projet d’accord avec l’ASEAN. L’UE ne devrait pas non plus écarter l’idée de rejoindre l’accord CPTPP, signé par onze pays de la région pacifique qui auront à cœur de peser avec des normes communes, et qui n’en aurait que plus de poids pour influencer les pratiques commerciales chinoises.
> Voir l’article sur le site de l’Institut Jacques Delors

Contenu disponible en :
Régions et thématiques
Utilisation
Comment citer cette publicationPartager
Centres et programmes liés
Découvrez nos autres centres et programmes de rechercheEn savoir plus
Découvrir toutes nos analysesJapon : le raz-de-marée Takaichi et le nouveau visage du pouvoir
La Première ministre Sanae Takaichi a transformé sa popularité exceptionnelle en une victoire politique historique. Les élections anticipées du 8 février ont offert au Parti libéral démocrate (PLD) une majorité écrasante, grâce au soutien massif de jeunes électeurs séduits par son image iconoclaste et dynamique, et des conservateurs rassurés par sa vision d’affirmation nationale. Cette popularité pose les bases d’une stratégie ambitieuse tant sur le plan intérieur que sur le plan international.
Élections en Thaïlande : les conservateurs consolident leur ancrage
À rebours des sondages, le parti conservateur pro-business Bhumjaithai a dominé les élections législatives anticipées du 8 février 2026 et s’est imposé à la Chambre basse avec 193 sièges sur 500, enregistrant une progression record par rapport aux 71 députés élus en 2023.
Crise politique en Thaïlande : la tactique du chaos
La Thaïlande a replongé à l’été 2025 dans une crise politique profonde. La suspension de la Première ministre, Paetongtarn Shinawatra, par la Cour constitutionnelle a provoqué l’implosion de la coalition au pouvoir. Cette crise ressemble pourtant aux précédentes. Une banalité répétitive qui interroge à la fois le sens des responsabilités des principaux dirigeants et qui génère au sein de la population un cynisme mâtiné de résignation.

Ouverture du G7 à la Corée du Sud : relever les défis mondiaux contemporains
L'influence mondiale du G7 s'est affaiblie à mesure que des puissances telles que la Chine remodèlent la gouvernance internationale à travers des initiatives telles que les BRICS et l'Organisation de Coopération de Shanghai (OCS). Le G7 ne représentant plus aujourd'hui que 10 % de la population mondiale et 28 % du PIB mondial, sa pertinence est de plus en plus remise en question.













