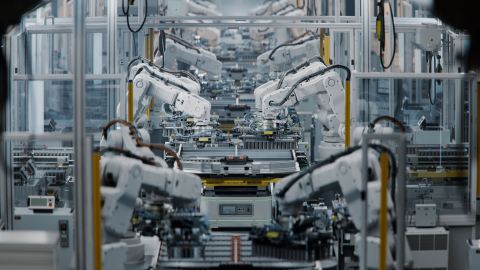Armées françaises : les limites de la stratégie de club

L'invasion russe de l’Ukraine a rappelé aux Européens leur vulnérabilité militaire. En dépit des menaces qui s’accumulaient dans un contexte de réarmement mondial, des incantations américaines à prendre davantage leur part de la défense du continent, l’Europe – et singulièrement l’Europe de l’Ouest –, aux prises avec une économie anémiée et sceptique quant à l’urgence de son réveil stratégique, avait différé jusqu’au dernier moment son rattrapage.

Le résultat est connu : les États-Unis assurent aujourd’hui 60 % de l’aide militaire à l’Ukraine, tandis que les pays membres de l’Union européenne n’atteignent que péniblement la barre des 25 %.
Pour autant, le choc n’a pas été sans effet. L’Allemagne, géant endormi depuis sa réunification, a mis en place un fonds spécial de 100 milliards d’euros pour le rééquipement de la Bundeswehr et se dirige vers une dépense militaire à hauteur de 2 % du produit intérieur brut (PIB). La Pologne a quant à elle annoncé qu’elle visait un plancher à 3 % dès 2023. Quant à la Finlande et la Suède, qui doivent rejoindre cette année l’Organisation du traité de l'Atlantique nord (OTAN), elles concèdent chacune une augmentation de 30 % de leurs dépenses militaires en deux ans. La France ne fait pas exception, et la nouvelle Loi de programmation militaire (LPM) 2024-2030 présentée au Parlement ce printemps propose elle aussi une augmentation de plus de 100 milliards d’euros sur les sept prochaines années. Dans un contexte d’endettement à 110 % du PIB et de pression sur les dépenses publiques, cet effort n’est pas anodin et peut être salué.
C’est finalement une stratégie de « club » qui prévaut, avec comme objectif d’intégrer un maximum de communautés capacitaires très sélectives : club des puissances nucléaires bien sûr, club des marines opérant un porte-avions, club des puissances cyber, spatiales, des forces spéciales, etc. Cette approche résonne fort avec un certain héritage gaullien tendant à faire résider l’indépendance, ou à tout le moins l’autonomie stratégique, dans la possession d’une capacité rare et devant déboucher sur une forme de directoire dans un champ donné. C’est le traumatisme de l’absence de Yalta que la France avait voulu effacer avec le statut de membre permanent au Conseil de sécurité des Nations unies, celui de Suez avec l’accès à l’arme atomique, et depuis lors la raison d’un grand nombre d’investissements dans des capacités de prestige, rares et chères.
Pour la France, puissance moyenne aux ressources limitées, cette quête d’une qualité absolue repose sur l’espoir d’un effet nivelant de ces capacités – « le pouvoir égalisateur de l’atome » vanté à l’époque par les stratèges gaulliens de la dissuasion –, qui tendrait ainsi à lisser l’approche quantitative. Un tel nivellement se fonde largement sur l’hypothèse du succès de la dissuasion et prévaut dans le cadre d’un « non-emploi » : il ne s’agit pas tant avec ces moyens de faire la guerre – surtout pas la guerre majeure qui consomme les quantités autant que les qualités, comme on le voit en Ukraine – que de peser sur l’ordre international.
De plus, chacun de ces clubs représente un domaine perçu comme suffisamment important pour que l’on refuse d'y consentir des dépendances – industrielles ou opérationnelles –, ou en tout cas que l’on cherche à les circonscrire au maximum. Cela se traduit par des savoir-faire uniques, mais peu exportables et qui se payent bien sûr sur le plan financier.
Cette logique de club a aussi un prix politique : celui d’une exceptionnalité française qu’il faut prendre garde à ne pas laisser virer à l’isolement. Alors que la France poursuit sa quête d’autonomie stratégique – nationale si possible, européenne seulement quand les ressources ne permettent pas d’autre voie –, notamment vis-à-vis des États-Unis, l’écrasante majorité des Européens font quant à eux le pari de la complémentarité transatlantique. En Allemagne, comme en Italie ou en Pologne, on se refuse à dupliquer les capacités « habilitantes » (dissuasion, renseignement, systèmes de commandement et communication, logistique de théâtre) que les Américains fourniraient en cas de conflit majeur.
Les options pour la France ne sont pas simples et la tâche de l’exécutif est lourde de conséquences. Deux voies se dégagent néanmoins : soit la poursuite d’une stratégie de club qui, malgré des ressources supplémentaires, ne pourra que retarder le décrochage conventionnel, ou bien l’acceptation d’une part grandissante de dépendances – y compris transatlantiques – dans ces domaines avec un réinvestissement des capacités classiques qui remettrait la France sur la voie européenne.

Contenu disponible en :
Régions et thématiques
ISBN / ISSN
Utilisation
Comment citer cette publicationPartager
Téléchargez l'analyse complète
Cette page ne contient qu'un résumé de notre travail. Si vous souhaitez avoir accès à toutes les informations de notre recherche sur le sujet, vous pouvez télécharger la version complète au format PDF.
Armées françaises : les limites de la stratégie de club
Centres et programmes liés
Découvrez nos autres centres et programmes de rechercheEn savoir plus
Découvrir toutes nos analysesFinancer le réarmement de l’Europe FED, EDIP, SAFE : les instruments budgétaires de l’Union européenne
Lors d’un séminaire de travail organisé début novembre 2025 à Bruxelles et rassemblant des agents de l’Union européenne (UE) et des représentants civilo-militaires des États membres, un diplomate expérimenté prend la parole : « Honestly, I am lost with all these acronyms » ; une autre complète : « The European Union machine is even complex for those who follow it. »
Cartographier la guerre TechMil. Huit leçons tirées du champ de bataille ukrainien
Ce rapport retrace l'évolution des technologies clés qui ont émergé ou se sont développées au cours des quatre dernières années de la guerre en Ukraine. Son objectif est d'analyser les enseignements que l'OTAN pourrait en tirer pour renforcer ses capacités défensives et se préparer à une guerre moderne, de grande envergure et de nature conventionnelle.
L'Europe face au tournant de la DefTech. Repenser l'écosystème européen d'innovation de défense
« La façon dont je vois Iron Dome, c’est l’expression ultime de ce que sera le rôle des États-Unis dans les conflits futurs : non pas être les gendarmes du monde, mais en être l’armurerie », estimait en novembre 2023 Palmer Luckey, le fondateur d’Anduril, l’une des entreprises les plus en vue de la DefTech. L’ambition est claire : participer au réarmement mondial en capitalisant sur la qualité des innovations américaines et dominer le marché de l’armement, au moins occidental, par la maîtrise technologique.
Lance-roquettes multiples, une dépendance européenne historique et durable ?
Le conflit en Ukraine a souligné le rôle des lance-roquettes multiples (LRM) dans un conflit moderne, notamment en l’absence de supériorité aérienne empêchant les frappes dans la profondeur air-sol. De son côté, le parc de LRM européen se partage entre une minorité de plateformes occidentales à longue portée acquises à la fin de la guerre froide et une majorité de plateformes de conception soviétique ou post-soviétique axées sur la saturation à courte portée.