Le futur de la prolifération nucléaire après la guerre en Ukraine
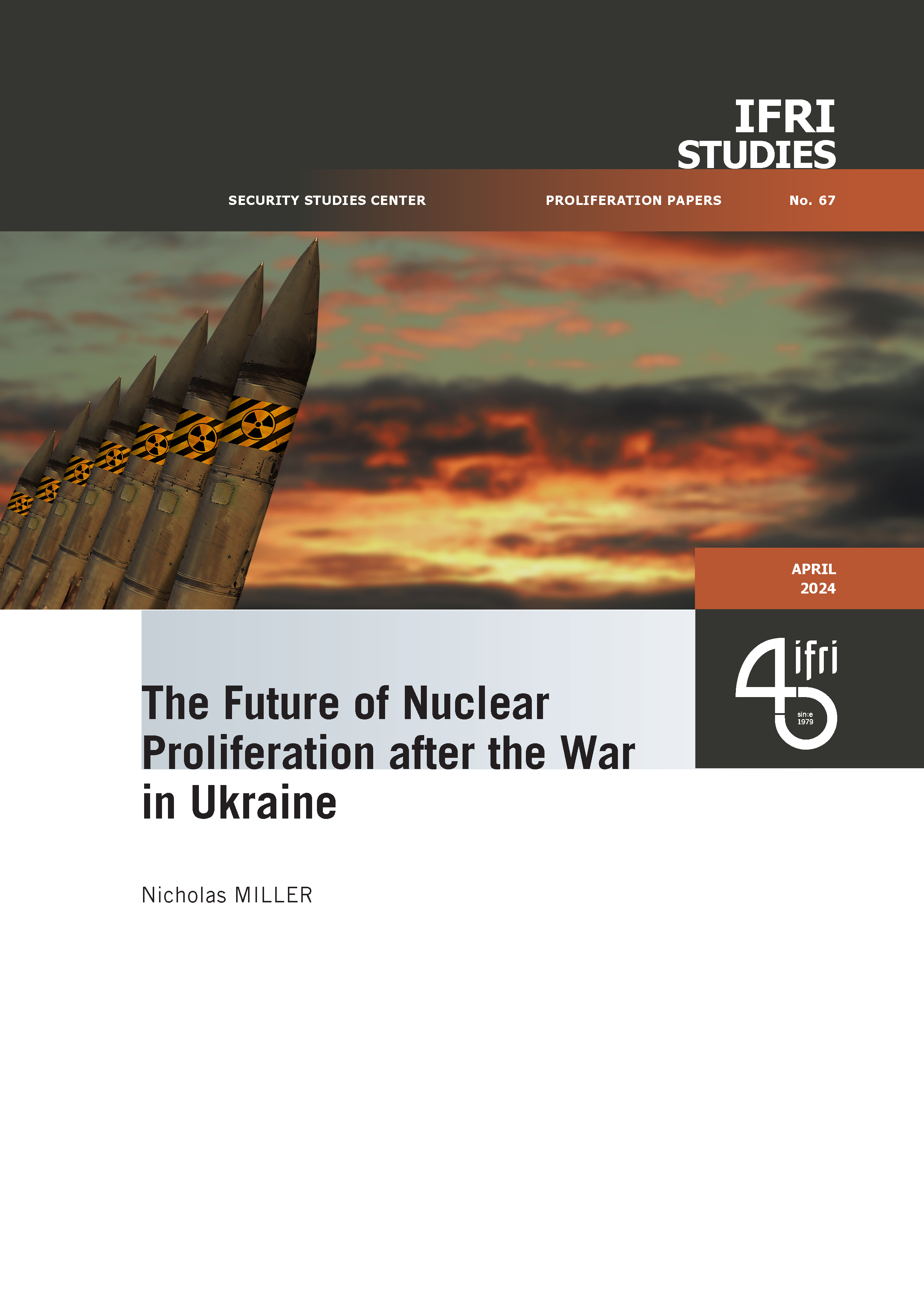
Dans le contexte de profonds bouleversements de l'environnement sécuritaire international, liés notamment à la guerre en Ukraine, les risques de prolifération nucléaire semblent assez élevés, en particulier au Moyen-Orient et en Asie de l'Est.

Quatre catégories de facteurs susceptibles de déclencher une escalade de prolifération nucléaire sont identifiées. Premièrement, l'évolution de l'environnement sécuritaire international, notamment la concurrence accrue entre les grandes puissances, pourrait accroître la pression en faveur de la prolifération dans des régions telles que l'Europe, l'Asie et le Moyen-Orient. Deuxièmement, le déclin de la capacité des États-Unis à faire respecter les régimes de non-prolifération pourrait inciter les alliés à chercher à se doter de capacités nucléaires en raison de leurs inquiétudes quant à la fiabilité des États-Unis. Troisièmement, le fait que les puissances nucléaires ne respectent pas leurs engagements en matière de désarmement et l'émergence du traité sur l'interdiction des armes nucléaires pourraient compromettre les normes de non-prolifération. Enfin, la guerre en Ukraine met en avant l'utilisation potentielle des menaces nucléaires dans les conflits, renforçant la perception que la possession d'armes nucléaires est cruciale pour la sécurité nationale.
Bien qu'il y ait des raisons d'anticiper des risques croissants de prolifération, les précédents historiques suggèrent ces risques sont gérables. Par le passé, la coercition et la réassurance ont permis de répondre aux inquiétudes concernant la fiabilité des États-Unis et les échecs en matière de désarmement. En outre, l'impact des guerres conventionnelles soutenues par la dissuasion nucléaire a été contenu. Si certains facteurs de risque sont nouveaux, comme le déclin de l'industrie nucléaire américaine et l'émergence du traité sur l'interdiction des armes nucléaires, leur impact reste incertain.
Les implications pour le Moyen-Orient et l'Asie de l'Est sont diverses. Des alliés comme le Japon et la Corée du Sud pourraient être convaincus de ne pas se doter d'armes nucléaires en raison des garanties de sécurité données par les États-Unis, tandis que des adversaires comme l'Iran pourraient être incités à se doter de capacités nucléaires en raison de la baisse d'efficacité des sanctions américaines. Si l'Iran se dote d'armes nucléaires, il s'exercera une pression pour que l'Arabie Saoudite fasse de même, ce qui pourrait entraîner une dynamique de prolifération régionale. Les grandes puissances et la communauté internationale doivent donc intervenir pour gérer les éléments déclencheurs de la prolifération en continuant à mettre l'accent sur la non-prolifération dans leur action politique.

Contenu disponible en :
Régions et thématiques
ISBN / ISSN
Utilisation
Comment citer cette publicationPartager
Centres et programmes liés
Découvrez nos autres centres et programmes de rechercheEn savoir plus
Découvrir toutes nos analysesLa Bundeswehr : du changement d’époque (Zeitenwende) à la rupture historique (Epochenbruch)
La Zeitenwende (« changement d’époque ») annoncée par Olaf Scholz le 27 février 2022 passe à la vitesse supérieure. Soutenues financièrement par la réforme constitutionnelle du « frein à la dette » de mars 2025 et cautionnées par un large consensus politique et sociétal en faveur du renforcement et de la modernisation de la Bundeswehr, les capacités militaires de l’Allemagne devraient augmenter rapidement au cours des prochaines années. Appelée à jouer un rôle central dans la défense du continent européen sur fond de relations transatlantiques en plein bouleversement, la position allemande en matière politique et militaire traverse une profonde mutation.
Financer le réarmement de l’Europe FED, EDIP, SAFE : les instruments budgétaires de l’Union européenne
Lors d’un séminaire de travail organisé début novembre 2025 à Bruxelles et rassemblant des agents de l’Union européenne (UE) et des représentants civilo-militaires des États membres, un diplomate expérimenté prend la parole : « Honestly, I am lost with all these acronyms » ; une autre complète : « The European Union machine is even complex for those who follow it. »
Cartographier la guerre TechMil. Huit leçons tirées du champ de bataille ukrainien
Ce rapport retrace l'évolution des technologies clés qui ont émergé ou se sont développées au cours des quatre dernières années de la guerre en Ukraine. Son objectif est d'analyser les enseignements que l'OTAN pourrait en tirer pour renforcer ses capacités défensives et se préparer à une guerre moderne, de grande envergure et de nature conventionnelle.
L'Europe face au tournant de la DefTech. Repenser l'écosystème européen d'innovation de défense
« La façon dont je vois Iron Dome, c’est l’expression ultime de ce que sera le rôle des États-Unis dans les conflits futurs : non pas être les gendarmes du monde, mais en être l’armurerie », estimait en novembre 2023 Palmer Luckey, le fondateur d’Anduril, l’une des entreprises les plus en vue de la DefTech. L’ambition est claire : participer au réarmement mondial en capitalisant sur la qualité des innovations américaines et dominer le marché de l’armement, au moins occidental, par la maîtrise technologique.














