Mourir au combat : l'impensé des Forces d'autodéfense japonaises
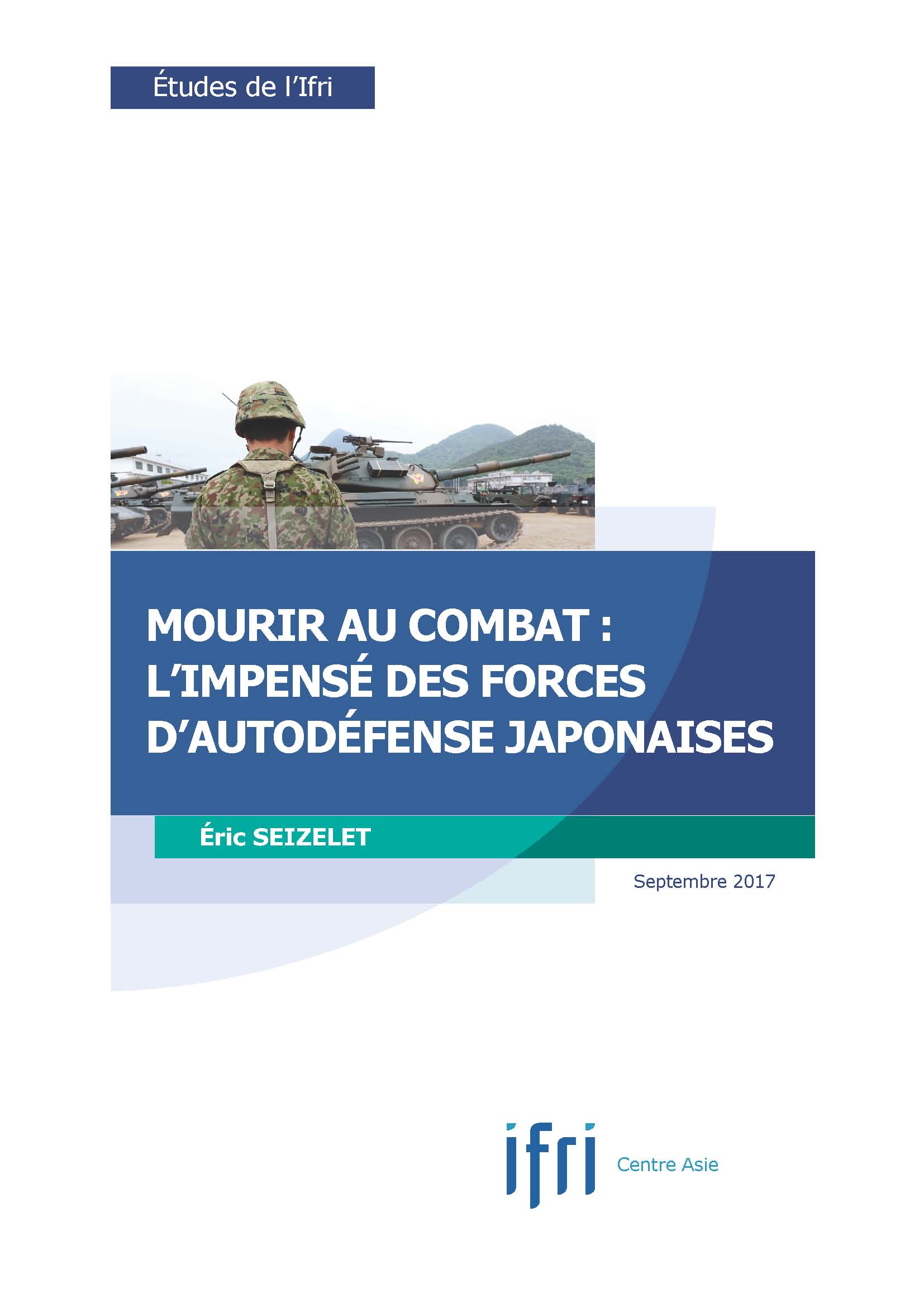
Dans les années 1990, le débat sur les Forces d’autodéfense japonaise (FAD) a évolué. Il s’agit dorénavant moins de contester l’existence constitutionnelle des FAD que de s’interroger sur leurs missions et les dangers nouveaux auxquels les soldats japonais sont désormais confrontés.

En effet, en dépit des précautions d’usage dans les paquets législatifs sur la sécurité nationale qui se sont succédé depuis lors, et des effets de rhétorique, la montée des tensions autour des îles Senkaku d’une part, la multiplication des engagements extérieurs des FAD dans des zones plus ou moins exposées, comme en Irak ou au Soudan du Sud d’autre part, ont fait resurgir la crainte qu’un membre des FAD puisse être tué en mission ou amené à tuer pour se défendre.
Le spectre de la guerre, consciencieusement enfoui dans l’inconscient collectif après l’expérience de la Seconde Guerre mondiale et des décennies de pacifisme, refait lentement surface. Le gouvernement japonais se trouve tiraillé entre deux impératifs contradictoires : jouer un rôle plus actif sur la scène internationale comme ses alliés l’y incitent, ménager les susceptibilités d’une opinion qui découvre, ou feint de découvrir, que les FAD n’ont pas simplement pour mission de porter secours aux sinistrés dans les catastrophes naturelles, mais de faire la guerre : mourir au combat, fût-ce au titre de la solidarité internationale, n’a pas la même signification que mourir en service dans un accident ou à l’entraînement. Par conséquent, la société civile, les élites politiques et militaires doivent faire face à une éventualité qui n’avait jamais été sérieusement envisagée auparavant : le statut et la condition du militaire blessé ou tué en action.
Cette interrogation englobe en réalité toute une série d’enjeux à forte connotation symbolique et émotionnelle : l’adaptation de la médecine militaire au traitement des situations d’urgence absolue ; les honneurs rendus aux militaires tombés ; le culte du souvenir avec la question épineuse de la relation entre les FAD et le sanctuaire Yasukuni. Au-delà, c’est également s’interroger sur la filiation entre les FAD et les anciennes armées impériales et la place du militaire dans la société japonaise d’après 1945.

Contenu disponible en :
Régions et thématiques
Utilisation
Comment citer cette publicationPartager
Téléchargez l'analyse complète
Cette page ne contient qu'un résumé de notre travail. Si vous souhaitez avoir accès à toutes les informations de notre recherche sur le sujet, vous pouvez télécharger la version complète au format PDF.
Mourir au combat : l'impensé des Forces d'autodéfense japonaises
Centres et programmes liés
Découvrez nos autres centres et programmes de rechercheEn savoir plus
Découvrir toutes nos analysesLa politique américaine envers Taïwan, au delà de Donald Trump : cartographie des acteurs américains des relations entre les États-Unis et Taïwan
Le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche a ravivé une incertitude profonde quant à l’engagement des États-Unis en matière de sécurité envers Taïwan. Contrairement au président Joe Biden, qui a maintes fois réaffirmé sa détermination à défendre l’île, Donald Trump évite soigneusement de se prononcer sur une éventuelle réaction américaine en cas de crise dans le détroit de Taïwan.
Japon : le raz-de-marée Takaichi et le nouveau visage du pouvoir
La Première ministre Sanae Takaichi a transformé sa popularité exceptionnelle en une victoire politique historique. Les élections anticipées du 8 février ont offert au Parti libéral démocrate (PLD) une majorité écrasante, grâce au soutien massif de jeunes électeurs séduits par son image iconoclaste et dynamique, et des conservateurs rassurés par sa vision d’affirmation nationale. Cette popularité pose les bases d’une stratégie ambitieuse tant sur le plan intérieur que sur le plan international.
Élections en Thaïlande : les conservateurs consolident leur ancrage
À rebours des sondages, le parti conservateur pro-business Bhumjaithai a dominé les élections législatives anticipées du 8 février 2026 et s’est imposé à la Chambre basse avec 193 sièges sur 500, enregistrant une progression record par rapport aux 71 députés élus en 2023.
Crise politique en Thaïlande : la tactique du chaos
La Thaïlande a replongé à l’été 2025 dans une crise politique profonde. La suspension de la Première ministre, Paetongtarn Shinawatra, par la Cour constitutionnelle a provoqué l’implosion de la coalition au pouvoir. Cette crise ressemble pourtant aux précédentes. Une banalité répétitive qui interroge à la fois le sens des responsabilités des principaux dirigeants et qui génère au sein de la population un cynisme mâtiné de résignation.












