1914-1918 et la redéfinition de la guerre
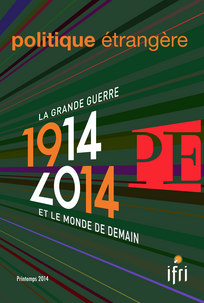
La Première Guerre mondiale a contribué à redéfinir la notion de stratégie, lui donnant une dimension politique qu’elle n’avait pas auparavant. De nouvelles institutions ont été créées pour permettre aux civils et aux militaires d’échanger sur les grandes orientations stratégiques. Au-delà de la stratégie, la « guerre totale » de 1914-1918 a transformé l’idée même de guerre. La mémoire de ce conflit doit être perpétuée : sa valeur dissuasive pourrait nous prémunir d’une nouvelle montée des extrêmes.

Pendant la guerre froide, la pensée stratégique a perdu le lien avec sa propre histoire. Déterminée par le changement technologique et surtout par l’impact des armes nucléaires, elle ne fut que trop encline à considérer les bombes d’Hiroshima et de Nagasaki comme le point de départ de toute modernité, rejetant tout ce qui avait précédé. On n’entend pas démontrer ici que la pensée stratégique n’a pas évolué depuis un siècle, mais au contraire établir à la fois qu’elle a changé – de façon souvent fondamentale – et que la Première Guerre mondiale, en particulier, a suscité des innovations qui ont marqué le siècle qui suit. La Grande Guerre a d’abord transformé la compréhension de la stratégie elle-même, lui donnant un sens bien plus large qu’avant 1914. Autre évolution cruciale, les exigences stratégiques de la guerre ont donné naissance à de nouvelles institutions, fusionnant pouvoir politique et autorité militaire. Les conséquences de ces changements n’ont été clairement perçues qu’après la Seconde Guerre mondiale. Dans le discours post-1945, c’est cette guerre, plus longue et responsable de plus de morts que la première pour la plupart des parties, qui donna toute sa signification à l’idée de « guerre totale », même si les origines de ce concept remontent elles aussi à un siècle.
Carl von Clausewitz est souvent brandi comme preuve de cohérence et de continuité en matière de pensée stratégique. Si sa pensée évolua sur de nombreux sujets, il resta fidèle à sa conception de la stratégie. « La stratégie est l’usage de l’engagement aux fins de la guerre », écrivait-il dans De la guerre, en écho à une idée qu’il avait développée dès 1804. Les définitions utilisées par les penseurs militaires dans les années précédant la Première Guerre mondiale restaient attachées à ce lien entre stratégie et tactique. Dans La Guerre d’aujourd’hui – dont le titre est une référence explicite à Clausewitz –, publié en allemand en 1912 et traduit en français et en anglais, Friedrich von Bernhardi écrivait que l’objet de la stratégie est « de conduire les troupes à l’action dans la direction décisive et avec la plus grande puissance possible ; de livrer le combat dans les meilleures conditions possibles ». […]
PLAN DE L’ARTICLE
- L’évolution du sens de la stratégie
- Appliquer la stratégie : entre pouvoir civil et autorité militaire
- De la stratégie maritime à la grande stratégie
- La guerre totale
Hew Strachan est titulaire de la chaire Chichele d’histoire de la guerre à l’université d’Oxford. Il est l’auteur, entre autres ouvrages, de La Première Guerre mondiale (Paris, Presses de la Cité, 2005).
Traduit de l’anglais par Cécile Tarpinian.
Cet article est disponible en langue anglaise : The Impact of the First World War on Strategy
Article publié dans Politique étrangère, vol. 79, n° 1, printemps 2014

Contenu disponible en :
Régions et thématiques
Utilisation
Comment citer cette publicationPartager
Téléchargez l'analyse complète
Cette page ne contient qu'un résumé de notre travail. Si vous souhaitez avoir accès à toutes les informations de notre recherche sur le sujet, vous pouvez télécharger la version complète au format PDF.
1914-1918 et la redéfinition de la guerre
Centres et programmes liés
Découvrez nos autres centres et programmes de rechercheEn savoir plus
Découvrir toutes nos analysesFinancer le réarmement de l’Europe FED, EDIP, SAFE : les instruments budgétaires de l’Union européenne
Lors d’un séminaire de travail organisé début novembre 2025 à Bruxelles et rassemblant des agents de l’Union européenne (UE) et des représentants civilo-militaires des États membres, un diplomate expérimenté prend la parole : « Honestly, I am lost with all these acronyms » ; une autre complète : « The European Union machine is even complex for those who follow it. »
Cartographier la guerre TechMil. Huit leçons tirées du champ de bataille ukrainien
Ce rapport retrace l'évolution des technologies clés qui ont émergé ou se sont développées au cours des quatre dernières années de la guerre en Ukraine. Son objectif est d'analyser les enseignements que l'OTAN pourrait en tirer pour renforcer ses capacités défensives et se préparer à une guerre moderne, de grande envergure et de nature conventionnelle.
L'Europe face au tournant de la DefTech. Repenser l'écosystème européen d'innovation de défense
« La façon dont je vois Iron Dome, c’est l’expression ultime de ce que sera le rôle des États-Unis dans les conflits futurs : non pas être les gendarmes du monde, mais en être l’armurerie », estimait en novembre 2023 Palmer Luckey, le fondateur d’Anduril, l’une des entreprises les plus en vue de la DefTech. L’ambition est claire : participer au réarmement mondial en capitalisant sur la qualité des innovations américaines et dominer le marché de l’armement, au moins occidental, par la maîtrise technologique.
Lance-roquettes multiples, une dépendance européenne historique et durable ?
Le conflit en Ukraine a souligné le rôle des lance-roquettes multiples (LRM) dans un conflit moderne, notamment en l’absence de supériorité aérienne empêchant les frappes dans la profondeur air-sol. De son côté, le parc de LRM européen se partage entre une minorité de plateformes occidentales à longue portée acquises à la fin de la guerre froide et une majorité de plateformes de conception soviétique ou post-soviétique axées sur la saturation à courte portée.












