Haïti 1825-2025 : géopolitique de la dette
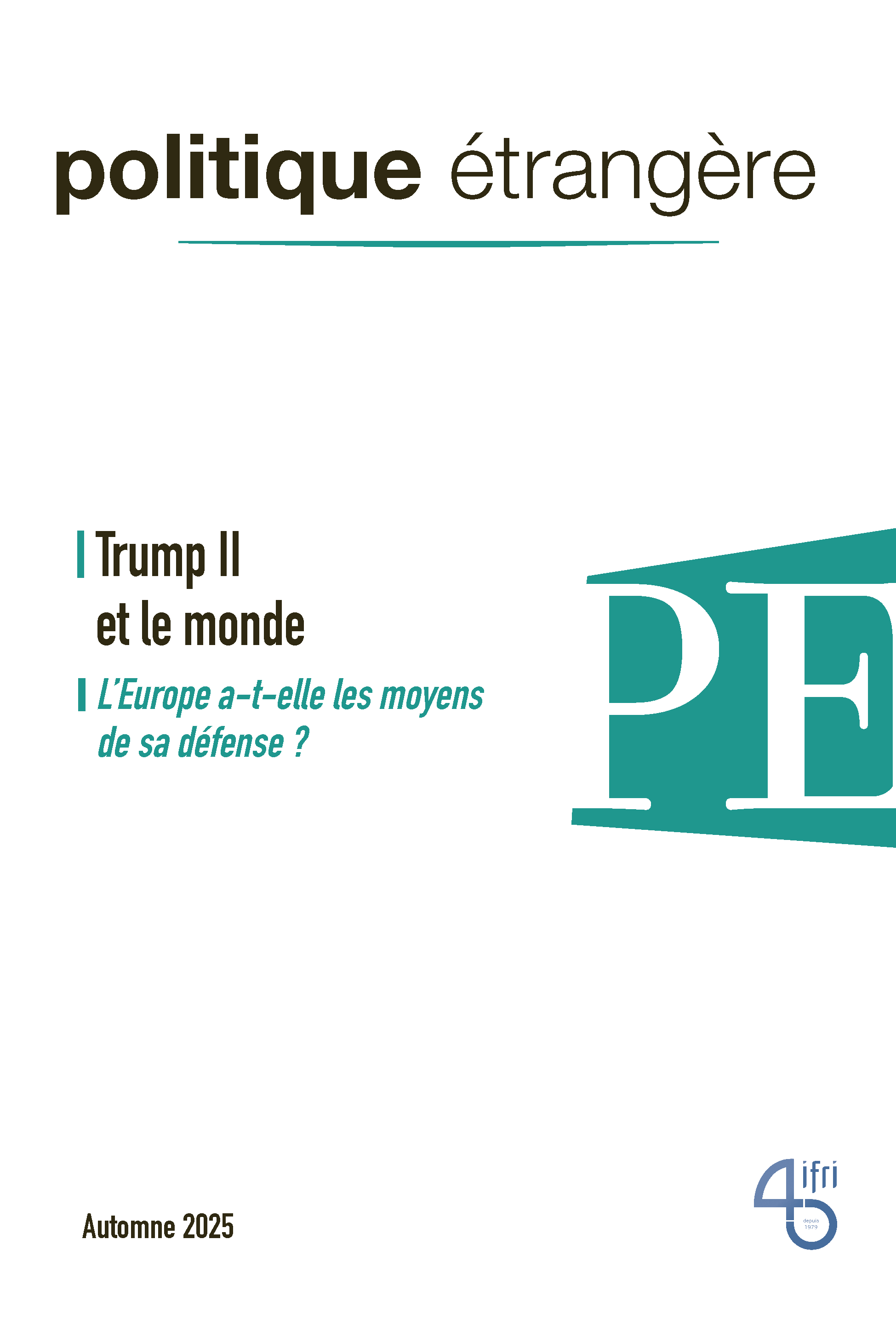
En 1825, la France a fait signer à Haïti un accord exigeant de lourds versements financiers contre la reconnaissance de son indépendance. Aujourd'hui dans un état de déréliction généralisée, Haïti demande le remboursement de ces sommes, ouvrant un débat international important. La France, qui n'a pas formulé de réponse face à cette demande, reste pourtant un des rares États à se préoccuper du sort d'Haïti, et plus généralement de l'espace caraïbe.
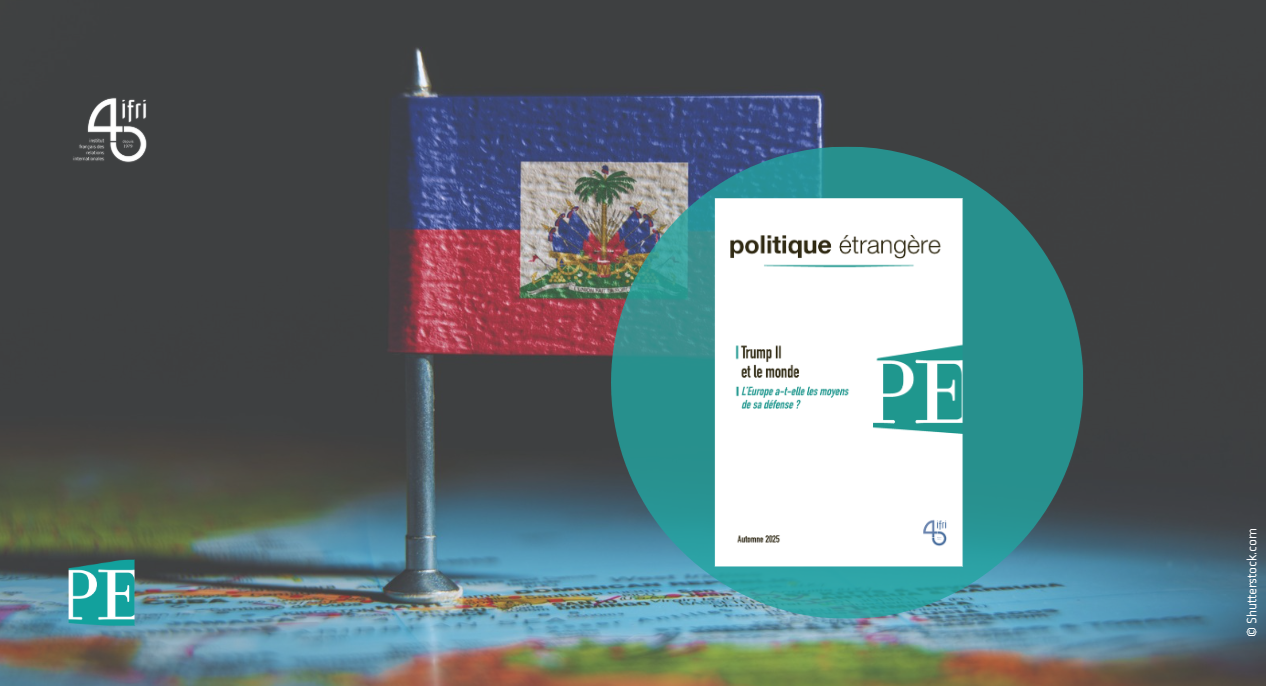
L'année 2025 aura été la pire de la lente et continuelle descente aux enfers que vit Haïti depuis plusieurs décennies. Cette assertion revient comme un refrain dans la chronique des malheurs que traverse ce pays de la Caraïbe. À force de la répéter, on finirait par croire que le bilan de chaque année sonne comme la prophétie de celle qui va suivre.
Depuis le terrible séisme de 2010 qui fit plus de 200 000 morts et disparus à Port-au-Prince, le pays est devenu un paradigme de déshérence de l'État. Sous les divers aspects de l'environnement, de l'économie, des institutions, des droits fondamentaux de l'individu, de la santé publique etc., la faillite est patente. Plus de la moitié de la population (12 millions d'habitants) est menacée de famine ; on compte plus de 3 000 personnes assassinées depuis le début de l'année, plusieurs milliers d'autres enlevées et libérées contre rançon ; 1,3 million de personnes ont dû fuir leurs demeures sous la menace des bandits armés qui sèment la terreur dans la capitale ; l'espérance de vie (62 ans) est la plus faible de tout l'hémisphère américain, et 85 % des Haïtiennes et Haïtiens titulaires d'un diplôme supérieur ou égal à un master vivent à l'étranger. Le tableau est si sombre que le pays confine à un trou noir dans la Caraïbe.
La catastrophe de 2010 avait soulevé une onde d'empathie sans égale dans le monde. Haïti reçut alors plus de 10 milliards de dollars d'aide internationale et une commission spéciale (la Commission intérimaire pour la reconstruction d'Haïti, avec à sa tête les experts les plus chevronnés, dont l'ex-président américain Bill Clinton et l'ex-Premier ministre Jean-Max Bellerive) fut créée pour remédier aux multiples carences de l'État. La mission était double : gérer l'urgence et préparer l'avenir.
Quinze années plus tard, force est de constater que la médication n'a pas eu l'effet escompté : le pays moribond survit dans une convalescence convulsive dont on ne perçoit pas la fin. Le centre-ville de Port-au-Prince est à l'abandon, vidé de ses habitants par la violence des gangs, les principaux bâtiments démolis par le séisme n'ont pas été reconstruits, les bidonvilles prolifèrent comme chancres sur les terres arables, la conurbation de Port au-Prince à Léogâne concentre plus du quart de la population nationale avec des densités de population supérieures à 30 000 au kilomètre carré. Sans adduction d'eau, d'électricité, sans services en tous genres, ces nouveaux quartiers fonctionnent comme des dortoirs et des zones de non-droit où seule règne la logique des gangs. [...]
PLAN DE L'ARTICLE
Un bicentenaire à la cloche de bois
Deux cents ans de solitude haïtienne
La force des faibles
Jean Marie Théodat est directeur du département de Géographie de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.
Article publié dans Politique étrangère, vol. 90, n° 3, 2025.

Contenu disponible en :
Thématiques et régions
Utilisation
Comment citer cette publicationPartager
Téléchargez l'analyse complète
Cette page ne contient qu'un résumé de notre travail. Si vous souhaitez avoir accès à toutes les informations de notre recherche sur le sujet, vous pouvez télécharger la version complète au format PDF.
Haïti 1825-2025 : géopolitique de la dette
En savoir plus
Découvrir toutes nos analysesLe Bangladesh entre crise politique et montée de l'islamisme
Le mouvement « Students Against Discrimination », à l'origine des manifestations de l'été 2024, a cristallisé le mécontentement d'une jeunesse confrontée à la réinstauration d'un quota controversé pour les descendants des muktijoddhas (les « combattants pour la liberté » de la guerre d'indépendance de 1971), après quinze années de dérive autoritaire de la Première ministre Sheikh Hasina.
Avant-propos
Dans ce numéro spécial de Politique étrangère consacré aux actes de la Conférence organisée par l'Ifri le 10 avril 2019 au Grand amphithéâtre de la Sorbonne, à l'occasion de son quarantième anniversaire, découvrez l'avant-propos de Thierry de Montbrial, fondateur et président de l'Ifri.
Avant-propos
Dans ce numéro spécial de Politique étrangère consacré aux actes de la Conférence organisée par l'Ifri le 10 avril 2019 au Grand amphithéâtre de la Sorbonne, à l'occasion de son quarantième anniversaire, découvrez l'avant-propos de Thierry de Montbrial, fondateur et président de l'Ifri.
L'Europe et l'Afrique
Dans ce numéro spécial de Politique étrangère consacré aux actes de la Conférence organisée par l'Ifri le 10 avril 2019 au Grand amphithéâtre de la Sorbonne, à l'occasion de son quarantième anniversaire, découvrez l'entretien entre Thierry de Montbrial, fondateur et président de l'Ifri et Louise Mushikiwabo, ancienne ministre des Affaires étrangères du Rwanda, secrétaire générale de La Francophonie.









