Nation et Europe au XXe siècle : de la sacralisation négative à la sécularisation positive
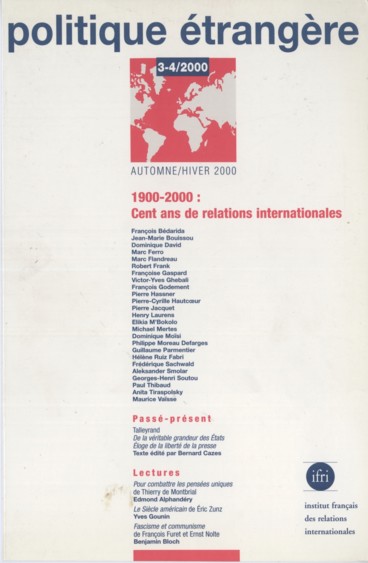
Le XXe siècle restera peut-être celui du divorce entre la nation et l’Europe. Après avoir façonné le Vieux Continent au XIXe siècle, le nationalisme l’entraîna en effet à sa perte, poussant par deux fois les vieilles nations européennes dans une guerre civile et mondiale qui les relégua au rang de puissances secondaires. Dès lors, le divorce entre l’Europe et la nation semblait consommé, favorisant l’émergence d’une Communauté puis d’une Union européenne aux desseins supranationaux. Mais la dévaluation de la nation n’a pas manqué de produire en retour quelques effets pervers, que le triomphe de la globalisation sous égide américaine n’a fait qu’amplifier. Et si la nation n’est plus sacralisée, comme elle le fut par le passé, elle paraît seule en mesure de redonner à l’Europe les fondations qui lui font encore défaut pour devenir une véritable Union.

De la nation on ne parle plus que négativement. Négativement d'abord, pour dire qu'elle est à préserver et que son rôle n'est pas fini, mais sans se donner la peine de le définir, comme si c'était un fait brut, indigne d'une image d'avenir, incapable de porter aucune espérance. Négativement aussi, et surtout, pour fustiger les excès dangereux du nationalisme et du sentiment national dont on souhaite et annonce (sans en être sûr) l'affaiblissement progressif. Avec un zeste de provocation, un politologue a décrit les effets de la « révision du catéchisme civique » qu'il attribue au prestige accru, depuis 30 ans, des pensées libérales (Hayek, Popper, J.-L Talmon) : « Le sens commun perçoit le nationalisme comme le fauteur de toutes les guerres et de tous les génocides modernes [...]. Quant à l’attachement national, il se trouve rangé dans une pathologie sociale qui, bien que plus bénigne, relègue celui qui le ressent dans un genre suranné. »
En Europe, la nation est ainsi l'objet de ce que l'on a pu appeler une « sacralisation négative ». Bouc émissaire, on se persuade qu'en l'érodant, en la dévaluant, en la désarmant, en la condamnant à une sorte de désœuvrement, on ouvre les portes de la paix et du droit. Pour expliquer cette idéologie, en tout cas cet état de l'opinion et des médias, on peut concentrer la réflexion sur deux événements qui sont à la fois deux événements matériels et moraux et autant de foyers de signification : 1914 (la nation associée à la guerre moderne) et 1989 : la faillite de la volonté politique sous sa forme extrême, la révolution et l'essor de ce que l'on appelle une « société civile européenne », voire mondiale.
La nation dévaluée
Depuis 1914-1918, le patriotisme est compromis avec le massacre industrialisé ; cette idée s'est imposée dans l'opinion dès l'entre-deux- guerres. En France notamment, les discussions très précoces (dès 1916, selon Jacques Droz, et ravivées dans les années 20 par Jules Isaac) sur le consentement à la guerre des dirigeants français en 1914 ont rendu méfiant sur la représentation politique nationale. Proust, dans Le temps retrouvé, prête des opinions de ce genre au baron Charlus : il y a dans l'acceptation de cette guerre une faute que les mises en accusation de l'Allemagne ne peuvent faire oublier. Le sentiment s'est alors installé que la représentation nationale avait trahi le peuple par une insuffisance et une impuissance devant l'événement, dissimulées derrière une débauche de sublime et de sacrificiel. Même l'urgence de la lutte contre Hitler n'a pas effacé cette blessure, cette défiance à l'égard d'une patrie qui décidément en demandait trop. […]
PLAN DE L’ARTICLE
- La nation dévaluée
- Les inconvénients de s'en passer
- La possibilité de la retrouver
Paul Thibaud est journaliste.

Contenu disponible en :
Régions et thématiques
Utilisation
Comment citer cette publicationPartager
Téléchargez l'analyse complète
Cette page ne contient qu'un résumé de notre travail. Si vous souhaitez avoir accès à toutes les informations de notre recherche sur le sujet, vous pouvez télécharger la version complète au format PDF.
Nation et Europe au XXe siècle : de la sacralisation négative à la sécularisation positive
En savoir plus
Découvrir toutes nos analysesLe Bangladesh entre crise politique et montée de l'islamisme
Le mouvement « Students Against Discrimination », à l'origine des manifestations de l'été 2024, a cristallisé le mécontentement d'une jeunesse confrontée à la réinstauration d'un quota controversé pour les descendants des muktijoddhas (les « combattants pour la liberté » de la guerre d'indépendance de 1971), après quinze années de dérive autoritaire de la Première ministre Sheikh Hasina.
Avant-propos
Dans ce numéro spécial de Politique étrangère consacré aux actes de la Conférence organisée par l'Ifri le 10 avril 2019 au Grand amphithéâtre de la Sorbonne, à l'occasion de son quarantième anniversaire, découvrez l'avant-propos de Thierry de Montbrial, fondateur et président de l'Ifri.
Avant-propos
Dans ce numéro spécial de Politique étrangère consacré aux actes de la Conférence organisée par l'Ifri le 10 avril 2019 au Grand amphithéâtre de la Sorbonne, à l'occasion de son quarantième anniversaire, découvrez l'avant-propos de Thierry de Montbrial, fondateur et président de l'Ifri.
L'Europe et l'Afrique
Dans ce numéro spécial de Politique étrangère consacré aux actes de la Conférence organisée par l'Ifri le 10 avril 2019 au Grand amphithéâtre de la Sorbonne, à l'occasion de son quarantième anniversaire, découvrez l'entretien entre Thierry de Montbrial, fondateur et président de l'Ifri et Louise Mushikiwabo, ancienne ministre des Affaires étrangères du Rwanda, secrétaire générale de La Francophonie.









