Pétrole : incertitudes et perspectives divergentes à moyen et long termes
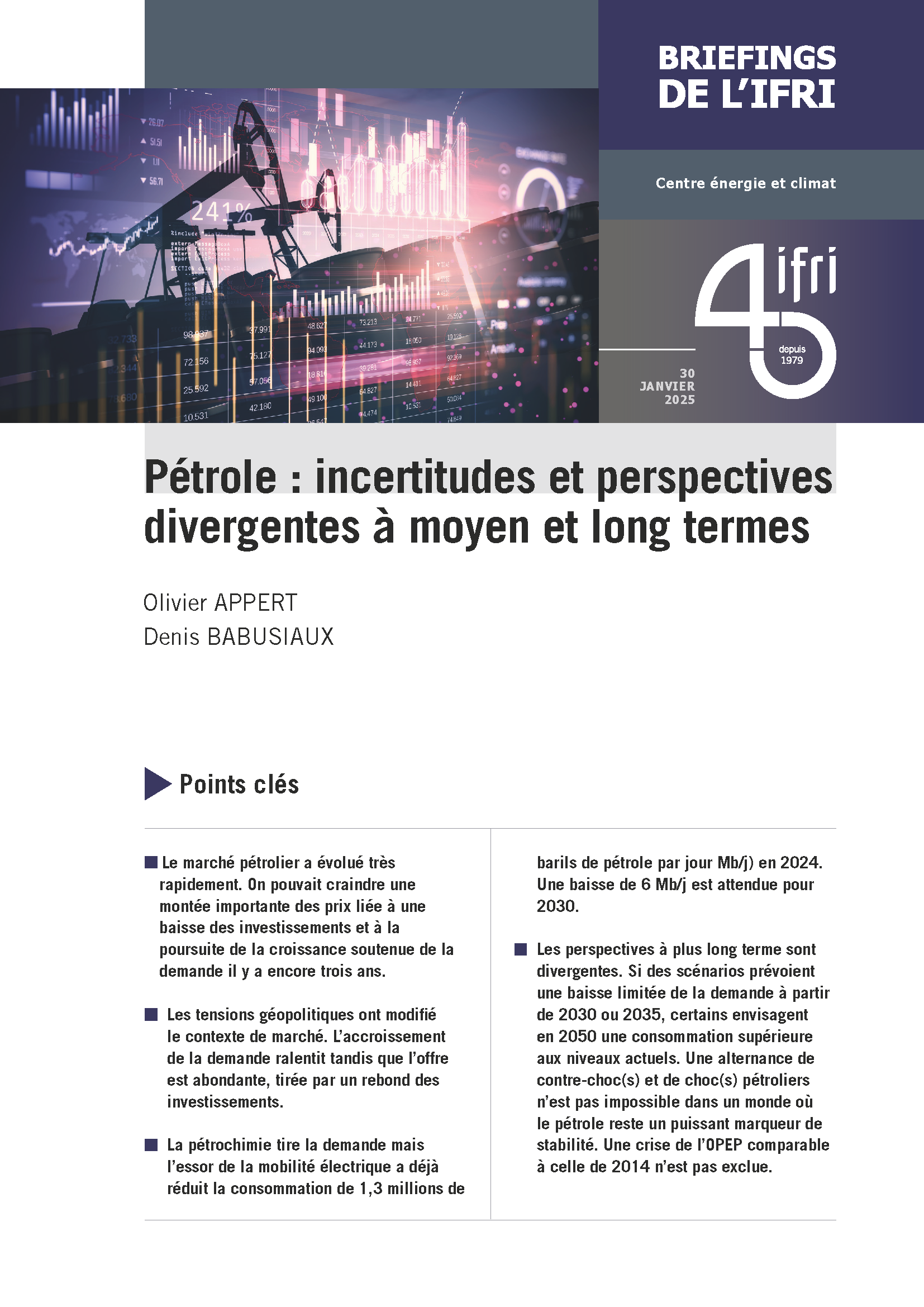
La crise du marché pétrolier en 2014 a débouché sur une reprise en main du marché par l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP). Celle-ci s’est mise d’accord sur une diminution des quotas de production de tous ses membres, notamment les pays du Moyen-Orient et l’organisation s’est alliée à d’autres producteurs, principalement la Russie, au sein de l’alliance dite « OPEP+ ». Son pouvoir de marché s’est confirmé à l’occasion de la pandémie, après un éclatement temporaire de l’alliance élargie.

Le marché pétrolier a évolué très rapidement. On pouvait craindre une montée importante des prix liée à une baisse des investissements et à la poursuite de la croissance soutenue de la demande il y a encore trois ans.
Les tensions géopolitiques ont modifié le contexte de marché. L’accroissement de la demande ralentit tandis que l’offre est abondante, tirée par un rebond des investissements.
La pétrochimie tire la demande mais l’essor de la mobilité électrique a déjà réduit la consommation de 1,3 Mb/j en 2024. Une baisse de 6 Mb/j est attendue pour 2030.
Les perspectives à plus long terme sont divergentes. Si des scénarios prévoient une baisse limitée de la demande à partir de 2030 ou 2035, certains envisagent en 2050 une consommation supérieure aux niveaux actuels. Une alternance de contre-choc(s) et de choc(s) pétroliers n’est pas impossible dans un monde où le pétrole reste un puissant marqueur de stabilité. Une crise de l’OPEP comparable à celle de 2014 n’est pas exclue.

Contenu disponible en :
Thématiques et régions
ISBN / ISSN
Utilisation
Comment citer cette publicationPartager
Téléchargez l'analyse complète
Cette page ne contient qu'un résumé de notre travail. Si vous souhaitez avoir accès à toutes les informations de notre recherche sur le sujet, vous pouvez télécharger la version complète au format PDF.
Pétrole : incertitudes et perspectives divergentes à moyen et long termes
Centres et programmes liés
Découvrez nos autres centres et programmes de rechercheEn savoir plus
Découvrir toutes nos analysesL'UE en état d'alerte : priorité sur les enjeux énergétiques et industriels pour 2026
L'année 2025 a confirmé qu'il était nécessaire de se préparer à un environnement géoéconomique et géopolitique plus difficile, car l'intensité et la fréquence des chocs augmentent, tandis que l'Union européenne (UE) n'a plus de flancs stables, dans un contexte de fréquentes crises avec les États-Unis, révélatrices d’une fracture systémique.
De l'IRA à l'OBBA : les entreprises françaises de l'énergie aux États-Unis
Adopté en 2022 sous l’administration Biden, l’Inflation Reduction Act (IRA) a marqué un tournant historique dans la politique énergétique américaine, offrant une visibilité supposée de long terme et attirant les investissements. De 2022 à 2024, les investissements américains dans les énergies propres ont atteint près de 500 milliards de dollars (+ 71 % en deux ans).
Le rôle clé de la Chine dans les chaînes de valeur des minerais critiques
La Chine occupe aujourd’hui une position dominante dans les chaînes de valeur des minerais critiques, de l’extraction à la transformation jusqu’aux technologies en aval. Cette suprématie repose sur des décennies de politiques industrielles et lui confère une influence stratégique considérable sur la sécurité d’approvisionnement mondiale, notamment pour l’Union européenne.
Le rôle de la course aux métaux stratégiques dans les conflits actuels
Les métaux critiques font l’objet de rivalités telles qu’il faut se préparer à ce que les rapports de force pour leur contrôle se transforment en conflits armés, déstabilisant potentiellement des régions, voire États. Les cas de la République démocratique du Congo, ou de la Birmanie, sont symptomatiques de ces évolutions. À terme, les risques pèsent aussi sur les chaines de valeur plus larges liées aux métaux, et notamment le segment de la logistique, qui est essentiel et représente un point de vulnérabilité majeur potentiellement exploitable par le crime organisé, des organisations armées et / ou des États.















